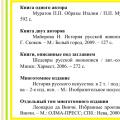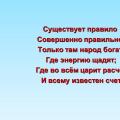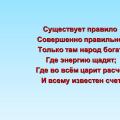Les spécialistes du Bureau d'expertise médico-sociale ont reconnu la Moscovite Ekaterina Prokudina, 20 ans, qui souffre de paralysie cérébrale depuis sa naissance et ne peut pas se déplacer de manière autonome, comme une personne handicapée du deuxième groupe, la privant ainsi de la possibilité de subir un examen annuel. traitement en sanatorium, a déclaré à RIA Novosti la mère de la jeune fille, Marina Prokudina.
Conformément aux règles de reconnaissance d'une personne comme personne handicapée, approuvées par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 20 février 2006, la reconnaissance d'un citoyen comme personne handicapée s'effectue lors d'un examen médical et social basé sur une évaluation complète de l'état du corps du citoyen basée sur une analyse de ses données cliniques, fonctionnelles, sociales, quotidiennes, professionnelles, professionnelles et psychologiques à l'aide de classifications et de critères approuvés par le ministère de la Santé et du Développement social de la Fédération de Russie.
Conditions de reconnaissance d'un citoyen handicapé sont:
Mauvaise santé avec un trouble persistant des fonctions corporelles causé par des maladies, des conséquences de blessures ou de défauts ;
- limitation de l'activité vitale (perte totale ou partielle par un citoyen de la capacité ou de la capacité d'effectuer un libre-service, de se déplacer de manière autonome, de naviguer, de communiquer, de contrôler son comportement, d'étudier ou de s'engager dans des activités professionnelles) ;
- la nécessité de mesures de protection sociale, y compris de réadaptation.
La présence de l'une de ces conditions ne constitue pas une base suffisante pour reconnaître un citoyen comme handicapé.
En fonction du degré d'invalidité causé par un trouble persistant des fonctions corporelles résultant de maladies, de conséquences de blessures ou de défauts, un citoyen reconnu handicapé se voit attribuer le groupe d'invalidité I, II ou III, et un citoyen de moins de 18 ans se voit attribuer le catégorie « enfant handicapé ».
Le handicap du groupe I est établi pour 2 ans, les groupes II et III - pour 1 an.
Si un citoyen est reconnu handicapé, la cause de l'invalidité est indiquée comme une maladie générale, un accident du travail, une maladie professionnelle, un handicap depuis l'enfance, un handicap dû à une blessure (commotion cérébrale, mutilation) liée aux opérations de combat pendant la Grande Guerre patriotique, une blessure militaire. , maladie contractée pendant le service militaire, invalidité associée à la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl, conséquences de l'exposition aux radiations et participation directe aux activités d'unités à risque spécial, ainsi que d'autres raisons établies par la législation de la Fédération de Russie.
Le réexamen des personnes handicapées du groupe I est effectué une fois tous les 2 ans, des personnes handicapées des groupes II et III - une fois par an, et des enfants handicapés - une fois pendant la période pour laquelle l'enfant est classé dans la catégorie « enfant handicapé ».
Les citoyens se voient attribuer un groupe de handicap sans préciser de délai de réexamen, et les citoyens de moins de 18 ans se voient attribuer la catégorie « enfant handicapé » jusqu'à ce que le citoyen atteigne l'âge de 18 ans :
Au plus tard 2 ans après la première reconnaissance comme handicapé (établissement de la catégorie « enfant handicapé ») d'un citoyen qui présente des maladies, des défauts, des changements morphologiques irréversibles, des dysfonctionnements des organes et des systèmes corporels selon la liste en annexe ;
- au plus tard 4 ans après la reconnaissance initiale d'un citoyen comme handicapé (création de la catégorie « enfant handicapé ») s'il s'avère qu'il est impossible d'éliminer ou de réduire lors de la mise en œuvre des mesures de réadaptation le degré de limitation des capacités du citoyen activité vitale causée par des changements morphologiques irréversibles persistants, des défauts et des dysfonctionnements des organes et des systèmes du corps.
La liste des maladies, défauts, modifications morphologiques irréversibles, dysfonctionnements des organes et systèmes du corps pour lesquels le groupe de handicap (catégorie « enfant handicapé » jusqu'à ce que le citoyen atteigne l'âge de 18 ans) est établie sans préciser le délai de réexamen :
1. Tumeurs malignes (avec métastases et rechutes après traitement radical ; métastases sans foyer primaire identifié lorsque le traitement est inefficace ; état général sévère après traitement palliatif, incurabilité (incurabilité) de la maladie avec symptômes sévères d'intoxication, de cachexie et de désintégration tumorale).
2. Tumeurs malignes des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et apparentés présentant de graves symptômes d'intoxication et un état général sévère.
3. Tumeurs bénignes inopérables du cerveau et de la moelle épinière avec déficiences sévères persistantes des fonctions motrices, de la parole, visuelles et troubles liquorodynamiques sévères.
4. Absence du larynx après son ablation chirurgicale.
5. Démence congénitale et acquise (démence sévère, retard mental sévère, retard mental profond).
6. Maladies du système nerveux à évolution chronique progressive, avec altération sévère et persistante des fonctions motrices, de la parole et visuelles.
7. Maladies neuromusculaires héréditaires progressives, maladies neuromusculaires progressives avec altération des fonctions bulbaires (fonctions de déglutition), atrophie musculaire, altération des fonctions motrices et (ou) altération des fonctions bulbaires.
8. Formes graves de maladies neurodégénératives du cerveau (parkinsonisme plus).
9. Cécité complète des deux yeux si le traitement est inefficace ; une diminution de l'acuité visuelle dans les deux yeux et dans l'œil qui voit mieux jusqu'à 0,03 avec correction ou un rétrécissement concentrique du champ de vision dans les deux yeux jusqu'à 10 degrés en raison de changements persistants et irréversibles.
10. Surdi-cécité totale.
11. Surdité congénitale avec impossibilité d'entendre des endoprothèses (implantation cochléaire).
12. Maladies caractérisées par une hypertension artérielle avec des complications graves du système nerveux central (avec altération sévère et persistante des fonctions motrices, de la parole et visuelles), des muscles cardiaques (accompagnées d'une insuffisance circulatoire de degré IIB III et d'une insuffisance coronarienne III classe fonctionnelle IV), des reins (insuffisance rénale chronique stade IIB III).
13. Maladie coronarienne avec insuffisance coronarienne III IV angine de classe fonctionnelle et déficience circulatoire persistante degré IIB III.
14. Maladies du système respiratoire à évolution progressive, accompagnées d'une insuffisance respiratoire persistante de degré II III, associée à une insuffisance circulatoire de degré IIB III.
15. Cirrhose du foie avec hépatosplénomégalie et hypertension portale de degré III.
16. Fistules fécales inamovibles, stomies.
17. Contracture sévère ou ankylose des grosses articulations des membres supérieurs et inférieurs dans une position fonctionnellement désavantageuse (si le remplacement par endoprothèse est impossible).
18. Insuffisance rénale chronique terminale.
19. Fistules urinaires inamovibles, stomies.
20. Anomalies congénitales du développement du système musculo-squelettique avec altération grave et persistante de la fonction de soutien et de mouvement avec impossibilité de correction.
21. Conséquences d'une lésion traumatique du cerveau (moelle épinière) avec altération grave et persistante des fonctions motrices, de la parole, visuelles et dysfonctionnement sévère des organes pelviens.
22. Anomalies du membre supérieur : amputation de la zone articulaire de l'épaule, désarticulation de l'épaule, du moignon d'épaule, de l'avant-bras, absence de la main, absence de toutes les phalanges des quatre doigts de la main, à l'exclusion du premier, absence de trois doigts de la main, y compris la première.
23. Anomalies et déformations du membre inférieur : amputation de la zone articulaire de la hanche, désarticulation de la cuisse, moignon fémoral, bas de jambe, absence du pied.
Visite médicale et sociale un citoyen est effectué au bureau du lieu de résidence (au lieu de séjour, au lieu du dossier de pension d'une personne handicapée partie en résidence permanente en dehors de la Fédération de Russie).
Au bureau principal, un citoyen est soumis à un examen médico-social s'il fait appel de la décision du bureau, ainsi que sur instruction du bureau dans les cas nécessitant des examens particuliers.
Au Bureau fédéral, un examen médico-social d'un citoyen est effectué en cas de recours contre la décision du bureau principal, ainsi qu'en direction du bureau principal dans les cas nécessitant des examens particuliers particulièrement complexes.
Un examen médico-social peut être effectué à domicile si le citoyen ne peut se présenter au bureau (bureau principal, Bureau fédéral) pour des raisons de santé, confirmées par la conclusion d'un organisme dispensant des soins médicaux et préventifs, ou dans un hôpital où le le citoyen est soigné, ou par contumace sur décision du bureau compétent.
La décision de reconnaître un citoyen comme handicapé ou de refuser de le reconnaître comme handicapé est prise à la majorité simple des voix des spécialistes ayant procédé à l'examen médico-social, sur la base d'une discussion des résultats de son examen médico-social.
Un citoyen (son représentant légal) peut faire appel de la décision du bureau auprès du bureau principal dans un délai d'un mois sur la base d'une demande écrite adressée au bureau qui a procédé à l'examen médico-social, ou au bureau principal.
Le bureau qui a procédé à l'examen médico-social du citoyen l'adresse avec tous les documents disponibles au bureau principal dans un délai de 3 jours à compter de la date de réception de la demande.
Le Bureau Principal, au plus tard 1 mois à compter de la date de réception de la demande du citoyen, procède à un examen médico-social et, sur la base des résultats obtenus, prend une décision appropriée.
Si un citoyen fait appel de la décision du bureau principal, l'expert en chef en matière d'examen médico-social de l'entité constitutive concernée de la Fédération de Russie, avec le consentement du citoyen, peut confier la conduite de son examen médico-social à un autre groupe de spécialistes du bureau principal.
La décision du bureau principal peut faire l'objet d'un recours dans un délai d'un mois auprès du Bureau fédéral sur la base d'une demande présentée par le citoyen (son représentant légal) au bureau principal qui a procédé à l'examen médico-social ou au Bureau fédéral.
Le Bureau fédéral, au plus tard 1 mois à compter de la date de réception de la demande du citoyen, procède à un examen médico-social et, sur la base des résultats obtenus, prend une décision appropriée.
Les décisions du bureau, du bureau principal et du Bureau fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal par un citoyen (son représentant légal) de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.
Classifications et critères, utilisés dans la mise en œuvre de l'examen médico-social des citoyens par les institutions d'examen médico-social de l'État fédéral, ont été approuvés par arrêté du ministère de la Santé et du Développement social du 23 décembre 2009.
Les classifications utilisées dans la mise en œuvre de l'examen médico-social des citoyens déterminent les principaux types de dysfonctionnements du corps humain, provoqués par des maladies, les conséquences de blessures ou de défauts, et le degré de leur gravité, ainsi que les principales catégories de la vie humaine. et la gravité des limitations de ces catégories.
Les critères utilisés lors de l'examen médico-social des citoyens déterminent les conditions de constitution des groupes de personnes handicapées (la catégorie « enfant handicapé »).
À principaux types de dysfonctionnements du corps humain se rapporter:
Violations des fonctions mentales (perception, attention, mémoire, pensée, intelligence, émotions, volonté, conscience, comportement, fonctions psychomotrices) ;
- violations des fonctions du langage et de la parole (violations de la parole orale et écrite, verbale et non verbale, troubles de la formation de la voix, etc.) ;
- troubles des fonctions sensorielles (vision, audition, odorat, toucher, tactile, douleur, température et autres types de sensibilité) ;
- violations des fonctions statiques-dynamiques (fonctions motrices de la tête, du torse, des membres, statique, coordination des mouvements) ;
- dysfonctionnements de la circulation sanguine, de la respiration, de la digestion, de l'excrétion, de l'hématopoïèse, du métabolisme et de l'énergie, de la sécrétion interne, de l'immunité ;
- troubles provoqués par une déformation physique (déformations du visage, de la tête, du torse, des membres, entraînant une déformation externe, ouvertures anormales des voies digestives, urinaires, respiratoires, violation de la corpulence).
Dans une évaluation globale de divers indicateurs caractérisant les dysfonctionnements persistants du corps humain, on distingue quatre degrés de gravité :
1er degré - violations mineures,
2ème degré - violations modérées,
3ème degré - troubles graves,
4ème degré - violations significativement prononcées.
Les principales catégories de la vie humaine comprennent : la capacité de libre-service ; capacité à se déplacer de manière autonome; capacité d'orientation; aptitude à communiquer; la capacité de contrôler son comportement ; capacité d'apprendre; Capacité de travail.
Dans une évaluation globale de divers indicateurs caractérisant les limites des principales catégories de la vie humaine, on distingue 3 degrés de leur gravité :
Capacité à prendre soin de soi- la capacité d'une personne à satisfaire de manière indépendante ses besoins physiologiques de base, à effectuer les activités ménagères quotidiennes, y compris les compétences en matière d'hygiène personnelle :
1er degré - la capacité du libre-service avec un investissement de temps plus long, la fragmentation de sa mise en œuvre, la réduction du volume en utilisant, si nécessaire, des moyens techniques auxiliaires ;
2ème degré - la capacité de prendre soin de soi avec l'assistance partielle régulière d'autres personnes utilisant des moyens techniques auxiliaires si nécessaire ;
3ème degré - incapacité à prendre soin de soi, besoin d'une aide extérieure constante et dépendance totale à l'égard d'autrui.
Capacité à se déplacer de manière autonome- la capacité de se déplacer de manière autonome dans l'espace, de maintenir l'équilibre du corps lors du déplacement, au repos et lors du changement de position du corps, d'utiliser les transports en commun :
1er degré - la capacité de se déplacer de manière autonome avec un investissement de temps plus long, une fragmentation de l'exécution et une réduction de la distance en utilisant, si nécessaire, des moyens techniques auxiliaires ;
2ème degré - la capacité de se déplacer de manière autonome avec l'assistance partielle régulière d'autres personnes, en utilisant des moyens techniques auxiliaires si nécessaire ;
3ème degré - incapacité à se déplacer de manière indépendante et besoin de l'aide constante des autres.
Capacité d'orientation- la capacité de percevoir adéquatement l'environnement, d'évaluer la situation, la capacité de déterminer l'heure et le lieu :
1er degré - la capacité de naviguer uniquement dans une situation familière de manière autonome et (ou) avec l'aide de moyens techniques auxiliaires ;
2ème degré - la capacité de naviguer avec l'assistance partielle régulière d'autres personnes en utilisant, si nécessaire, des moyens techniques auxiliaires ;
3ème degré - incapacité à naviguer (désorientation) et besoin d'assistance constante et (ou) de surveillance d'autres personnes.
Aptitude à communiquer- la capacité d'établir des contacts entre des personnes en percevant, traitant et transmettant des informations :
1er degré - capacité à communiquer avec une diminution du rythme et du volume de réception et de transmission d'informations ; utiliser, si nécessaire, des aides techniques d'assistance ; en cas de lésion isolée de l'organe de l'audition, la capacité de communiquer en utilisant des méthodes non verbales et des services de traduction en langue des signes ;
2ème degré - la capacité de communiquer avec l'assistance partielle régulière d'autres personnes, en utilisant des moyens techniques auxiliaires si nécessaire ;
3ème degré - incapacité à communiquer et besoin constant de l'aide des autres.
Capacité à contrôler votre comportement- la capacité de conscience de soi et de comportement adéquat tenant compte des normes éthiques sociales, juridiques et morales :
1er degré- limitation périodique de la capacité à contrôler son comportement dans des situations de vie difficiles et (ou) difficulté constante à exercer des fonctions de rôle affectant certains domaines de la vie, avec possibilité d'autocorrection partielle ;
2ème degré- réduction constante des critiques sur son comportement et son environnement avec possibilité de correction partielle uniquement avec l'aide régulière d'autres personnes ;
3ème degré- l'incapacité de contrôler son comportement, l'impossibilité de le corriger, le besoin constant d'aide (supervision) de la part d'autres personnes.
Capacité d'apprendre- la capacité de percevoir, de mémoriser, d'assimiler et de reproduire des connaissances (de formation générale, professionnelles, etc.), la maîtrise de compétences et d'aptitudes (professionnelles, sociales, culturelles, quotidiennes) :
1er degré- la capacité d'apprendre, ainsi que d'obtenir un certain niveau d'enseignement dans le cadre des normes éducatives de l'État dans les établissements d'enseignement général utilisant des méthodes d'enseignement particulières, un régime de formation spécial, utilisant, si nécessaire, des moyens et technologies techniques auxiliaires ;
2ème degré- la capacité d'apprendre uniquement dans des établissements d'enseignement spéciaux (correctionnels) pour étudiants, élèves, enfants handicapés ou à domicile selon des programmes spéciaux utilisant, si nécessaire, des moyens techniques et des technologies auxiliaires ;
3ème degré- trouble d'apprentissage.
Capacité de travail- capacité à exercer des activités de travail conformément aux exigences relatives au contenu, au volume, à la qualité et aux conditions de travail :
1er degré- la capacité d'effectuer des activités de travail dans des conditions normales de travail avec une diminution des qualifications, de la sévérité, de l'intensité et (ou) une diminution du volume de travail, l'incapacité de continuer à exercer la profession principale tout en conservant la capacité d'exercer des activités moins qualifiées travailler dans des conditions normales de travail ;
2ème degré- la capacité d'effectuer des activités de travail dans des conditions de travail spécialement créées avec l'utilisation de moyens techniques auxiliaires et (ou) avec l'aide d'autres personnes ;
3ème degré- incapacité d'exercer une activité professionnelle ou impossibilité (contre-indication) de toute activité professionnelle.
Le degré de limitation des principales catégories d'activités de la vie humaine est déterminé sur la base d'une évaluation de leur écart par rapport à la norme correspondant à une certaine période (âge) du développement biologique humain.
Région de Penza, Institution d'État de Penza SPN Centre régional de réadaptation des personnes handicapées de Penza
Yu. A. Vasyagina
L'ergothérapie vise à la réadaptation des personnes handicapées, c'est-à-dire celles qui ont perdu totalement ou partiellement la capacité de prendre soin d'elles-mêmes,
se déplacer de manière autonome, naviguer, communiquer, contrôler son comportement, étudier et participer à des activités professionnelles et se reposer bien. L’objectif de l’ergothérapie est d’atteindre un maximum d’autonomie et d’indépendance pour les personnes handicapées.
Sa méthode principale est la mise en œuvre pratique par les patients de diverses activités liées à l'un ou l'autre type d'activité.
Cet article présente certains domaines de l'ergothérapie utilisés au Centre régional de réadaptation de Penza depuis 1999 et qui ont prouvé leur efficacité.
Essai
Avant de débuter les activités de réadaptation, l’ergothérapeute évalue le handicap de la personne. À l'aide de techniques spéciales, de tests et de simulateurs qui simulent divers aspects de l'activité humaine, les violations des composants et composantes de la vie humaine sont identifiées. Sur la base de l'évaluation, le spécialiste, en collaboration avec le client, détermine les objectifs, les méthodes et le plan des séances d'ergothérapie. Le Centre régional de réadaptation de Penza utilise un certain nombre de tests qui permettent d'identifier les problèmes du patient causés par des troubles des membres supérieurs, des déficiences visuelles et de déterminer le type et la nature de l'activité dont il a besoin. Certains d'entre eux sont énumérés ci-dessous:
Test 1 : Détermination de la méthode de capture
Le test est utilisé chez les patients atteints d'hémiparésie et de paraparésie et vise à déterminer la capacité à saisir des objets petits et grands. Une aiguille, un clou, une clé, une feuille de papier, des perles, un crayon sont utilisés comme petits objets pour les tests ; les plus gros - un cube de 4 cm de côté, un rouleau à pâtisserie, un livre, un sac avec un manche, un couteau, une boule de 6 cm de diamètre. Il est demandé au patient de saisir un à un les objets répertoriés, en commençant par les plus petits, d'une main puis de l'autre. La préhension peut être réalisée avec ou sans l'utilisation d'une orthèse. Les résultats sont évalués sur une échelle de 4 points :
4 - prise et maintien corrects ;
3 - prise correcte sans maintien ;
2 - mauvaise adhérence, mais la rétention est possible ;
1 - mauvaise préhension, la tenue est impossible ;
0 - la capture est impossible.
Test 2. Évaluation de la motricité fine
Le test est utilisé pour les patients atteints d'hémiparésie et de paraparésie supérieure si le test visant à déterminer la méthode de capture donne un résultat positif. La dextérité des mouvements, la rapidité d'exécution des tâches et le nombre d'opérations sont évalués. Le patient peut effectuer la tâche soit avec chaque main tour à tour, soit avec les deux mains. Pour cela, deux ensembles d'appareils sont utilisés. 1er set - pour les patients capables de saisir de petits objets et de les tenir. Il comprend une planche avec des trous, des boulons, des rondelles et des écrous. 2e série - pour les patients capables de saisir de petits objets, mais ne peuvent pas les retenir. Il comprend un tableau avec des trous, des bâtons de comptage et des capuchons de feutres.
Lors d'un test avec le 1er jeu, le patient doit insérer autant de boulons que possible dans les trous de la planche en une minute, y mettre des rondelles et serrer les écrous. Dans le second cas, pendant le même temps, vous devez insérer autant de bâtons de comptage que possible dans le tableau et les recouvrir de capuchons de feutres.
Test 3. Points, rayons
Le test est destiné aux patients présentant une déficience visuelle (accident vasculaire cérébral, traumatisme crânien, paralysie cérébrale).
Il existe deux options pour effectuer le test. Pour le premier, un formulaire modèle est utilisé avec 8 rayons situés sous un certain angle et 8 formes distinctes, sur lesquelles un rayon est représenté au même endroit que sur le modèle. Le thérapeute propose au patient un modèle de formulaire, puis dispose alternativement des formulaires à faisceaux simples devant lui. La tâche du patient est de montrer où se situe le faisceau proposé par le thérapeute sur le gabarit. Pour la deuxième version du test, un formulaire modèle est utilisé avec 9 points représentés dans un certain ordre et 9 formulaires distincts, chacun montrant un point à différents endroits conformément au formulaire modèle. Le thérapeute place un modèle de formulaire devant le patient, puis dispose alternativement les formulaires avec des points situés séparément. Le patient doit déterminer où se trouve tel ou tel point sur le gabarit.
Test 4. Ligne brisée
Le test permet d'identifier les troubles de la coordination des mouvements des membres supérieurs (accident vasculaire cérébral, traumatisme crânien, paralysie cérébrale).
Le patient se voit proposer un formulaire sur lequel sont représentés différents types de lignes brisées. Il doit tracer au crayon un trait proche du contour de la ligne brisée.
La qualité de la tâche est évaluée.

Sélection des méthodes de formation pour le patient
Pour élaborer un plan de travail avec un patient, il est également nécessaire de respecter un certain nombre d'exigences lors du choix du type d'activité. Déterminer une profession qui convient à la personne handicapée est un processus complexe qui nécessite une grande compétence et une grande expérience de la part de l'ergothérapeute. Il ne faut pas oublier que les cours doivent être réalisables, significatifs pour le patient et cohérents avec ses intérêts et ses rôles dans la vie. Lors du choix des cours, vous devez être guidé par les principes suivants :
- toute activité et profession doit tenir compte du sexe des patients, dont certains peuvent croire que certains types d'activités sont exercés uniquement par des personnes d'un certain sexe. Par exemple, certains hommes peuvent refuser de participer à la cuisine parce qu’ils considèrent que c’est un « travail de femme », tandis que d’autres l’apprécient, sont de bons cuisiniers et peuvent même le faire de manière professionnelle. Lors de l’élaboration d’un plan de mesures de réadaptation, il vaut mieux pour l’ergothérapeute se fier à l’opinion du patient sur ces questions plutôt que de lui imposer son point de vue;
- le choix de l'activité doit correspondre aux caractéristiques culturelles de l'environnement du patient : une personne est plus susceptible de trouver une activité qui lui convient si elle reflète les normes et les valeurs de son groupe culturel ;
- le cours doit prendre en compte les caractéristiques d'âge du patient. Il peut refuser les activités qu'il juge inappropriées à son âge. Par exemple, une personne âgée ne jouera pas avec des poupées, mais pourra être intéressée par la construction d'une maison de poupée pour sa petite-fille, car cela correspond à son rôle de grand-père ;
- il est important de choisir des activités adaptées aux activités habituelles, notamment dans les cas où le patient se trouve dans l'enceinte d'un établissement médical. Le rôle de l'ergothérapeute est alors de permettre au patient de maintenir un équilibre entre soins personnels, loisirs et activités productives de manière à favoriser l'indépendance et l'autonomie ;
- lors du choix des activités, il est nécessaire de prendre en compte à la fois les forces et les faiblesses du patient, ainsi que la nature de l'activité. L'ergothérapeute doit choisir une activité qui maximise les forces du patient et remet en question ses faiblesses. Pour surmonter les déficiences fonctionnelles, il est nécessaire d'aider le patient à tirer le meilleur parti de ses forces pour compenser ses faiblesses, ainsi qu'adapter les conditions d'activité pour que le patient puisse s'y engager avec succès, malgré les limitations ;
- il faut augmenter progressivement le niveau de complexité des exercices, pour lesquels il faut déterminer la durée de leur mise en œuvre, l'intensité de l'effort physique et mental, le nombre d'étapes, la complexité de mise en œuvre, le nombre de les personnes avec lesquelles le patient doit entrer en contact, l'étendue des responsabilités et le niveau d'assistance requis. Il est important que ce processus soit cohérent avec les conditions de vie réelles et les aspirations du patient ;
- l'activité doit se dérouler dans un environnement dans lequel elle est la plus susceptible d'être réalisée par le patient. S’il s’agit d’un service hospitalier, ses spécificités peuvent ne pas refléter toutes les caractéristiques et exigences de l’environnement naturel du patient. Par exemple, un patient peut être capable de bien gérer le transfert d'un fauteuil roulant à un lit pendant son séjour à l'hôpital, mais peut avoir des difficultés à passer d'un fauteuil roulant à un lit en raison de différentes conditions à la maison. Dans de tels cas, il est recommandé de créer un environnement artificiel le plus proche de la vie réelle du patient. Une telle imitation peut concerner les domaines des soins personnels, des activités productives et des loisirs.
Méthodes d'adaptation sociale et quotidienne des personnes handicapées
I. Techniques de soins personnels UN
Ces techniques sont utilisées chez les patients souffrant d'hémiparésie, de paraparésie, de divers types d'ataxie, d'apraxie et d'hyperkinésie.
1. Utilisation d’aides à l’hygiène personnelle du patient Objectif :
- familiariser le patient avec les aides disponibles ;
- sélectionner les aides requises pour un patient particulier ;
- former le patient à l'utilisation des aides choisies.
Leçon 1. Parlez des aides disponibles et démontrez-les.
Leçon 2. Sélection des fonds nécessaires.
Leçon 3. Formation ultérieure étape par étape à l'utilisation des aides auxiliaires.
2. Formation à l'habillage/déshabillage Objectif :
- apprendre au patient à s'habiller/se déshabiller de façon autonome.
Avant de commencer les cours, il est nécessaire de déterminer la position du patient la plus favorable pour s'habiller/se déshabiller.
Leçon 1. Enfiler un pull/une chemise
Les patients atteints d'hémiparésie et de paraparésie supérieure apprennent à s'habiller de cette manière : en position assise ou debout, il faut insérer ses bras dans les manches, puis les relever, mettre la tête dans le décolleté. Si le patient ne peut pas lever les bras, vous devez d'abord passer la tête, mais dans ce cas, il sera difficile de mettre la main dans l'emmanchure. Il est beaucoup plus difficile d’apprendre à s’habiller en position couchée.
Leçon 2. Enfiler des pantalons/jupes
Pour les patients présentant une hémiparésie, une paraparésie supérieure, une tétraparésie, une paraplégie inférieure, le type de lésion détermine la méthode de pansement.
Si le patient est assis sur une chaise, il se penche pour insérer ses jambes dans les jambes du pantalon et les remonter jusqu'aux hanches, puis se relève pour les ramener jusqu'à la taille. Si le patient est allongé sur le dos, il lève une jambe, puis l'autre pour remonter le pantalon jusqu'aux hanches, puis soulève le bassin pour le remonter jusqu'à la taille. Si le patient est incapable de soulever le bassin, il est nécessaire de rouler d’un côté à l’autre pour enfiler des vêtements.
Leçon 3. Se déshabiller : pull/chemise
Si le patient peut déplacer l'épaule vers l'arrière, il libère l'épaule du côté opposé à l'aide de sa main dominante. Dans le cas contraire, il saisit le bord supérieur du pull par l'arrière avec une ou deux mains, met son menton dans le col du pull, se penche et tire le pull en laissant passer sa tête, puis en libérant ses mains. Cela nécessite une bonne fixation de la tête et du torse. Le déshabillage peut s'effectuer en position debout, assis sur une chaise, assis les jambes croisées sur le tapis. Pour les patients qui ne peuvent pas maintenir une position assise, il est très difficile de proposer une technique de déshabillage spécifique, il faut s'adapter à leurs capacités (lors du déshabillage, il suffit d'utiliser une prise palmaire, qui doit être assez forte).
Leçon 4. Se déshabiller : pantalon/jupe
En position debout, le patient descend son pantalon jusqu'à ses hanches, puis s'assoit pour libérer le bas de ses jambes.
En position couchée, il dégage les fesses, descend le pantalon un à un à partir de chaque jambe, puis retire complètement le pantalon.
Leçon 5. Apprendre à fermer les boutons
Il est utilisé chez les patients souffrant d'hémiparésie, de paraparésie et de paraplégie inférieure.
Apprendre à fixer est un processus long et difficile. La fixation nécessite une bonne prise avec le pouce et l'index de votre main dominante.
Tout d'abord, on apprend au patient à insérer des boutons (oblongs en bois, carton) dans les trous, puis à attacher et détacher les boutons, en commençant par les plus gros, tandis que les boucles doivent être légèrement plus grandes que la taille requise. L'étape suivante consiste à apprendre au patient à boutonner lui-même ses vêtements posés sur la table devant lui, puis à boutonner lui-même ses vêtements. Les vêtements en laine sont privilégiés pour l'entraînement, les boucles doivent être plus larges que sur ses vêtements normaux.
Leçon 6. Entraînement au ferrage et au laçage, utilisé pour les patients atteints d'hémiparésie et de paraparésie.
Les positions les plus optimales pour enfiler les chaussures :
- assis sur une chaise, les pieds au sol, le corps incliné vers l'avant ;
- assis sur une chaise, les pieds sur un support, à une hauteur légèrement inférieure à celle de la chaise ;
- assis par terre, les genoux fléchis.
Lors de l’apprentissage du laçage, il est nécessaire de développer une préhension avec le pouce et l’index. En cas de problème, entraînez-vous d'abord sur des sabots en bois (modèle), en utilisant des lacets de différentes couleurs pour faciliter la mémorisation du mécanisme de laçage. Les lacets doivent avoir une pointe épaisse. Ensuite, des lacets de la même couleur sont utilisés. Le patient lace les chaussures placées devant lui sur la table, talon face à lui. En cas de difficultés de laçage, vous devez à chaque fois répéter l'opération depuis le début.
Pour nouer un lacet avec un nœud, il faut apprendre au patient à croiser les lacets en formant un cercle en passant une extrémité du lacet à l'intérieur de ce cercle.
Leçon 7. Formation à l'utilisation des aides à l'habillage/déshabillage Utilisées pour les patients souffrant d'hémiparésie, de paraparésie, de polyarthrite rhumatoïde, d'amputation d'un des membres supérieurs.
Objectif : apprendre à utiliser un bâton avec un crochet.
Une démonstration d'enfilage de vêtements à l'aide d'un bâton est réalisée. Tout d'abord, le patient apprend à bien saisir le bâton, puis, en l'aidant, il saisit les vêtements et les enfile. Le patient tente alors de réaliser lui-même cette opération.
Objectif : apprendre à utiliser des appareils pour enfiler des collants et des chaussettes.
Utilisé pour les patients atteints de paraplégie inférieure.
Montrer au patient la séquence d'enfilage des collants et des chaussettes. Tout d'abord, les collants sont enfilés sur l'appareil situé sur les genoux, puis il est abaissé en le tenant par les rubans et tiré sur les jambes avec les collants mis dessus.
II. Méthodes d'enseignement des activités productives
Ces techniques sont utilisées pour enseigner le travail en cuisine aux patients en fauteuil roulant, aux patients souffrant d'hémiparésie, de polyarthrite rhumatoïde, de paraparésie et également de troubles mentaux mineurs.
1. Travailler en cuisine
L’objectif est d’enseigner la cuisine, l’alimentation et le ménage de manière indépendante.
Leçon 1. Introduction aux équipements de cuisine (meubles, électroménager, vaisselle)
Les patients qui ont des difficultés à se déplacer doivent apprendre à se déplacer activement dans la cuisine et doivent pouvoir accéder sans entrave aux équipements de cuisine.
Leçon 2. Règles de sécurité lors du travail en cuisine
Une conversation a lieu sur le fait que lors de l'utilisation d'appareils électriques, une attention et certaines connaissances sont nécessaires. Le patient doit se rappeler les règles suivantes :
- ne touchez pas un appareil électrique en état de marche avec les mains mouillées ;
- ne pas laisser ouverts longtemps les appareils allumés (réfrigérateur, four) ;
- remplissez la bouilloire électrique d'eau jusqu'au niveau spécifié et placez-la sur une surface plane pour la chauffer ;
- lorsque vous utilisez une clé pour ouvrir des canettes, veillez à ne pas vous blesser les mains avec la surface coupante ;
- lorsque vous travaillez avec de l'eau, pour éviter les blessures, veillez à ce que le moins d'eau possible soit projeté ;
- déplacer les récipients contenant de l'eau chaude avec une extrême prudence.
Leçon 3. Apprendre à utiliser les appareils de cuisine
Une conversation s'engage sur la destination des appareils électroménagers : cuisinière électrique, réfrigérateur,
bouilloire électrique, clé pour ouvrir les canettes. Démontrer et expliquer la fonction des compartiments réfrigérateurs, les règles de chargement ; faire correspondre le disque chauffant du poêle sélectionné à la poignée réglable enseigne l'utilisation correcte d'un ouvre-boîte. Ensuite, le patient est invité à effectuer de manière autonome telle ou telle action.
Leçon 4. Mise en table
Il est conseillé aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant d'utiliser des appareils pour déplacer la vaisselle sur les genoux ; si une moitié du corps est touchée, utiliser pour cela une table sur roulettes.
On explique et montre au patient comment mettre la table pour le petit-déjeuner, le déjeuner, etc. Ensuite, le patient essaie d'effectuer les actions nécessaires de manière autonome.
Leçon 5. Formation à la découpe d'aliments (pain, légumes) à l'aide d'appareils spéciaux
À l’aide d’une planche à découper munie de pointes, ils montrent comment couper des légumes bouillis et du pain. Le patient essaie alors d’effectuer ces actions de manière autonome. Si nécessaire, le patient utilise un couteau avec un manche adapté ou avec une dragonne.
Leçon 6. Apprendre à éplucher les légumes Expliquez la procédure :
- laver les légumes ;
- placer les légumes sur un dispositif permettant de les sécuriser ;
- nettoyer les légumes bouillis ;
- éplucher les crudités.
Ensuite, avec le patient, ils procèdent à l'exécution de ces actions.
Leçon 7. Formation à la préparation des salades Procédure :
- sélection des bons ingrédients ;
- laver les légumes ;
- éplucher les légumes ;
- trancher, hacher les légumes sur une râpe ;
- vinaigrette.
La préparation est réalisée conjointement avec le patient ou un groupe de patients.
Leçon 8. Sélection et formation à l'utilisation des couverts
En fonction des pathologies, les couverts sont sélectionnés : accessoires pour couteaux, fourchettes, cuillères, couverts à manches recourbés, dragonnes pour faciliter l'utilisation des couverts, bords d'assiettes, tapis en matériau antidérapant pour couverts, mugs à deux anses.
Au fil de plusieurs cours, un travail est réalisé sur l'enseignement de l'usage des couverts.
Leçon 9. Formation à la préparation de boissons chaudes
En fonction des pathologies, il est recommandé au patient de procéder à une certaine modification de la bouilloire (bouilloire électrique, bouilloire ordinaire de plus petit volume).
Procédure:
- remplissez la bouilloire d'eau ;
- livrez-le au poêle de manière pratique ;
- allumer soit la bouilloire électrique, soit la cuisinière ;
- préparer le thé à l'aide d'un appareil permettant de verser plus facilement du liquide chaud.
Leçon 10. Faire la vaisselle Le patient apprend :
- placer la vaisselle usagée dans l'évier d'une manière qui lui soit accessible ;
- nettoyer la vaisselle des résidus alimentaires ;
- utiliser une éponge ou une brosse à manche courbé ou épais pour laver la vaisselle ;
- mettre la vaisselle dans le placard.
2. Enseigner l'écriture
La technique est recommandée pour les patients souffrant d'hémiparésie, de paraparésie et de polyarthrite rhumatoïde. Objectif : apprendre au patient à écrire de manière autonome.
Leçon 1. Sélection des moyens techniques pour l'écriture
En fonction de la pathologie, le patient se voit proposer les dispositifs suivants : une dragonne, des attaches de différents diamètres, un dispositif de fixation d'un stylo, un support pour fixer le papier lors de l'écriture.
Étapes de préparation à l'écriture :
Leçon 2. Utiliser des pochoirs.
Leçon 3. Utilisation de modèles.
Leçon 4. Tracer des lignes de forme libre à l'aide d'une règle.
Leçon 5. Dessiner des figures de forme libre.
Leçon 6. Travailler avec des cahiers.
Leçon 7. Réécriture du texte.
Méthodes de développement des fonctions manuelles à l'aide de simulateurs
Cette technique (Fig. 1) est utilisée dans les hémiparésies, les paraparésies d'étiologies diverses et la polyarthrite rhumatoïde.
Cible:
- augmenter et maintenir l'amplitude de mouvement des articulations du poignet, du coude et de l'épaule ;
- contrôle indépendant de la bonne adhérence pendant le mouvement ;
- sélection significative de la forme de fente souhaitée.
Il est demandé au patient de relever la plaque à la hauteur possible. En utilisant la bonne prise, en tournant la main, il doit faire correspondre les fentes de la plaque avec les « branches d'arbre ». Avec des exercices répétés, vous devez augmenter la hauteur de « l'arbre » et la durée de la leçon.

La technique (Fig. 2) est indiquée en cas d'hémiparésie, de paraparésie d'étiologies diverses, de polyarthrite rhumatoïde et de troubles de la coordination des mouvements.
Cible:
- augmentation de l'amplitude de mouvement des articulations du poignet, du coude et de l'épaule ;
- contrôle de la coordination des mouvements.
Avant de commencer un cours, il est nécessaire de déterminer l'emplacement du simulateur pour un patient donné. Il est demandé au patient de placer doucement l'anneau sur le cône placé devant, à droite ou à gauche. Pour compliquer les mouvements, ils proposent de lancer l'anneau sur un cône.

La technique (Fig. 3) est utilisée pour les hémiparésies, les paraparésies d'étiologies diverses et pour les troubles de la sensibilité de surface.
Cible:
- saisir des objets de différentes tailles et formes ;
- être capable d'identifier un objet au toucher par sa forme.
Le patient met sa main dans un coffre en matériau opaque. Sans retirer votre main de la poitrine, vous devez nommer l'objet. Ensuite, vous devez retirer l'objet du coffre.

4. Mosaïque
La technique est utilisée pour l'hémiparésie, la paraparésie d'étiologies diverses et pour les troubles cognitifs.
Cible:
- saisissez les carreaux de mosaïque avec trois doigts ;
- être capable de dessiner un dessin selon le gabarit choisi.
Avant le cours, la taille des carreaux de mosaïque est sélectionnée individuellement pour chaque patient. Il est demandé au patient d'assembler d'abord un dessin plus simple, puis de passer à des dessins plus complexes.
La technique (Fig. 4) est indiquée chez les patients présentant une hémiparésie, une paraparésie d'étiologies diverses et des troubles cognitifs.
Cible:
- application de l'effort en fonction des mouvements effectués ;
- la capacité d'organiser indépendamment les composants du « tableau » en fonction de la période de l'année.
Le simulateur est un panneau auquel sont attachés des composants de différentes tailles (feuilles, champignons, herbe, etc.). Il est demandé au patient de se souvenir de l'emplacement des éléments constitutifs de l'image, puis de la reconstruire de mémoire.

Cette technique (Fig. 5) est utilisée dans les hémiparésies, les paraparésies d'étiologies diverses et la polyarthrite rhumatoïde.
Cible:
- le maître saisissant une pince à linge avec trois doigts ;
- apprendre à appliquer les forces appropriées des doigts pour vaincre la résistance du ressort de la pince à linge.
Il est demandé au patient de placer les pinces à linge sur un cercle plat en appliquant un certain effort. En cas de difficultés, il est d'abord recommandé d'utiliser un petit nombre de pinces à linge avec un ressort faible, puis de passer à des pinces à linge avec des ressorts plus forts. Augmentez progressivement le nombre de mouvements.

7. Roulette
La technique est utilisée pour l'hémiparésie, la paraparésie d'étiologies diverses et les troubles cognitifs.
Cible:
- entraînement à la dextérité des doigts ;
- entraînement à la mémoire et au comptage.
Il est demandé au patient de faire pivoter le dessus de la roulette et de coordonner les mouvements de la main pour qu'ils soient fluides. Cette leçon est indiquée pour être réalisée en groupe de patients, ce qui stimule la compétition. Celui qui marque le plus de points pendant la partie gagne.
La technique (Fig. 6) est indiquée pour l'hémiparésie, la paraparésie d'étiologies diverses, les troubles de la coordination des mouvements, les rhumatoïdes
polyarthrite.
Cible:
- amélioration de l'adhérence ;
Pour réaliser, on utilise : une planche percée de trous, des bâtons de comptage, des capuchons de feutres. Le patient doit insérer les bâtonnets de comptage dans les trous de la planche, puis mettre un capuchon sur chaque bâtonnet.

9. Cubes
La technique est utilisée pour l'hémiparésie, la paraparésie d'étiologies diverses et la polyarthrite rhumatoïde.
Cible:
- amélioration de l'adhérence ;
Le patient se voit proposer différents types de cubes : cubes simples, « Chiffres-lettres », « Contes de fées », « Animaux ». À l'aide de simples cubes, des cours sont dispensés pour augmenter l'amplitude de mouvement des membres supérieurs. Les cours peuvent se dérouler sur des plans de différentes hauteurs ; il est également demandé au patient de prendre des cubes des mains du thérapeute, qui peut faire varier la hauteur.
La technique (Fig. 7) est utilisée dans les hémiparésies, les paraparésies d'étiologies diverses et la polyarthrite rhumatoïde.
Cible:
L'activité consiste à déplacer des disques de différentes épaisseurs en demi-cercle. Ils commencent par transférer un disque plus épais, puis passent à des disques plus fins.

11. Légo
La technique est indiquée pour l'hémiparésie, la paraparésie d'étiologies diverses et la polyarthrite rhumatoïde.
Cible:
- amélioration de l'adhérence ;
- augmentation de la force musculaire des membres supérieurs.
Avant le début du cours, une sélection individuelle de la taille des composants du concepteur est effectuée. Pendant la leçon, le patient doit appliquer une force pour fixer les composants du jeu de construction. Tout d'abord, le patient travaille avec un jeu de construction composé de grandes pièces, assemblant une figurine selon le modèle le plus simple. Au fur et à mesure que la prise s'améliore, le patient utilise un jeu de construction composé d'éléments plus petits, augmentant ainsi la complexité de la figurine assemblée.
La technique (Fig. 8) est recommandée en cas d'hémiparésie, de paraparésie d'étiologies diverses, de troubles de la coordination des mouvements et de polyarthrite rhumatoïde.
Cible:
- augmentation de la force musculaire des membres supérieurs ;
- une meilleure coordination des mouvements ;
- amélioration de l'adhérence.
Le patient se voit proposer un échiquier avec du ruban adhésif collé à sa surface et un jeu d'échecs improvisé. Le patient doit « coller » les échecs sur l'échiquier, alors qu'il peut travailler avec une seule main ou alterner les mouvements des mains droite et gauche.

La technique (Fig. 9) est utilisée dans les hémiparésies, les paraparésies d'étiologies diverses et la polyarthrite rhumatoïde.
Cible:
- augmenter l'amplitude des mouvements des membres supérieurs ;
- amélioration de l'adhérence.
Le patient se voit proposer une planche avec un motif composé de formes géométriques découpées dans sa surface. Il doit tracer les contours de ces figures à l'aide d'un appareil spécial, en commençant par les plus simples. La durée du cours augmente progressivement.

La technique (Fig. 10) est recommandée en cas de troubles de la coordination des mouvements, de polyarthrite rhumatoïde, d'hémiparésie, de paraparésie.
Cible:
- une meilleure coordination des mouvements ;
- amélioration de l'adhérence.
Le patient se voit proposer des cupules transparentes en matériau léger. Il doit remplir son verre d’une substance en vrac, en se concentrant sur l’échantillon proposé ou sur les recommandations verbales du thérapeute. Ensuite, ils remplissent les gobelets avec le liquide coloré.

15. Châtaignes, boutons, céréales
Cible:
Avant le début des cours, chaque patient sélectionne le matériel avec lequel il travaillera. Le patient se voit proposer un « champ » avec des cellules qu'il doit remplir avec le matériel sélectionné. Au fur et à mesure que la préhension du patient s'améliore, il passe des châtaignes à des objets plus petits. La durée des cours augmente progressivement. Le patient peut effectuer des actions avec une seule main ou en alternant la droite et la gauche.
16. Perles, perles
Cette technique est utilisée pour l'hémiparésie, la paraparésie et la polyarthrite rhumatoïde.
Cible:
- amélioration de la motricité fine des mains.
Avant le cours, chaque patient sélectionne la taille du matériel avec lequel il travaillera. Il est demandé au patient d'enfiler d'abord des perles, puis des perles sur la ligne de pêche. À mesure que votre adhérence s'améliore, la durée de la leçon augmente.
La technique (Fig. 11) est indiquée dans les hémiparésies, paraparésies et polyarthrites rhumatoïdes.
Cible:
- amélioration de la motricité fine des mains ;
- préparation à l'apprentissage de la fixation.
Le patient se voit proposer des figurines en forme de poulets. La figurine se compose de deux parties : un bouton est cousu d'un côté, et une fente pour le bouton est réalisée de l'autre. Pour apprendre à boutonner, utilisez d’abord les gros boutons.

La technique (Fig. 12) est recommandée en cas de troubles de la coordination des mouvements, d'hémiparésie, de paraparésie, de polyarthrite rhumatoïde.
Cible:
- amélioration de la motricité fine des mains ;
- amélioration de la coordination des mouvements des membres supérieurs.
La technique est utilisée avant d'apprendre au patient à lacer ses propres chaussures. La leçon se déroule à l’aide d’une maquette de botte.

La technique (Fig. 13) est utilisée pour l'hémiparésie, la paraparésie,
polyarthrite rhumatoïde.
Cible:
- augmenter l'amplitude des mouvements des membres supérieurs ;
- amélioration de l'adhérence.
Avant le début du cours, un certain diamètre de cordon est sélectionné pour chaque patient. L'ensemble comprend un support auquel sont attachés des cordons. Le tissage se fait en croisant les cordons. Après avoir maîtrisé le tissage le plus simple, ils passent à la maîtrise du tissage des nœuds en macramé.

La technique (Fig. 14) est utilisée en cas de troubles de la coordination des mouvements, d'hémiparésie, de paraparésie et de polyarthrite rhumatoïde.
Cible:
- augmenter l'amplitude des mouvements des membres supérieurs ;
- amélioration de l'adhérence ;
- une meilleure coordination des mouvements.
Le patient se voit proposer un « terrain » et des quilles. Vous devez d'abord placer les quilles sur le terrain, puis les faire tomber à l'aide d'une balle attachée à un poteau.

21. Vis
La technique est indiquée en cas d'hémiparésie, de paraparésie, de polyarthrite rhumatoïde et de troubles de la coordination des mouvements.
Cible:
- amélioration de l'adhérence ;
- amélioration de la motricité fine des mains ;
- amélioration de la coordination des mouvements des membres supérieurs.
Le patient se voit proposer une planche avec des trous dans lesquels des vis sont insérées, puis des rondelles sont placées dessus et des écrous sont serrés. Le patient doit remplir tous les trous de la planche.
22. Architecte
Cette technique est utilisée pour l'hémiparésie, la paraparésie, la polyarthrite rhumatoïde et les troubles de la coordination des mouvements.
Cible:
- amélioration de l'adhérence ;
- amélioration de la coordination des mouvements des membres supérieurs ;
- augmentation de l'amplitude de mouvement des membres supérieurs.
Le patient se voit proposer un constructeur pour construire une ville selon le schéma proposé.
23. Pochoir
La technique est utilisée pour l'hémiparésie et la paraparésie.
Cible:
- amélioration de l'adhérence ;
Le patient reçoit des pochoirs représentant des animaux, des légumes et des insectes. Il doit tracer les contours des objets représentés. Il s’agit d’une étape préparatoire à l’apprentissage de l’écriture.
La technique (Fig. 16) est utilisée pour la polyarthrite rhumatoïde, l'hémiparésie, la paraparésie.
Cible:
- augmentation de l'amplitude de mouvement des membres supérieurs.
Un verre transparent sur pied est placé entre le patient et le thérapeute. Le thérapeute déplace le « papillon » le long de la surface du verre de son côté, et le patient essaie de répéter les mouvements du papillon avec sa main.

25. Sacs sur la cible
La technique est utilisée en cas de troubles de la coordination des mouvements, d'hémiparésie, de paraparésie et de polyarthrite rhumatoïde.
Cible:
- une meilleure coordination des mouvements ;
- amélioration de l'adhérence ;
- augmentation de l'amplitude de mouvement des membres supérieurs.
Le patient se voit proposer un champ sur lequel sont représentées des cibles numériques. Le patient doit toucher la cible à une certaine distance avec un sac rempli d'une substance granulaire, gagnant ainsi le nombre maximum de points.
Techniques de développement
Ce groupe de techniques est utilisé en cas d'altération des fonctions cognitives et corticales supérieures dues à des lésions organiques du système nerveux central, des maladies vasculaires du cerveau, des lésions traumatiques du système nerveux central et de la paralysie cérébrale.
1. Des énigmes
Cible:
- améliorer la concentration ;
Il est demandé au patient d'assembler une image selon un modèle donné à partir de composants de différentes tailles.
2. Apprendre à lire
Cible:
- entraînement de la mémoire ;
- développement de la pensée visuo-figurative.
Le patient se voit proposer un jeu de cartes avec des lettres et des cartes avec des images. Le patient doit apprendre à corréler les lettres avec l'image correspondante dans l'image, ainsi qu'à former des mots basés sur les images proposées.
3. Apprendre à compter
Cible:
- entraînement de la mémoire ;
- développement de la pensée visuo-figurative.
Le patient se voit proposer un jeu de cartes avec des chiffres et des signes arithmétiques et des cartes avec des images. Il doit être capable de faire correspondre les nombres avec le nombre d'objets indiqués sur les cartes illustrées. Une fois que le patient maîtrise les techniques de comptage, il lui est demandé d'effectuer des opérations arithmétiques simples à l'aide de cartes.
4. Métiers
Cible:
- développement de l'attention ;
- développement de la pensée visuo-figurative.
Le patient se voit proposer des cartes avec des images de représentants d'un certain nombre de professions et des cartes avec les attributs d'une profession particulière. Le patient doit corréler la profession avec ses attributs.
5. Pochoirs
Cible:
- entraînement de la mémoire ;
- développement de la pensée visuo-figurative.
Le patient se voit proposer des pochoirs représentant des légumes, des fruits, des animaux domestiques et sauvages et des insectes. Il faut lui apprendre à reconnaître l'objet représenté grâce au contour du pochoir.
Le but de la technique (Fig. 17) :
- développement d'une pensée visuelle et efficace. L'appareil est un jeu de construction composé de figures géométriques simples : 2
de grands triangles, 2 petits triangles, un carré, un triangle de taille moyenne et un parallélogramme. Le patient doit constituer une figure à partir de ces composants. À titre d'exemple, une version complexe est proposée (la figure est représentée sans division en ses éléments constitutifs) et une version plus simple (avec division en ses éléments constitutifs).

7. Cubes
Cible:
- développement de la concentration ;
- développement de la pensée visuelle et figurative.
Le patient se voit proposer deux types de cubes : les simples - « Animaux » et les intrigues - « Contes de fées ». Les cubes simples se composent de 9 éléments avec une conception simple, les cubes de tracé - de 20 éléments avec un grand nombre de petits détails de conception. Le patient doit plier les cubes selon un modèle donné.
8. Compter les bâtons
Cible:
- développement de la pensée visuo-figurative.
Pour les cours, des bâtons de 3 couleurs sont utilisés - rouge, bleu, vert. Ils sont nécessaires pour mémoriser les couleurs et apprendre à compter (chaque bâton signifie une unité). Les bâtons peuvent être utilisés pour résoudre des opérations arithmétiques simples.
9. Cartes Nikitine
Le but de la technique (Fig. 18) :
- développement de la pensée visuo-figurative ;
- développement de l'attention.
Pour la leçon, des cartes sur lesquelles sont représentées des formes géométriques (cercle, carré, triangle) sont utilisées. Figurines en 2 tailles (grande et petite), 4 couleurs (rouge, jaune, vert, bleu) :
- 4 grands cercles de toutes les couleurs ;
- 4 petits cercles de toutes les couleurs ;
- 4 grands triangles de toutes les couleurs ;
- 4 petits triangles de toutes les couleurs ;
- 4 grands carrés de toutes les couleurs ;
- 4 petits carrés de toutes les couleurs.
Il est demandé au patient de récupérer les cartes :
- par couleur ;
- en forme de figure géométrique ;
- selon la taille de la figure géométrique ;
- par taille et couleur ;
- en forme et en taille.

Correction des troubles de la sensibilité superficielle et profonde
La technique est utilisée en cas de violation de la sensibilité superficielle et profonde d'étiologies diverses pour augmenter l'amplitude des mouvements et la force musculaire, et améliorer la coordination.
Le but de la technique :
- améliorer la commande motrice volontaire, empêchant le développement de l'hémiparésie.
La technique est basée sur des techniques de soulagement neuromoteur. L'amélioration va des doigts à la colonne vertébrale (la main est considérée comme une unité fonctionnellement importante, en particulier le pouce).
Généralement, des simulateurs spéciaux sont utilisés pour corriger les troubles de la sensibilité dans le cadre de la technique :
1) pour les membres supérieurs ;
2) pour les membres inférieurs ;
3) appareils d'exercice universels pour les membres supérieurs et inférieurs.
Équipement d'exercice pour les membres supérieurs
Formateur 1(Fig. 19) est horizontal
panneau situé, à la surface duquel un bloc incurvé avec une échelle est installé à un certain angle. L'échelle de la barre correspond à 3 positions de la main : flexion maximale au niveau de l'articulation du poignet, flexion moyenne et lorsque la main est en extension complète au niveau de l'articulation du poignet. Le moniteur explique au patient la signification de ces positions, puis en nomme une, et le patient doit la reproduire les yeux fermés.

Formateur 2(Fig. 20) est représenté par un ensemble de tablettes spéciales, sur la surface de certaines il y a un grand motif tridimensionnel avec des bords clairement définis, d'autres - un petit motif. Grands dessins - les lettres "T" et "H" avec différentes épaisseurs des composants. Petits dessins - la lettre "H" et diverses lignes ondulées. Tout d'abord, le patient doit déterminer visuellement les différences entre les dessins, tout en traçant simultanément les contours des dessins avec l'index (les informations visuelles sont comparées aux informations sensorielles). Puis, avec l’aide d’un thérapeute, le patient trace les contours du dessin les yeux fermés et détermine son contenu au toucher.

Formateur 3(Fig. 21) est une planche horizontale sur laquelle se trouve un cadre vertical avec un trou pour le pouce et une échelle. Les divisions de l'échelle correspondent aux positions suivantes du pouce : abduction maximale, moyenne et minimale. L'instructeur explique au patient la signification de ces positions, puis en nomme une, et le patient, les yeux fermés, doit déplacer son pouce vers la position souhaitée.

Formateur 4(Fig. 22) est une planche horizontale sur laquelle se trouve un cadre vertical semi-circulaire avec une échelle comportant huit positions correspondant aux positions d'abduction de la main. Tout d'abord, trois positions principales sont sélectionnées, l'instructeur demande au patient d'amener le poignet dans l'une d'elles. Au fur et à mesure que le patient maîtrise ces positions, d’autres s’y ajoutent.

Formateur 5(Fig. 23) est une planche pivotante fixée à une surface horizontale. L'angle du plateau change. Pour déterminer l'angle d'inclinaison du patient, des barils métalliques de différents poids (6 pièces) sont utilisés. L'angle d'inclinaison de la planche correspond aux positions de la main - flexion et extension au niveau de l'articulation du poignet. Le thérapeute sélectionne d'abord trois positions principales (pour ce faire, il place un des fûts sous le bord libre de la planche) : flexion maximale au niveau de l'articulation du poignet, flexion moyenne et lorsque le membre est en extension complète au niveau de l'articulation du poignet. Le patient doit déterminer les positions indiquées par le thérapeute les yeux fermés. Au fur et à mesure que le patient maîtrise ces positions, le thérapeute propose trois positions intermédiaires de maîtrise.

Formateur 6(Fig. 24) se compose de deux plans verticaux de 60 cm de haut, fixés ensemble, sur l'un d'eux se trouve une échelle de 1 à 14. Sur l'autre il y a un dessin (lignes ondulées et brisées). Les premières positions de l'échelle plane correspondent aux positions de rotation de l'épaule. Dans un premier temps, le thérapeute invite le patient à maîtriser les positions qu'il sait réaliser. Le thérapeute nomme un chiffre sur la balance et le patient doit amener le membre dans cette position les yeux fermés. À mesure que l’amplitude de mouvement du membre augmente, l’instructeur utilise un deuxième plan vertical avec un motif. Le dessin est classiquement divisé en trois positions, le thérapeute nomme une position ou une autre et le patient y associe le membre.

Formateur 7(Fig. 25) est un plan horizontal sur lequel deux planches mobiles avec des charges de même poids sont fixées selon un certain angle. L'instructeur fixe un certain poids sur chacune des planches, et le patient, les yeux fermés, doit déterminer la différence de poids sur les planches en les touchant une à une avec son index.

Formateur 8(Fig. 26) est une flèche métallique fixée à une surface en bois. En face de la flèche, une feuille de papier avec un motif est placée dans un cadre spécial. Le motif peut être une ligne brisée, une ligne ondulée, etc. Le motif est divisé en trois positions qui correspondent aux positions de rotation des épaules. Le thérapeute nomme l'une ou l'autre position du dessin, et le patient, les yeux fermés, doit répéter la partie souhaitée du dessin.

Équipement d'exercice pour les membres inférieurs
Formateur 1(Fig. 27) se compose de deux planches verticales, entre lesquelles sont fixés des rouleaux en bois rotatifs, le long desquels se déplace une plaque horizontale. Sur l'une des planches verticales se trouve une échelle composée de trois positions correspondant aux positions de flexion du genou : flexion maximale, moyenne et minimale. Le thérapeute nomme telle ou telle position, et le patient, les yeux fermés, doit déplacer le membre dans la position souhaitée. Lors de la conduite d'une leçon, il est nécessaire que les deux jambes soient au même niveau, c'est pourquoi l'autre membre est placé sur un support spécial.

Formateur 2(Fig. 28) se compose de deux supports avec des ressorts à l'intérieur. Il est conçu pour apprendre au patient à transférer son poids d’une jambe à l’autre.

Formateur 3 similaire à l'appareil d'exercice 2, conçu pour les membres supérieurs (Fig. 20), mais dans ce cas l'échelle sur la poutre correspond à trois positions de flexion du tibia : maximale, moyenne et minimale.
L'instructeur nomme l'une des positions sur la balance et le patient, fermant les yeux, doit amener le membre dans la position souhaitée.
Formateur 4 similaire au simulateur 5 pour les membres supérieurs (Fig. 23), mais permet de déterminer la position de flexion du bas de la jambe. La procédure pour déterminer la position souhaitée est la même que lorsque l'on travaille avec un pinceau.
Formateur 5 similaire à l'appareil d'exercice 6 pour les membres supérieurs (Fig. 24), mais lorsqu'il est utilisé pour les membres inférieurs, il doit être installé horizontalement. Les graduations correspondent ici aux positions de flexion du genou. La procédure pour déterminer la position souhaitée est la même que pour travailler avec le membre supérieur.
Il convient de noter que la plupart des simulateurs ci-dessus ne sont pas compliqués d'un point de vue technique, ils peuvent être réalisés indépendamment.
Littérature
1. Actes du 6ème colloque ENOTHE 26.10.00 Paris ;
2. Documents du 6ème Congrès ERGO 2000 27-29.10.00 Paris ;
3. « Ergothérapie » Tanya L. Parker, Terry Krup, publication du projet de coopération russo-canadien dans le domaine de la santé et du développement social ;
4. « Ergothérapie » L. Pierquin, J-M. André, P. Farcy, Paris, New York, Barcelone, 1980 ;
5. «Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé». Projet final. Organisation mondiale de la santé 2001 ;
Limitation des activités de la vie
Limitation des activités de la vie (LLD)- perte totale ou partielle de la capacité ou de la capacité d'une personne à réaliser les éléments de base de la vie quotidienne.
Dans cette classification, les conséquences des maladies sont considérées sous forme de conditions séquentielles :
- maladie - pression interne ;
- troubles - manifestation externe de la maladie sous forme de troubles du corps ou de la structure anatomique ;
- AVQ - l'incapacité d'accomplir les éléments de base de la vie quotidienne (ou la capacité de l'accomplir seulement partiellement) ;
- incapacité sociale - une déficience dans laquelle une personne ne peut remplir que de manière limitée ou ne peut pas remplir du tout son rôle habituel dans la société (incapacité de vivre de manière indépendante - dépendance physique, incapacité à s'intégrer dans la société, incapacité à assurer son indépendance économique).
Principaux types de dysfonctionnements du corps humain
- Violations des fonctions mentales (perception, attention, mémoire, pensée, intelligence, émotions, volonté, conscience, comportement, fonctions psychomotrices).
- Troubles des fonctions du langage et de la parole
- Troubles de la parole orale (rhinolalie, dysarthrie, bégaiement, alalia, aphasie)
- Troubles de la parole écrite (dysgraphie, dyslexie)
- Troubles de la parole verbale et non verbale
- Troubles de la voix, etc.
- Fonctions sensorielles altérées (vision, audition, odorat, toucher, tactile, douleur, température et autres types de sensibilité).
- Violations des fonctions statiques-dynamiques (fonctions motrices de la tête, du torse, des membres, statique, coordination des mouvements).
- Violations des fonctions de circulation sanguine, respiration, digestion, excrétion, hématopoïèse, métabolisme et énergie, sécrétion interne, immunité.
- Troubles provoqués par une déformation physique (déformations du visage, de la tête, du torse, des membres, entraînant une déformation externe, ouvertures anormales des voies digestives, urinaires, respiratoires, perturbation de la corpulence).
Catégories et diplômes de l'OJD
Il existe quatre degrés de gravité des dysfonctionnements du corps humain :
- déficiences mineures (aucune restriction sur l'activité de la vie),
- déficience modérée (1er degré de handicap),
- déficiences sévères (2e degré de handicap),
- déficiences significativement prononcées (3e degré de handicap).
Capacité à prendre soin de soi
La capacité de prendre soin de soi est la capacité d’une personne à répondre de manière indépendante à ses besoins physiologiques de base et à effectuer les activités ménagères quotidiennes, y compris les compétences en matière d’hygiène personnelle.
1er degré - la capacité du libre-service avec un investissement de temps plus long, la fragmentation de sa mise en œuvre, la réduction du volume en utilisant, si nécessaire, des moyens techniques auxiliaires.
2ème degré - la capacité de prendre soin de soi avec l'aide partielle régulière des autres, en utilisant des moyens techniques auxiliaires si nécessaire.
3ème degré - incapacité à prendre soin de soi, besoin d'une aide extérieure constante et dépendance totale à l'égard d'autrui.
Capacité à se déplacer de manière autonome
La capacité de se déplacer de manière autonome est la capacité de se déplacer de manière indépendante dans l’espace, de maintenir l’équilibre du corps lors d’un mouvement, au repos et lors d’un changement de position du corps, et d’utiliser les transports publics.
1er degré - la capacité de se déplacer de manière autonome avec un investissement de temps plus long, une fragmentation de l'exécution et une réduction de la distance en utilisant, si nécessaire, des moyens techniques auxiliaires.
2ème degré - la capacité de se déplacer de manière autonome avec l'assistance partielle régulière d'autres personnes, en utilisant des moyens techniques auxiliaires si nécessaire.
3ème degré - incapacité à se déplacer de manière indépendante et besoin de l'aide constante des autres.
Capacité d'orientation
Capacité d'orientation - la capacité de percevoir correctement l'environnement, d'évaluer la situation, la capacité de déterminer l'heure et le lieu.
1er degré - la capacité de naviguer uniquement dans une situation familière de manière autonome et (ou) avec l'aide de moyens techniques auxiliaires.
2ème degré - la capacité de naviguer avec l'assistance partielle régulière d'autres personnes, en utilisant des moyens techniques auxiliaires si nécessaire.
3ème degré - incapacité à naviguer (désorientation) et besoin d'assistance constante et (ou) de surveillance d'autres personnes.
Aptitude à communiquer
La capacité de communiquer est la capacité d'établir des contacts entre des personnes en percevant, en traitant et en transmettant des informations.
1er degré - capacité à communiquer avec une diminution du rythme et du volume de réception et de transmission d'informations ; utiliser, si nécessaire, des aides techniques d'assistance ; avec des dommages isolés à l'organe de l'audition, la capacité de communiquer en utilisant des méthodes non verbales et des services de traduction en langue des signes.
2e degré - la capacité de communiquer avec l'aide partielle régulière d'autres personnes, en utilisant des moyens techniques auxiliaires si nécessaire.
3ème degré - incapacité à communiquer et besoin constant de l'aide des autres.
Capacité à contrôler votre comportement
La capacité de contrôler son comportement est la capacité d’avoir conscience de soi et d’adopter un comportement adéquat en tenant compte des normes sociales, juridiques, morales et éthiques.
1er degré - limitation périodique de la capacité à contrôler son comportement dans des situations de vie difficiles et (ou) difficulté constante à remplir des fonctions affectant certains domaines de la vie, avec possibilité d'autocorrection partielle.
2e degré - une diminution constante des critiques à l'égard de son comportement et de son environnement, avec possibilité de correction partielle uniquement avec l'aide régulière d'autres personnes.
3ème degré - incapacité à contrôler son comportement, incapacité à le corriger, besoin constant d'aide (supervision) de la part d'autres personnes.
Capacité d'apprendre
2e degré - capacité d'apprendre uniquement dans des établissements d'enseignement spéciaux (correctionnels) pour étudiants, élèves, enfants handicapés ou à domicile selon des programmes spéciaux utilisant, si nécessaire, des moyens techniques et technologiques auxiliaires.
3ème degré - trouble d'apprentissage.
Capacité de travail
Capacité de travail - la capacité d'effectuer un travail conformément aux exigences relatives au contenu, au volume, à la qualité et aux conditions de travail.
1er degré - la capacité d'exercer des activités professionnelles dans des conditions normales de travail avec une diminution des qualifications, de la gravité, de l'intensité et (ou) une diminution du volume de travail, l'incapacité de continuer à travailler dans la profession principale tout en conservant la capacité d'effectuer du travail activités de qualification inférieure dans des conditions normales de travail.
2ème degré - la capacité d'effectuer des activités professionnelles dans des conditions de travail spécialement créées avec l'utilisation de moyens techniques auxiliaires et (ou) avec l'aide d'autres personnes.
3ème degré - incapacité d'exercer une activité professionnelle ou impossibilité (contre-indication) de toute activité professionnelle.
voir également
Liens
- Arrêté du ministère de la Santé et du Développement social de la Fédération de Russie du 23 décembre 2009 N 1013n « Sur l'approbation des classifications et des critères utilisés dans la mise en œuvre de l'examen médical et social des citoyens par les institutions fédérales d'examen médical et social » et annexe .
Fondation Wikimédia. 2010.
Voyez ce qu'est « Limitation de l'activité vitale » dans d'autres dictionnaires :
Limitation des activités de la vie- perte totale ou partielle de la capacité ou de la capacité d'une personne à prendre soin d'elle-même, à se déplacer de manière autonome, à naviguer, à communiquer, à contrôler son comportement, à apprendre et à travailler. En fonction de la… … Terminologie officielle
invalidité- 3.2 handicap : Perte totale ou partielle de la capacité ou de la capacité d'une personne à prendre soin d'elle-même, à se déplacer de manière autonome, à naviguer, à communiquer, à contrôler son comportement, à apprendre et à s'engager... ...
Limitation des activités de la vie- perte totale ou partielle par une personne (personne handicapée) de la capacité ou de la capacité à prendre soin d'elle-même, à se déplacer de manière autonome, à naviguer, à communiquer, à contrôler son comportement, à apprendre et à travailler... Loi administrative. Dictionnaire-ouvrage de référence
LIMITATION DES ACTIVITÉS DE LA VIE Glossaire des termes sur les statistiques sociales
Limitation des activités de la vie- Perte totale ou partielle de la capacité ou de la capacité d'une personne à prendre soin d'elle-même, à se déplacer de manière autonome, à naviguer, à communiquer, à contrôler son comportement, à apprendre et à s'engager dans des activités professionnelles. Art. 1 fédéral... Vocabulaire : comptabilité, fiscalité, droit des affaires
LIMITATION DES ACTIVITÉS DE LA VIE- – perte totale ou partielle de la capacité ou de la capacité d'une personne à prendre soin d'elle-même, à se déplacer de manière autonome, à naviguer, à communiquer, à contrôler son comportement, à apprendre et à s'engager dans des activités professionnelles... Statistiques sociales. Dictionnaire
Limitation des activités de la vie- perte totale ou partielle de la capacité ou de la capacité d'une personne à prendre soin d'elle-même, à se déplacer de manière autonome, à naviguer, à communiquer, à contrôler son comportement, à apprendre et à travailler. La loi fédérale… … Dictionnaire des concepts juridiques
Limitation de l'activité humaine- – perte totale ou partielle de la capacité ou de la capacité d’une personne à prendre soin d’elle-même, à se déplacer de manière autonome, à naviguer, à communiquer, à contrôler son comportement, à apprendre et à s’engager dans des activités professionnelles. *... Glossaire de termes sur la pédagogie générale et sociale
limitation- 2.43 restriction : Situation dans laquelle un service (2.44) ne répond pas aux conditions de disponibilité spécifiées dans le contrat de service (2.45). Remarque Les restrictions peuvent être planifiées ou non. Source … Dictionnaire-ouvrage de référence des termes de la documentation normative et technique
GOST R 51079-2006 : Moyens techniques de réadaptation des personnes handicapées. Classification- Terminologie GOST R 51079 2006 : Moyens techniques de réadaptation des personnes handicapées. Classification du document original : [personnes handicapées] : Système de mesures médicales, psychologiques, pédagogiques, socio-économiques... Dictionnaire-ouvrage de référence des termes de la documentation normative et technique
Livres
- Intégration des écoles de peinture académiques et d'avant-garde : aspects pédagogiques, Bogustov Alexey Pavlovich. 80 pp. Cet ouvrage est une étude de l'État et des perspectives de développement de l'éducation artistique dans la période post-soviétique. Une étude est en cours sur quelques pratiques...
- Introduction à la Riskologie systémique, V. B. Zhivetin. La Riskologie systémique est une science dont la fonction est le développement et la systématisation théorique de connaissances objectives (fiables) sur les risques et la sécurité des activités du système... eBook
Selon la loi fédérale « sur la protection sociale des personnes handicapées dans la Fédération de Russie », une personne handicapée est une personne qui souffre d'un trouble de santé accompagné d'un trouble persistant des fonctions corporelles, causé par une maladie, les conséquences de blessures ou de défauts, entraînant à une activité vitale limitée et nécessitant sa protection sociale.
La limitation des activités vitales est une perte totale ou partielle de la capacité ou de la capacité d’une personne à prendre soin d’elle-même, à se déplacer de manière indépendante, à naviguer, à communiquer, à contrôler son comportement, à apprendre et à travailler.
Les infirmes, les aveugles, les sourds, les muets, les personnes ayant une coordination altérée des mouvements, complètement ou partiellement paralysées, etc. sont reconnus comme handicapés en raison d'écarts évidents par rapport à la condition physique normale d'une personne. Les personnes qui ne présentent aucune différence externe par rapport aux gens ordinaires, mais qui souffrent de maladies qui ne leur permettent pas de travailler comme le font les personnes en bonne santé, sont également reconnues comme handicapées. Par exemple, une personne souffrant d'une maladie coronarienne n'est pas capable d'effectuer un travail physique pénible, mais elle est tout à fait capable d'activité mentale.
Toutes les personnes handicapées sont réparties dans les groupes suivants pour diverses raisons :
- - par âge - enfants handicapés, adultes handicapés ;
- - origine du handicap : invalide depuis l'enfance, invalide de guerre, invalide du travail, invalide pour maladie générale ;
- - degré d'aptitude au travail - personnes handicapées du groupe I (incapables de travailler), personnes handicapées du groupe II (temporairement handicapées ou capables de travailler dans des zones limitées), personnes handicapées du groupe III (capables de travailler dans des conditions de travail bénignes) ;
- - nature de la maladie - personnes handicapées mobiles, à faible mobilité et immobiles.
En fonction de l'appartenance à un groupe particulier, les questions d'emploi et d'organisation de la vie des personnes handicapées sont résolues. Les personnes handicapées à faible mobilité (capables de se déplacer uniquement à l'aide de fauteuils roulants ou de béquilles) peuvent travailler à domicile ou dans des entreprises (à condition d'être transportées jusqu'à leur lieu de travail). Cette circonstance entraîne de nombreux problèmes supplémentaires, notamment : l'équipement du lieu de travail à domicile ou en entreprise, la livraison des commandes à domicile et des produits finis à l'entrepôt ou au consommateur, le matériel, les matières premières et l'approvisionnement technique, la réparation, l'entretien des équipements à domicile. , attribution de transport pour la livraison d'une personne handicapée vers et depuis le travail, etc.
La situation est encore plus compliquée avec les personnes handicapées immobiles et alitées. Ils ne peuvent pas se déplacer sans aide, mais sont capables de travailler mentalement.
Si une telle personne handicapée vit dans une famille, de nombreux problèmes peuvent être résolus relativement simplement. Et s'il est seul ? Il faut des travailleurs spéciaux qui trouveraient ces personnes handicapées, identifieraient leurs capacités, aideraient à recevoir les commandes, concluraient des contrats, achèteraient le matériel et les outils nécessaires, organiseraient les ventes de produits, etc. Il est clair qu'une telle personne handicapée a également besoin de soins quotidiens, en commençant avec la toilette du matin et se terminant par la fourniture de produits. Dans tous ces cas, les personnes handicapées sont aidées par des travailleurs sociaux spéciaux qui perçoivent un salaire.
La tâche principale consiste à empêcher un nouvel appauvrissement de ces couches les plus vulnérables de la société dans le contexte de la transition vers des relations de marché. À cet égard, la nécessité de réformer le système de retraite et les services sociaux apparaît au premier plan ; mise en place d'une visite médico-sociale, système de réadaptation des personnes handicapées, soins prothétiques et orthopédiques, soins hospitaliers et non hospitaliers pour retraités et personnes handicapées, etc.
Le système d'assistance sociale d'urgence aux personnes âgées et handicapées dans les conditions extrêmes de transition vers un marché et de leur adaptation aux conditions d'une économie de marché, un accompagnement social ciblé pour la vie de ces catégories de citoyens, devient important.
Un rôle de plus en plus important est accordé à l'amélioration du système d'assurance sociale publique, d'assurance sociale médicale avec la mise en place de garanties supplémentaires pour les personnes âgées et handicapées, ainsi qu'à la constitution de fonds de pension non étatiques.
Il est nécessaire d'améliorer le cadre juridique du système de protection sociale des personnes âgées et des personnes handicapées.
La création d'un système de protection sociale et d'accompagnement social pour les personnes âgées et handicapées dans les conditions modernes est une garantie nécessaire de leur réadaptation sociale et de la garantie d'activités de vie normales.
Critères d'évaluation du handicap dans les institutions de l'UIT
Introduction
Les transformations politiques et socio-économiques radicales survenues en Russie au cours de la dernière décennie ont conduit à des changements fondamentaux dans la politique sociale de l'État à l'égard des personnes handicapées et ont contribué à la formation de nouvelles approches pour résoudre les problèmes du handicap et de la protection sociale des personnes. handicapés.
Les principales dispositions de la politique de l'État concernant les personnes handicapées sont reflétées dans la loi fédérale « sur la protection sociale des personnes handicapées dans la Fédération de Russie » (n° 181 du 24 novembre 1995), qui contient de nouvelles interprétations des concepts de « handicap » et « personne handicapée », nouvelles positions pour la définition du handicap .
La mise en œuvre de cette loi a nécessité le développement d'une conception moderne du handicap, la création d'une nouvelle base méthodologique pour sa définition et son évaluation, ainsi que la transformation du service d'examen médical et du travail en un examen médico-social.
En 1997, les « Classifications et critères temporaires utilisés dans la mise en œuvre de l'examen médical et social » élaborés par les employés du CIETIN ont été publiés, approuvés par la résolution du ministère du Travail et du Développement social de la Fédération de Russie et du ministère de la Santé de la Fédération de Russie n° .1/30 du 29 janvier 1997, ainsi que des recommandations méthodologiques pour leur utilisation pour les employés des établissements d'examen médico-social et de réadaptation (Moscou, 1997, Institut central de recherche scientifique, numéro 16).
Dans la période 1997-2000. de nouvelles approches pour définir le handicap ont été largement introduites dans la pratique des institutions de l'UIT. Leur application pratique a montré les avantages significatifs des positions modernes d'expertise médicale et sociale pour améliorer la protection sociale des personnes handicapées.
Dans le même temps, la différence fondamentale entre les critères de l'examen médical et social et les critères de l'examen médical et du travail, le stéréotype de la pensée antérieure et certaines imperfections des nouvelles approches méthodologiques ont provoqué certaines difficultés dans le travail pratique du bureau de l'UIT.
En 1999-2000 Le personnel du CIETIN a étudié l'expérience initiale de l'application des « Classifications et critères temporaires utilisés dans la mise en œuvre de l'examen médico-social » dans la pratique de 72 bureaux de l'UIT des profils généraux et spécialisés de différentes entités constitutives de la Fédération de Russie et de tous les départements cliniques du CIETIN. , où les données des diagnostics experts de réadaptation de 654 personnes examinées
Les commentaires et suggestions formulés par des spécialistes des services de l'UIT et du personnel du CIETIN, ainsi que des représentants d'organisations publiques de personnes handicapées, des médecins d'établissements médicaux, des scientifiques d'instituts de recherche, etc. ont été soigneusement analysés et, en tenant compte d'eux, les ajustements nécessaires et des compléments ont été apportés aux concepts et classifications de base, aux critères et à la méthodologie d'évaluation des handicaps lors de la réalisation de l'examen médico-social, qui sont présentés dans ces lignes directrices.
1. Notions de base
1.1. Une personne handicapée est une personne qui présente un trouble de santé avec un trouble persistant des fonctions corporelles, provoqué par des maladies, des conséquences de blessures ou des défauts, entraînant une limitation de l'activité vitale et nécessitant sa protection sociale.
1.2. Le handicap est une insuffisance sociale due à un trouble de santé avec un trouble persistant des fonctions corporelles, entraînant une limitation des activités vitales et le besoin de protection sociale.
1.3.La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne se limite pas à l'absence de maladie et de déficiences physiques.
1.4.Affaiblissement de la santé - mal-être physique, mental et social associé à une perte, une anomalie, un trouble de la structure psychologique, physiologique, anatomique et (ou) de la fonction du corps humain.
1.5. Le handicap est un écart par rapport à la norme de l'activité humaine dû à un trouble de santé, caractérisé par une limitation de la capacité à prendre soin de soi, à se déplacer, à s'orienter, à communiquer, à contrôler son comportement, à apprendre, à travailler et à jouer ( pour les enfants).
1.6. Le handicap social est la conséquence sociale d’un trouble de santé, entraînant une limitation de l’activité vitale d’une personne et le besoin de sa protection ou de son assistance sociale.
1.7. La protection sociale est un système de mesures économiques, sociales et juridiques garanties par l'État qui offrent aux personnes handicapées les conditions nécessaires pour surmonter, remplacer et compenser les limitations dans les activités de la vie et qui visent à créer des chances égales pour elles de participer à la vie de la société. d'autres citoyens.
1.8. L'assistance sociale est une activité périodique et (ou) régulière qui contribue à éliminer ou à réduire le désavantage social.
1.9. Accompagnement social - activités ponctuelles ou occasionnelles de courte durée en l'absence de signes d'insuffisance sociale.
1.10. La réadaptation des personnes handicapées est un système de mesures médicales, psychologiques, pédagogiques et socio-économiques visant à éliminer ou éventuellement à compenser davantage les limitations des activités vitales causées par des problèmes de santé avec altération persistante des fonctions corporelles. L'objectif de la réadaptation est de restaurer le statut social d'une personne handicapée, d'atteindre l'indépendance financière et l'adaptation sociale.
1.11. Le potentiel de réadaptation est un ensemble de caractéristiques biologiques, psychophysiologiques et personnelles d'une personne, ainsi que de facteurs sociaux et environnementaux qui permettent, à un degré ou à un autre, de compenser ou d'éliminer ses limites dans la vie.
1.12. Le pronostic de réadaptation est la probabilité estimée de réaliser le potentiel de réadaptation.
1.13. Le pronostic clinique est une hypothèse scientifiquement fondée sur l'évolution future de la maladie, basée sur une analyse complète des caractéristiques cliniques et fonctionnelles du trouble de santé, de l'évolution de la maladie et de l'efficacité du traitement.
1.14. Conditions spécialement créées pour les activités de travail, ménagères et sociales - facteurs sanitaires et hygiéniques, organisationnels, techniques, technologiques, juridiques, économiques et microsociaux spécifiques qui permettent à une personne handicapée d'exercer des activités professionnelles, ménagères et sociales conformément à son potentiel de réadaptation.
1.15. Les lieux de travail spéciaux pour l'emploi de personnes handicapées sont des lieux de travail qui nécessitent des mesures supplémentaires pour organiser le travail, y compris l'adaptation des équipements de base et auxiliaires, des équipements techniques et organisationnels, des équipements supplémentaires et la fourniture de dispositifs techniques, en tenant compte des capacités individuelles des personnes handicapées.
1.1.16. Les moyens auxiliaires sont des outils, objets, dispositifs et autres moyens supplémentaires spéciaux utilisés pour compenser ou remplacer les fonctions corporelles altérées ou perdues et faciliter l'adaptation d'une personne handicapée à l'environnement.
1.17. Pleine capacité de travail – la capacité de travail est considérée comme pleine si l'état fonctionnel du corps répond aux exigences de la profession et permet d'effectuer des activités de production sans nuire à la santé.
1.18. La profession est un type d'activité professionnelle (profession) d'une personne qui possède un ensemble de connaissances, de compétences et d'aptitudes particulières acquises grâce à l'éducation, à la formation et à l'expérience professionnelle. La profession principale doit être considérée comme un travail de la plus haute qualification ou exercé sur une période plus longue.
1.19. Spécialité - un type d'activité professionnelle amélioré grâce à une formation spéciale ; un certain domaine de travail, des connaissances.
1.20. La qualification est le niveau de préparation, de compétence, le degré d'aptitude à effectuer un travail dans une certaine profession, spécialité ou poste, déterminé par le grade, la classe, le grade et d'autres catégories de qualification.
1.21. Aide et soins extérieurs constants
– la fourniture par une personne extérieure d'une assistance et de soins systématiques et constants pour répondre aux besoins physiologiques et quotidiens d'une personne.
1.22. La surveillance est une observation par une personne extérieure, nécessaire pour prévenir des actions qui pourraient nuire à la personne handicapée et à son entourage.
2. Classification des violations des fonctions de base du corps humain :
2.1. Troubles des fonctions mentales (perception, mémoire, pensée, intelligence, fonctions corticales supérieures, émotions, volonté, conscience, comportement, fonctions psychomotrices).
2.2. Troubles du langage et de la parole – troubles de la parole orale et écrite, verbale et non verbale qui ne sont pas causés par des troubles mentaux ; troubles de la formation de la voix et de la forme de la parole (bégaiement, dysarthrie, etc.).
2.3. Fonctions sensorielles altérées (vision, audition, odorat, toucher, fonction vestibulaire, tactile, douleur, température et autres types de sensibilité ; syndrome douloureux).
2.4. Violations des fonctions statiques-dynamiques (fonctions motrices de la tête, du torse, des membres, statique, coordination des mouvements).
2.5 Troubles viscéraux et métaboliques, troubles nutritionnels (circulation, respiration, digestion, excrétion, hématopoïèse, métabolisme et énergie, sécrétion interne, immunité).
2.6. Troubles défigurants (déformations structurelles du visage, de la tête, du torse, des membres, déformation externe sévère ; ouvertures anormales des voies digestives, urinaires, respiratoires ; perturbation de la corpulence : gigantisme, nanisme, cachexie, excès de poids).
3. Classification des violations des fonctions de base du corps humain selon leur gravité
Une évaluation complète de divers indicateurs qualitatifs et quantitatifs caractérisant une déficience persistante des fonctions corporelles permet d'identifier principalement quatre degrés de déficience :
1er degré - déficience fonctionnelle mineure
2ème degré - dysfonctionnement modéré
3ème degré - dysfonctionnement grave
4ème degré - dysfonctionnement significativement prononcé.
4. Classification des principales catégories d'activités de la vie et des limitations de l'activité de la vie selon le degré de gravité.
4.1. Capacité à prendre soin de soi- la capacité de satisfaire de manière indépendante les besoins physiologiques de base, d'effectuer les activités ménagères quotidiennes et les compétences en matière d'hygiène personnelle.
La capacité de prendre soin de soi est la catégorie la plus importante de la vie humaine, présupposant son indépendance physique dans l'environnement.
Les capacités de soins personnels comprennent :
satisfaction des besoins physiologiques de base, gestion des fonctions physiologiques ;
maintenir l'hygiène personnelle : laver le visage et tout le corps, laver et peigner les cheveux, se brosser les dents, couper les ongles, hygiène après les fonctions physiologiques ;
habiller et déshabiller les vêtements d'extérieur, les sous-vêtements, les chapeaux, les gants, les chaussures, à l'aide d'attaches (boutons, crochets, fermetures éclair) ;
manger : la capacité de porter la nourriture à la bouche, de mâcher, d'avaler, de boire, d'utiliser des couverts et des couverts ;
répondre aux besoins quotidiens du ménage : acheter de la nourriture, des vêtements et des articles ménagers ;
cuisiner : nettoyer, laver, couper les aliments, les cuire, utiliser les ustensiles de cuisine ;
utilisation du linge de lit et autre literie ; faire le lit, etc.;
laver, nettoyer et réparer le linge, les vêtements et autres articles ménagers ;
utilisation d'appareils et d'appareils électroménagers (serrures et loquets, interrupteurs, robinets, dispositifs à levier, fer à repasser, téléphone, appareils électroménagers et à gaz, allumettes, etc.) ;
nettoyer les locaux (balayage et lavage du sol, des vitres, essuyage de la poussière, etc.).
Pour réaliser la capacité de prendre soin de soi, l'activité intégrée de pratiquement tous les organes et systèmes du corps est nécessaire, dont les violations dans diverses maladies, blessures et défauts peuvent conduire à une limitation de la capacité de prendre soin de soi.
Les paramètres permettant d’évaluer les limitations de la capacité à prendre soin de soi peuvent être :
évaluation du besoin d'aides auxiliaires, possibilité de corriger la capacité de prendre soin de soi à l'aide d'aides auxiliaires et d'adaptation du logement ;
évaluation du besoin d'aide extérieure pour répondre aux besoins physiologiques et quotidiens ;
évaluation des intervalles de temps au cours desquels un tel besoin apparaît : besoin périodique (1 à 2 fois par semaine), intervalles longs (une fois par jour), courts (plusieurs fois par jour), besoin constant.
Limitation de la capacité à prendre soin de soi selon la gravité :
Diplôme I - capacité à prendre soin de soi avec l'utilisation d'aides.
La capacité d'effectuer en libre-service et d'effectuer de manière indépendante les actions ci-dessus à l'aide de moyens techniques, d'adaptation du logement et des articles ménagers aux capacités d'une personne handicapée est conservée.
Degré II – la capacité de prendre soin de soi avec l’utilisation d’aides et avec l’assistance partielle d’autres personnes.
La capacité de libre-service à l'aide de moyens techniques, d'adaptation du logement et des articles ménagers aux capacités d'une personne handicapée est conservée avec l'assistance partielle obligatoire d'une autre personne, principalement pour répondre aux besoins quotidiens (cuisine, achat de nourriture, vêtements et articles ménagers, laver le linge, utiliser certains appareils électroménagers, nettoyer les locaux, etc.).
Degré III – incapacité à prendre soin de soi et dépendance totale à l'égard d'autrui (besoin de soins, d'assistance ou de surveillance extérieurs constants). Capacité à répondre de manière indépendante à la plupart des besoins physiologiques et domestiques vitaux, même avec l'aide de moyens techniques et d'adaptation. de logement, est perdu, dont la mise en œuvre n'est possible qu'avec l'aide constante d'autres personnes.
4.2. Capacité à se déplacer de manière autonome– la capacité de se déplacer de manière autonome dans l’espace, de surmonter les obstacles, de maintenir l’équilibre corporel dans le cadre des activités quotidiennes, sociales et professionnelles.
La capacité de se déplacer de manière autonome comprend :
- déplacement autonome dans l'espace : marche sur terrain plat à une allure moyenne (4 à 5 km/h pour une distance correspondant aux capacités physiologiques moyennes) ;
- surmonter les obstacles : monter et descendre des escaliers, marcher sur un plan incliné (avec un angle d'inclinaison ne dépassant pas 30 degrés),
- maintenir l'équilibre du corps lors des mouvements, au repos et lors des changements de position du corps ; la capacité de se tenir debout, de s'asseoir, de se lever, de s'asseoir, de s'allonger, de maintenir la posture adoptée et de changer la position du corps (tours, flexion du corps vers l'avant, sur les côtés),
- effectuer des types de mouvements et de mouvements complexes : s'agenouiller et se lever des genoux, se déplacer sur les genoux, ramper, augmenter le rythme du mouvement (course).
- utilisation des transports en commun et personnels (entrée, sortie, déplacement à l'intérieur du véhicule).
La capacité de bouger de manière autonome est obtenue grâce à l'activité intégrée de nombreux organes et systèmes du corps : musculo-squelettique, nerveux, cardiorespiratoire, organes de la vision, de l'audition, appareil vestibulaire, sphère mentale, etc.
Lors de l’évaluation de la capacité de marche, les paramètres suivants doivent être analysés :
- la distance qu'une personne peut parcourir ;
rythme de marche (normalement 80 à 100 pas par minute) ;
coefficient de rythme de marche (normalement 0,94-1,0) ;
durée du double pas (normalement 1-1,3 sec)
vitesse de déplacement (normalement 4 à 5 km par heure) ;
besoin et capacité d’utiliser des aides auxiliaires.
Limitation de la capacité de se déplacer de manière autonome selon la gravité :
Diplôme I – la capacité de se déplacer de manière autonome grâce à l’utilisation d’aides avec un investissement de temps plus long, une fragmentation de l’exécution et une réduction de la distance.
La capacité de se déplacer de manière autonome est conservée lors de l'utilisation d'appareils d'assistance avec une diminution de la vitesse lors de l'exécution de mouvements et de mouvements, avec une limitation dans la capacité d'effectuer des types complexes de mouvements et de mouvements tout en maintenant l'équilibre.
Au premier degré, la capacité de mouvement se caractérise par une diminution modérée de la vitesse (jusqu'à 2 km par heure), du rythme (jusqu'à 50-60 pas par minute), une augmentation de la durée du double pas (jusqu'à 1,8-2,4 secondes), une diminution du coefficient de rythme de marche (jusqu'à 0,69-0,81), une réduction de la distance de déplacement (jusqu'à 3,0 km), une fragmentation de sa mise en œuvre (pauses tous les 500-1000 m ou 30-60 minutes de marche) et la nécessité d’utiliser des aides.
Degré II – la capacité de se déplacer de manière autonome avec l’utilisation d’aides et l’assistance partielle d’autres personnes.
La capacité de se déplacer de manière autonome et de se déplacer à l'aide d'appareils d'assistance, d'adapter le logement et les articles ménagers aux capacités d'une personne handicapée et d'impliquer une autre personne lors de l'exécution de certains types de mouvements et de mouvements (types de mouvements complexes, surmonter les obstacles, maintenir l'équilibre , etc.) est conservé.
Au deuxième degré - la capacité de se déplacer se caractérise par une diminution prononcée de la vitesse (moins de 1,0 km par heure), du rythme de marche
(moins de 20 pas par minute), augmentant la durée d'un double pas (moins de 2,7 secondes), diminuant le coefficient de rythmicité de la marche (moins de 0,53), la fragmentation de son exécution, réduisant la distance de déplacement principalement à l'intérieur de l'appartement s'il est nécessaire d'utiliser des aides et une assistance partielle d'autres personnes.
Degré III – incapacité de se déplacer de manière indépendante, ce qui n'est possible qu'avec l'aide d'autres personnes.
4.3. Capacité d'apprendre– la capacité de percevoir et de reproduire des connaissances (de formation générale, professionnelles, etc.) et de maîtriser des compétences et des capacités (professionnelles, sociales, culturelles, quotidiennes).
La capacité d'apprendre est l'une des formes de vie intégratives importantes, qui dépend avant tout de l'état des fonctions mentales (intelligence, mémoire, attention, clarté de conscience, pensée, etc.), de la préservation des systèmes de communication, orientation, etc. L'apprentissage nécessite également l'utilisation de la capacité de communiquer, de bouger, de prendre soin de soi, déterminée par les caractéristiques psychologiques de l'individu, l'état du système locomoteur, les fonctions viscérales, etc. La capacité d'apprendre est altérée dans les maladies de divers systèmes corporels. De tous les critères liés aux activités de la vie, les troubles d’apprentissage sont ceux qui revêtent la plus grande importance sociale pendant l’enfance. Cela équivaut à une altération de la capacité de travail chez l’adulte et constitue la cause la plus fréquente de handicap social chez l’enfant.
Les caractéristiques des activités éducatives comprennent :
contenu de la formation (obtention d'une éducation à un certain niveau et dans une certaine profession) ;
supports pédagogiques (y compris moyens techniques spéciaux pour la formation, équipements pour les lieux de formation, etc.) ;
le processus d'apprentissage, y compris les formes d'apprentissage (à temps plein, à temps partiel, à temps partiel, à domicile, etc.), les méthodes d'enseignement (en groupe, individuel, interactif, ouvert, etc.) ;
conditions d’apprentissage (en termes de gravité, d’intensité et de nocivité) ;
modalités d'études.
Lors de l’évaluation du degré de troubles d’apprentissage, les paramètres suivants doivent être analysés :
éducation, disponibilité de formation professionnelle;
volume de formation selon les normes éducatives générales ou spéciales de l'État ;
la possibilité d'étudier dans un établissement d'enseignement général ou dans un établissement d'enseignement correctionnel ;
modalités d'études (normatives-non normatives) ;
la nécessité d'utiliser des technologies spéciales et (ou) des supports pédagogiques.
le besoin d'assistance d'autres personnes (à l'exception du personnel de formation) ;
le niveau d'activité cognitive (mentale) d'une personne conformément à la norme d'âge ;
attitude envers l'apprentissage, motivation pour les activités d'apprentissage ;
la possibilité de contact verbal et (ou) non verbal avec d'autres personnes ;
état des systèmes de communication, orientation, notamment sensorielles, fonctions motrices du corps, etc. ;
l'état de coordination visuo-motrice pour maîtriser les techniques d'écriture, les compétences graphiques et les opérations de manipulation.
Troubles d'apprentissage par gravité
Je suis diplômé - la capacité d'apprendre, de maîtriser pleinement les connaissances, les compétences et les capacités (y compris l'obtention de toute éducation conformément aux normes éducatives générales de l'État), mais dans des conditions non standard, sous réserve d'un régime spécial du processus éducatif et (ou) en utilisant des moyens auxiliaires.
II degré – la capacité d'apprendre et d'acquérir des connaissances, des compétences et des aptitudes uniquement selon des programmes éducatifs spéciaux et (ou) des technologies éducatives dans des établissements d'enseignement et d'éducation spécialisés, avec l'utilisation d'aides et (ou) avec l'aide d'autres personnes (sauf pour le personnel enseignant).
Degré III – troubles d’apprentissage et incapacité à acquérir des connaissances, des compétences et des capacités.
4.4. Capacité de travail– un état du corps humain dans lequel l'ensemble des capacités physiques et spirituelles permet la mise en œuvre d'un certain volume et qualité d'activité de production (professionnelle).
La capacité de travailler comprend :
- La capacité d'une personne, en termes de ses capacités physiques, psychophysiologiques et psychologiques, à répondre aux exigences qui lui sont imposées par les activités industrielles (professionnelles) (en termes de complexité du travail, de conditions d'environnement de travail, de sévérité physique et neuro -tension émotionnelle).
- La capacité de reproduire des connaissances, des compétences et des capacités professionnelles particulières sous la forme d'un travail de production (professionnel).
- La capacité d'une personne à exercer des activités de production (professionnelles) dans des conditions de production normales et sur un lieu de travail normal.
- Capacité d'une personne à entretenir des relations sociales et professionnelles avec les autres personnes de l'équipe de travail.
Limitation de la capacité de travail selon la gravité
Diplôme I – la capacité d'exercer des activités professionnelles dans des conditions normales de production avec une réduction des qualifications ou une diminution du volume des activités de production ; incapacité d'exercer un travail dans la profession principale.
Diplôme II – capacité à effectuer des activités professionnelles
dans des conditions normales de production avec l'utilisation d'équipements auxiliaires, et (ou) sur un lieu de travail spécial, et (ou) avec l'aide d'autres personnes ;
dans des conditions spécialement créées.
III degré – incapacité ou impossibilité (contre-indication) de travailler.
4.5. Capacité d'orientation– capacité à être déterminé dans le temps et dans l’espace
La capacité d'orientation s'effectue par la perception directe et indirecte de l'environnement, le traitement des informations reçues et la définition adéquate de la situation.
La capacité d’orientation comprend :
- La capacité de déterminer l'heure en fonction des signes environnants (heure de la journée, période de l'année, etc.).
- La capacité de déterminer l'emplacement en fonction des attributs des repères spatiaux, des odeurs, des sons, etc.
- La capacité de localiser correctement les objets extérieurs, les événements et soi-même par rapport à des repères temporels et spatiaux.
- La capacité de se rendre compte de sa propre personnalité, de son image mentale, du schéma du corps et de ses parties, de la différenciation « droite et gauche », etc.
- La capacité de percevoir et de répondre de manière adéquate aux informations entrantes (verbales, non verbales, visuelles, auditives, gustatives, obtenues par l'odorat et le toucher), comprendre le lien entre les objets et les personnes.
Lors de l’évaluation des limitations d’orientation, les paramètres suivants doivent être pris en compte :
état du système d'orientation (vision, ouïe, toucher, odorat)
état des systèmes de communication (parole, écriture, lecture)
capacité à percevoir, analyser et répondre adéquatement aux informations reçues
la capacité de réaliser, d’identifier sa propre personnalité et les conditions temporelles, spatiales et environnementales externes.
Limitation de la capacité d’orientation selon la gravité :
Diplôme I - capacité d'orientation, sous réserve de l'utilisation d'aides.
La capacité de se situer dans le lieu, le temps et l'espace est conservée à l'aide de moyens techniques auxiliaires (principalement améliorant la perception sensorielle ou compensant sa déficience)
II degré – la capacité de naviguer, nécessitant l’aide d’autres personnes.
La possibilité de prendre conscience de sa propre personnalité, de sa position et de sa définition dans le lieu, le temps et l'espace ne subsiste qu'avec l'aide d'autres personnes en raison d'une diminution de la capacité à se comprendre soi-même et le monde extérieur, à se comprendre et à se définir adéquatement ainsi que son environnement. situation.
Degré III – incapacité à naviguer (désorientation) et nécessité d’une surveillance constante.
Une condition dans laquelle la capacité de s’orienter dans le lieu, le temps, l’espace et sa propre personnalité est complètement perdue en raison du manque de capacité à se comprendre et à s’évaluer soi-même et son environnement.
4.6. Aptitude à communiquer– la capacité d’établir des contacts entre des personnes en percevant, traitant et transmettant des informations.
Lors de la communication, l'interaction et l'interaction des personnes ont lieu, l'échange d'informations, d'expériences, de compétences et de résultats de performance a lieu.
Au cours du processus de communication, une communauté de sentiments, d'humeurs, de pensées et de points de vue de personnes se forme, leur compréhension mutuelle, leur organisation et leur coordination des actions sont atteintes.
La communication s'effectue principalement à travers les moyens de communication. Le principal moyen de communication est la parole, les moyens auxiliaires sont la lecture et l'écriture. La communication peut être effectuée à l'aide de symboles verbaux (verbaux) et non verbaux. Outre la préservation de la parole, la communication nécessite la préservation des systèmes d'orientation (audition et vision). Une autre condition de communication est l'état normal d'activité mentale et les caractéristiques psychologiques de l'individu.
Les capacités de communication comprennent :
la capacité de percevoir une autre personne (la capacité de refléter ses caractéristiques émotionnelles, personnelles et intellectuelles)
la capacité de comprendre une autre personne (la capacité de comprendre le sens et la signification de ses actions, actions, intentions et motivations).
La capacité d'échanger des informations (perception, traitement, stockage, reproduction et transmission d'informations).
- la capacité d'élaborer une stratégie d'interaction commune, comprenant l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la mise en œuvre du plan, avec d'éventuels ajustements si nécessaire.
Lors de l'évaluation des limitations de la capacité de communication, les paramètres suivants doivent être analysés, caractérisant principalement l'état des systèmes de communication et d'orientation :
capacité de parler (prononcer doucement des mots, comprendre la parole, prononcer et produire des messages verbaux, transmettre un sens par la parole) ;
capacité d'écoute (percevoir le discours oral, les messages verbaux et autres);
la capacité de voir, de lire (percevoir les informations visibles, les messages écrits, imprimés et autres, etc.) ;
capacité à écrire (encoder le langage en mots écrits, rédiger des messages écrits, etc.);
capacité de communication symbolique (communication non verbale) - comprendre les signes et symboles, les codes, lire des cartes, des diagrammes, recevoir et transmettre des informations à l'aide d'expressions faciales, de gestes, de graphiques, de visuels, de sons, de symboles, de sensations tactiles).
Possibilité de contacts avec un cercle de personnes élargi : membres de la famille, proches, amis, voisins, collègues, nouvelles personnes, etc.
Limitation de la capacité à communiquer par gravité
I degré – la capacité de communiquer, caractérisée par une diminution de la vitesse, une diminution du volume d'assimilation, de réception, de transmission d'informations et (ou) la nécessité d'utiliser des moyens auxiliaires.
La possibilité de communication demeure lorsque la vitesse (tempo) de la parole orale et écrite diminue, la vitesse d'assimilation et de transmission de l'information diminue de quelque manière que ce soit lors de la compréhension de son contenu sémantique.
II degré - la capacité de communiquer en utilisant des aides et l'aide d'autrui.
Il reste possible de communiquer en utilisant des moyens techniques et autres moyens auxiliaires qui ne sont pas typiques de l'établissement habituel de contacts entre des personnes et de l'assistance d'autres personnes pour recevoir et transmettre des informations et comprendre leur contenu sémantique.
Degré III - incapacité à communiquer et besoin d'une aide extérieure constante.
Condition dans laquelle le contact entre une personne et d'autres personnes est impossible, principalement en raison de la perte de la capacité de comprendre le contenu sémantique des informations reçues et transmises.
4.7. Capacité à contrôler votre comportement– la capacité de comprendre et de se comporter de manière appropriée, en tenant compte des normes morales, éthiques et socio-juridiques.
Le comportement est l’interaction inhérente d’une personne avec l’environnement, médiée par son activité externe (motrice) et interne (mentale). Lorsque le contrôle de son comportement est violé, la capacité d'une personne à se conformer aux règles et normes juridiques, morales et esthétiques officiellement établies ou établies dans une société donnée est violée.
La capacité de contrôler son comportement comprend :
La capacité de se comprendre soi-même, sa place dans le temps et dans l’espace, son statut social, son état de santé, ses qualités et propriétés mentales et personnelles.
La capacité d’évaluer ses propres actions, actions, intentions et motivations d’une autre personne avec une compréhension de leur signification et de leur signification.
La capacité de percevoir, de reconnaître et de répondre de manière adéquate aux informations entrantes.
Capacité à identifier correctement les personnes et les objets.
La capacité de se comporter correctement conformément aux normes morales, éthiques et socio-juridiques, de respecter l'ordre public établi, la propreté personnelle, l'ordre d'apparence, etc.
- La capacité d'évaluer correctement la situation, l'adéquation de l'élaboration et de la sélection des plans, la réalisation des objectifs, les relations interpersonnelles et l'exercice des fonctions de rôle.
- La capacité de changer de comportement lorsque les conditions changent ou que le comportement est inefficace (plasticité, criticité et variabilité).
- Capacité à comprendre la sécurité des personnes (comprendre le danger extérieur, reconnaître les objets pouvant causer des dommages, etc.)
- L’utilité d’utiliser des outils et des systèmes de signalisation pour gérer son propre comportement.
Lors de l'évaluation du degré de limitations de la capacité de contrôler son comportement, les paramètres suivants doivent être analysés :
présence et nature des changements personnels
degré de préservation de la conscience de son comportement
la capacité d'autocorrection, ou la possibilité de correction avec l'aide d'autres personnes, de correction thérapeutique ;
le sens de l’altération de la capacité à contrôler son comportement dans un ou plusieurs domaines de la vie (industriel, social, familial, quotidien) ;
durée et persistance des violations du contrôle de son comportement ;
étape de compensation du défaut de comportement (compensation, sous-compensation, décompensation) ;
état des fonctions sensorielles.