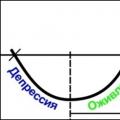Pour déterminer les dimensions du produit représenté (élément structurel, unité, bâtiment, structure) et de ses parties, utilisez les numéros dimensionnels imprimés sur le dessin. Les dimensions sur les dessins de construction sont appliquées conformément à GOST 2.307-68*, en tenant compte des exigences de GOST 21.501-93. Les lignes de cote et d'extension sont tracées sous la forme d'une ligne fine et continue d'une épaisseur comprise entre s/2 et s/3.
La ligne de cote à son intersection avec les lignes d'extension, de contour ou axiales doit être limitée par des empattements de 2 à 4 mm de long, d'épaisseur S, avec une pente de 45°, à partir de la ligne d'extension dans le sens des aiguilles d'une montre. Les lignes dimensionnelles doivent dépasser les extensions extérieures de 1 à 3 mm, les lignes d'extension au-delà des extensions dimensionnelles de 1 à 4 mm.
La distance minimale entre les lignes parallèles doit être d'au moins 8 mm et entre les premières lignes dimensionnelles et les lignes de contour d'au moins 10 mm.
Les numéros dimensionnels sur les dessins doivent être placés au-dessus de la ligne de cote, éventuellement plus près du milieu.
La pente de la surface sur les tronçons est indiquée par le signe « Ð ", et est appliqué avant le numéro de taille. La pointe pointue du panneau doit être dirigée vers la pente (voir Fig. 4). Sur les plans, la direction de la pente des plans est indiquée par une flèche au-dessus de laquelle, si nécessaire, est indiquée l'ampleur de la pente (voir Fig. 5).
| |
| |
| |
 |
| |
Les étiquettes directement liées à l'image ne peuvent contenir plus de deux lignes situées au-dessus et en dessous de l'étagère des lignes de repère. La ligne de repère, tirée des lignes du contour visible et invisible, se termine par une flèche. Les lignes de repère ne doivent pas se croiser, si possible, ne pas couper la ligne de cote et ne doivent pas être parallèles aux hachures.
Lors de la désignation d'un nœud, l'endroit correspondant est marqué sur le plan, la coupe ou la coupe par une ligne fine et continue fermée - un cercle, un ovale, etc. avec le noeud désigné par un chiffre arabe sur la tablette de la ligne de repère. Si le nœud est placé sur une autre feuille, alors le numéro de feuille est indiqué sous l'étagère de la ligne de repère, ou sur l'étagère à côté du numéro de nœud entre parenthèses (voir Fig. 11)
 |
|||||
 |  |
||||
La désignation du nœud est indiquée à l'endroit où le nœud est dessiné (voir Fig. 12).
 Si le nœud est affiché Si le nœud est affiché
Si le nœud est affiché Si le nœud est affiché
sur la même feuille sur une autre feuille
Numéro de nœud
12-15 Feuille sur laquelle le nœud est marqué
La partie texte placée sur le champ de dessin est placée au-dessus de l'inscription principale. Il n'est pas permis de placer des images ou des tableaux entre la partie texte et l'inscription principale. Les tableaux sont placés dans l'espace libre du champ de dessin à droite de l'image ou en dessous de celle-ci.
Axes de coordination
Chaque bâtiment et structure individuel se voit attribuer un système indépendant de désignation des axes de coordination.
Les axes de coordination sont des lignes mutuellement perpendiculaires qui déterminent la position sur le plan d'un bâtiment, d'une structure, de structures principales et enveloppantes. Les axes de coordination sont appliqués à l'image avec de fines lignes pointillées pointillées, à traits longs, d'épaisseur S/3, désignées par des chiffres arabes et des lettres majuscules de l'alphabet russe (à l'exception des lettres : Е, З, И, О, Х, Ц, Ш, Шч, Ъ, S, b) en cercles d'un diamètre de 6-12 mm.
Les lacunes dans les désignations numériques et alphabétiques (à l'exception de celles indiquées) des axes de coordination ne sont pas autorisées.
Les chiffres indiquent les axes de coordination du côté du bâtiment et de la structure avec un grand nombre d'axes.
Séquence de numérique et désignations de lettres les axes de coordination sont pris selon le plan de gauche à droite et de bas en haut (voir Fig. 13).
En règle générale, la désignation des axes de coordination est appliquée sur les côtés gauche et inférieur du plan du bâtiment et de la structure. Si les axes de coordination des côtés opposés du plan ne coïncident pas, les désignations des axes indiqués à leurs emplacements sont en outre appliquées sur les côtés supérieur et droit.

La taille de police pour indiquer les axes de coordination et les positions doit être d'un ou deux chiffres plus grands que la taille de police adoptée pour les nombres dimensionnels dans le même dessin.
Sur les plans des bâtiments d'habitation composés de tronçons d'îlots, les désignations des axes de coordination extrêmes des tronçons sont indiquées sans index conformément à la Fig. 14.
 Type 1 Type 2 Type 3
Type 1 Type 2 Type 3
Concepts de base
Sur les dessins d'architecture et de construction, les vues et les coupes ont les définitions suivantes :
a) plan d'étage - une coupe horizontale réalisée à 1/3 de la hauteur du sol ou au niveau des fenêtres ;
b) façade - vue avant, arrière, latérale, définissant une image visuelle d'un bâtiment ou d'une structure ;
c) coupe transversale - une coupe verticale réalisée à travers le bâtiment ;
d) coupe longitudinale - une coupe verticale réalisée le long du bâtiment.
La coordination de toutes les dimensions des bâtiments et de leurs structures est associée à un système de coordonnées modulaires. Ce système est un ensemble de règles pour la coordination mutuelle des dimensions des éléments d'aménagement de l'espace et structurels des bâtiments et des structures, des produits de construction et des équipements basés sur le module.
Un module est une unité de mesure conventionnelle utilisée pour coordonner les dimensions d'un bâtiment et d'une structure, de leurs éléments, pièces et produits de construction. Le module est classiquement désigné M et est égal à 100 mm. En plus du module principal, il existe des modules agrandis et fractionnaires. Le module agrandi est plus grand que le module principal d'un nombre entier de fois - 3M, 6M, 12M, 15M, 30M, 60M, 72M, 84M, 90M. Le module fractionnaire est plus petit que le module principal - 1/2M, 1/5M, 1/10M, 1/20M, 1/50M, 1/100M.
Les bâtiments sont construits sur la base de modules agrandis et reliés au terrain par des axes de coordination.
Le pas modulaire entre les axes longitudinaux est appelé travée.
Le pas modulaire entre les axes transversaux est appelé pas.
La hauteur modulaire est la distance entre le sol fini d'un étage donné et le sol fini du sol sus-jacent - la hauteur du sol.
En fonction de leur destination, les éléments de construction sont répartis dans les structures suivantes :
a) structures à cycle zéro - fondations, murs de sous-sol ;
b) structures d'enceinte - murs porteurs (recevant les charges des structures sus-jacentes et leur propre poids) et murs autoportants (recevant uniquement leur propre poids) ;
c) structures de sols et de revêtements – dalles de sol et de revêtement, sections monolithiques, sols, revêtements ;
d) structures internes - murs, cloisons, escaliers.
Selon le matériau, la destination et le chantier, les murs ont une certaine épaisseur.
Murs extérieurs en briques - (B) 510, 640, 770, 900, 1030, 1160.
Murs de briques internes - (B) 380, 250. Des fondations sont réalisées sous tous les murs, des axes de coordination les traversent.
Cloisons en briques - (B) 120, 65. Des dalles de béton spéciales sont utilisées sous les cloisons.
En fonction de la destination et de la capacité portante, les murs sont liés aux axes de coordination (voir Fig. 15).
DANSPour murs porteurs extérieurs Pour murs porteurs extérieurs
 murs autoportants
murs autoportants
Bouton pression central
Pour murs porteurs intérieurs
Les axes de coordination ne sont pas marqués sur les cloisons.
 L'épaisseur des murs en briques se compose de la taille de la brique (250x120x65) et de l'épaisseur du mortier (10). Ensuite, la taille des piliers et des ouvertures des murs de briques sera présentée comme le montre la Fig. 16.
L'épaisseur des murs en briques se compose de la taille de la brique (250x120x65) et de l'épaisseur du mortier (10). Ensuite, la taille des piliers et des ouvertures des murs de briques sera présentée comme le montre la Fig. 16.

C – largeur de l'ouverture de la fenêtre, h – hauteur de l'ouverture de la fenêtre, sont donnés dans le tableau 6, H – hauteur du sol – 2800, 3000, 3300, 3600, E – largeur de la porte, h – hauteur de la porte – Tableau 7, B – rapport de briques horizontal, D – multiplicité de briques verticales – dans le tableau 8.
Tableau 6
| Dimensions de coordination selon GOST, dm | Dimensions structurelles hхС, mm. | ||
| Bâtiments résidentiels et publics | |||
| 6 –9 | 610 x 910 | 15 – 9 | 1510 x 910 |
| 6 –12 | 610x1210 | 15 - 12 | 1510 x 1210 |
| 9 – 9 | 910 x 910 | 15 – 13.5 | 1510 x 1360 |
| 9 – 12 | 910 x 1210 | 15 – 15 | 1510 x 1510 |
| 9 – 13.5 | 910x1360 | 15 – 18 | 1510 x 1810 |
| 12 – 7.5 | 1210 x 760 | 15 – 21 | 1510 x 2110 |
| 12 – 9 | 1210 x 910 | 18 – 7.5 | 1810 x 760 |
| 12 – 12 | 1210 x 1210 | 18 – 9 | 1810 x 910 |
| 12 – 13.5 | 1210x1360 | 18 – 12 | 1810 x 1210 |
| 12 – 15 | 1210 x 1510 | 18 – 13.5 | 1810 x 1360 |
| 15 – 6 | 1510 x 610 | 18 – 15 | 1810 x 1510 |
| 15 – 7.5 | 1510 x 760 | 18 – 18 | 1810 x 1810 |
| Bâtiments publics (facultatif) | |||
| 12 – 18 | 1210 x 1810 | 21 – 9 | 2110 x 910 |
| 12 – 21 | 1210 x 2110 | 21 – 12 | 2110 x 1210 |
| 12 – 24 | 1210 x 2410 | 21 – 15 | 2110 x 1510 |
| 12 – 27 | 1210 x 2710 | 21 – 18 | 2110 x 1810 |
| 18 – 21 | 1810 x 2110 | 21 –21 | 2110 x 2110 |
| 18 – 24 | 1810 x 2410 | 21 – 24 | 2110 x 2410 |
| 18 – 27 | 1810 x 2710 | 21 – 27 | 2110 x 2710 |
Tableau 7
| Dimensions de coordination selon GOST 24698 - 81, dm | Dimensions de coordination selon GOST 6629 - 88, dm | Dimensions structurelles hxE, mm. | |
| Portes extérieures | Portes intérieures | ||
| 21 - 9 | 2070 x 910 | 21 – 7 | 2070 x 710 |
| 21 -10 | 2070 x 1010 | 21 – 8 | 2070 x 810 |
| 21 – 13 | 2070 x 1310 | 21 – 9 | 2070 x 910 |
| 21 – 15 | 2070 x 1510 | 21 – 10 | 2070 x 1010 |
| 21 – 19 | 2070 x 1910 | 21 – 12 | 2070 x 1210 |
| 24 – 10 | 2370 x 1010 | 21 – 13 | 2070 x 1310 |
| 24 –13 | 2370 x 1310 | 24 – 8 | 2370 x 810 |
| 24 – 15 | 2370 x 1510 | 24 – 9 | 2370 x 910 |
| 24 -19 | 2370 x 1910 | 24 – 10 | 2370 x 1010 |
| Portes de service | 24 – 12 | 2370 x 1210 | |
| 16 – 9 | 1570 x 910 | 24 – 15 | 2370 x 1510 |
| 19 –9 | 1870 x 9110 | 24 – 19 | 2370 x 1910 |
| 21 -13 | 2070 x 1310 |
Tableau 8
| B – grossissement horizontal | D – grossissement vertical | ||||||
2. RÉALISATION DE LA TÂCHE « MAISON RÉSIDENTIELLE »
Composition de la tâche pour la marque AR
1. Plan de construction
2. Volet architectural
4. Plan de toiture
5. Unités, remplissage des spécifications
Composition de la tâche pour la marque OB
1. Plan du bâtiment avec câblage
4. Schéma de câblage
Plan de construction
Le plan d'étage (d'un bâtiment) donne une idée de la composition spatiale du bâtiment, de l'emplacement des murs, colonnes et autres structures d'enceinte et porteuses, de leur connexion à la grille des axes de coordination, de l'emplacement des toutes les pièces à l'étage, leur destination, leurs dimensions, leur forme, ainsi que l'emplacement des escaliers, des fenêtres, des portes, des ouvertures techniques et leurs dimensions, l'emplacement des équipements, des voies ferrées, des équipements sanitaires.
Le plan d'étage est désigné : Plan en élévation. 0,000 ou à elev. +3.000, Plan du premier ou deuxième étage, Plan d'un étage type, Plan du sous-sol, Plan de l'étage technique et sont réalisés à l'échelle de M 1 : 100, M 1 : 200.
Les plans d'étage sont marqués par :
1) axes de coordination du bâtiment ;
2) les dimensions qui déterminent la distance entre les axes de coordination et les ouvertures, l'épaisseur des murs et des cloisons, les autres dimensions nécessaires, les repères des zones situées à différents niveaux ;
3) lignes de coupe, elles sont généralement tracées de telle manière que les ouvertures des fenêtres, des portails extérieurs et des portes tombent dans la coupe ;
4) positions (marques) des éléments de construction (structure), remplissage des ouvertures de portail et de porte, linteaux, escaliers, etc. Il est permis d'indiquer les désignations de position des ouvertures de portail et de porte dans des cercles d'un diamètre de 5 mm ;
5) désignation des nœuds et fragments de plans ;
6) le nom des locaux, leur superficie, les catégories de risque d'explosion et d'incendie (sauf pour les immeubles d'habitation). Les zones sont marquées dans le coin inférieur droit de la pièce et soulignées, si nécessaire, le type et la superficie des appartements sont indiqués sur les plans. Dans ce cas, la superficie est indiquée sous la forme d'une fraction dont le numérateur indique la surface habitable et le dénominateur indique la surface utile. Il est permis de donner les noms des locaux en explication (formulaire 1). Dans ce cas, sur les plans, leurs numéros sont mis à la place des noms.
Explication des locaux
Pour les bâtiments résidentiels, l'explication des locaux n'est généralement pas effectuée ;
7) limites des zones de mouvement des grues technologiques (si nécessaire).
Les plates-formes, mezzanines et autres structures situées au-dessus du plan de coupe sont représentées schématiquement par une fine ligne pointillée avec deux points.
Pour les plans d'étage :
1) liste des cavaliers selon le formulaire 2
2) spécifications pour les éléments de remplissage des fenêtres, portes et autres ouvertures, cloisons en panneaux, linteaux, marquées sur les plans, coupes et façades - selon le formulaire 3.
Liste des cavaliers
15 60 65 10 15 20
Remarque : dans la colonne « Pos », indiquez les positions (marques) des éléments structurels et des installations ; dans la colonne « Désignation » – désignation des principaux documents relatifs aux éléments de structure, équipements et produits ou normes enregistrés dans le cahier des charges ( spécifications techniques) sur eux; dans la colonne « Nom » - les noms des éléments structurels, des équipements, des produits et leurs marques ; dans la colonne « Quantité ». - quantité d'éléments ; dans la colonne « Masse » – masse en kilogrammes. Il est permis d'indiquer la quantité dans d'autres unités ; dans la colonne « Remarque » – informations supplémentaires.
Séquence de dessin d'un plan de bâtiment (Fig. 17) :
1. Dessiner une grille d’axes de coordination ;
2. Relier les murs extérieurs et intérieurs ;
3. Détails du dessin ;
4. Application des cotes et des inscriptions ;
5. Conception. (L'escalier est dessiné après aménagement de la coupe).
Les axes de coordination, les références et l'épaisseur des parois sont sélectionnés en fonction de la mission. Le plan du bâtiment est dessiné dans le coin inférieur gauche de la feuille (format A1). La désignation des axes de coordination est adoptée conformément à la clause 1.6. Au stade de la conception, une ligne principale pleine et épaisse montre les éléments tombant dans le plan de coupe. Remplissage des ouvertures de fenêtres et de portes, des équipements sanitaires et encastrés - avec une ligne fine et continue.
|
|
2.1.1 Séquence de placement des dimensions sur le plan du bâtiment.
1. En dehors des dimensions du plan d'étage, trois à quatre chaînes sont placées :
· 1ère, 2ème chaînes : liaison des piles et bords extérieurs des murs aux axes de coordination, dimensions des piles et des ouvertures. Pour les ouvertures avec quarts, les dimensions sont indiquées en fonction de la plus petite valeur d'ouverture ;
· 3ème chaîne : la distance entre tous les axes de coordination, liaison des axes des colonnes les plus extérieures ;
· 4ème chaîne : dimensions bâtiments ou dimensions entre les axes de coordination extrêmes.
La ligne de cote de la première chaîne de cotes est tracée à une distance suffisante du contour du plan pour laisser de la place pour l'apposition d'inscriptions et de marques explicatives et ne rend pas la lecture du plan difficile.
2. Les dimensions sont placées à l’intérieur du plan d’étage :
· relier les murs et cloisons aux axes de coordination ;
· épaisseur des murs et cloisons ;
· dimensions des locaux (largeur et longueur) ;
· dimensions des ouvertures dans les murs intérieurs et les cloisons fixes ;
· relier les ouvertures à des axes de coordination ou à des nœuds caractéristiques des murs.
Section architecturale
Selon la marque des dessins, les coupes peuvent être architecturales ou structurelles. Architectural– contenir des données sur la composition volumétrique générale de la solution. Ils contiennent des images simplifiées des éléments du sol du bâtiment sans détailler les structures des murs, des plafonds et des revêtements. Constructif– en plus de la solution d'aménagement de l'espace, ils contiennent des images de structures, des marquages de composants et d'éléments structurels, toutes les dimensions et élévations nécessaires. Les coupes sont tracées à l'échelle M 1:100 ; M1 : 200.
Les lignes de contour des éléments structurels de la coupe sont représentées par une ligne principale épaisse et continue, les lignes de contour visibles qui ne tombent pas dans le plan de coupe sont représentées par une ligne fine et continue.
Appliquer sur l'incision :
1) axes de coordination du bâtiment (structure), passant aux endroits caractéristiques de la section (extrêmes, au niveau des joints de dilatation, des structures porteuses, aux endroits de dénivelé, etc.), avec des dimensions déterminant la distance entre eux et le total distance entre les axes extrêmes ;
2) les marques caractérisant l'emplacement des éléments des structures porteuses et enveloppantes en hauteur ;
3) dimensions et références de hauteur des ouvertures, trous, niches et fentes dans les murs et cloisons ;
4) positions (marques) des éléments du bâtiment (structure) non indiquées sur les plans ;
5) désignation des nœuds et des fragments.
Séquence de réalisation de la coupe (Fig. 18) :
1. Implantation du dessin et construction d'une grille de coordination verticale.
2. Dessiner les principaux contours.
3. Dessiner l'escalier et les détails (Fig. 19).
4. Dimensions et conception graphique de la section.
Lors du dessin d'éléments, il convient de garder à l'esprit que le sol au sol est représenté par une ligne épaisse et continue, le sol au plafond et le toit par une ligne fine continue, quel que soit le nombre de couches de leur structure.
La composition et l'épaisseur des mots du sol et de la toiture sont indiquées dans l'inscription de l'extension.
|
Étape 1 Étape 2
Étape 3 Étape 4 1 - 1
Les plans sécants le long desquels les coupes sont effectuées sont désignés par des chiffres arabes ; ils peuvent être désignés par des lettres majuscules de l'alphabet russe. La numérotation des sections doit être continue pour une marque de dessins donnée.
2.2.1 Dessiner l'escalier.
L'escalier se compose de volées d'escaliers, de paliers et de clôtures. Les volées d'escaliers sont installées avec une pente de 1:2, 1:1,75, 1:1,5.
Les paliers d'escalier au niveau de chaque étage sont appelés paliers d'étage, et entre les étages sont appelés paliers intermédiaires. Chaque vol pour l'un des atterrissages sera ascendant, pour l'autre descendant. La marche ascendante commence par la marche inférieure de la frise, qui sert de transition vers la plate-forme, la marche descendante commence par la marche supérieure de la frise. Les marches de la frise ont une forme particulière, différente des autres marches de l'escalier (voir Fig. 19).
![]()
|
|
|
| |
|||||||||
 |
|||||||||
| Des marques de sol finies sont placées sur les paliers d’escalier. Après un calcul préalable du nombre de marches, en fonction de la hauteur du sol et de la largeur des paliers, des axes de coordonnées sont tracés, des murs sont dessinés et les niveaux des paliers (étages et intermédiaires) sont marqués par des lignes horizontales. Ensuite, la largeur des paliers de l'escalier ainsi que les marches de la frise et la longueur de la volée d'escalier sont disposées sur n'importe quelle ligne de coupe horizontale (seules les marches d'une longueur de 300 sont prises en compte). Ensuite, la longueur de la marche est divisée en fines lignes verticales espacées de 300. La hauteur entre la plate-forme au sol et la plate-forme intermédiaire est divisée en lignes horizontales, avec des intervalles de 150 (155). Nous obtenons une grille sur laquelle nous construisons des volées d'escaliers. La marche tombant dans la section est délimitée par une ligne principale solide et épaisse, et celle située dans le plan imaginaire est délimitée par une ligne fine et continue. Tous les sites sont délimités par une ligne épaisse et continue. Le plan de coupe le long des escaliers est toujours tracé le long des volées les plus proches de l'observateur. Dessiner la façade Les façades du bâtiment donnent une idée de apparence de la structure conçue et de sa composition architecturale. Au-dessus de la façade se trouve une inscription correspondante du type « Façade 1 – 5 » ou « Façade A – C » selon les axes extrêmes. Les façades sont réalisées à l'échelle M 1:100, M 1:200. Les façades peuvent être réalisées en graphismes linéaires, en noir et blanc ou en couleur, avec construction d'ombres. S'appliquent aux façades : 1) axes de coordination extrêmes sans indiquer la taille entre eux ; 2) les repères du rez-de-chaussée, des zones d'entrée, du haut des murs, du bas des ouvertures des fenêtres, des marquises d'entrée, des dalles de balcon ; 3) types de remplissage des ouvertures de fenêtres, si elles ne font pas partie des éléments des structures murales préfabriquées (non présentées dans les missions de formation) ; 5) type de matériau de finition pour les sections individuelles de murs qui diffèrent des sections principales (prédominantes) ; 6) escaliers extérieurs d'incendie et d'évacuation, galeries attenantes. Les documents sources pour l'aménagement et le dessin de la façade sont le plan et la coupe du bâtiment. Toutes les constructions préliminaires sont réalisées à l'aide de lignes fines. La séquence de construction est la suivante (Fig. 21) : 1. disposition générale - les dimensions du rectangle global de la façade sont déterminées à partir du plan et de la coupe, et une grille d'ouvertures de fenêtres et de portes y est construite ; 2. dessiner les principaux contours et détails - un affichage détaillé du remplissage des ouvertures de fenêtres et de portes, des éléments des auvents d'entrée, des clôtures des balcons et des loggias, de la ventilation et des cheminées, des dalles de parapet. Lignes de découpe de murs en blocs et panneaux ; 3. appliquer des marques et des tampons pour remplir les ouvertures des fenêtres (non indiqués dans les missions de formation) ; 4. conception graphique du dessin de la façade - construction d'ombres, réalisation de lavage ou de présentation graphique, décrivant l'image. Épaisseur du trait S – 0,8-1 pour le crayon, S – 0,4-0,6 pour l’encre. La ligne au niveau du sol a une épaisseur de 2S. Le type de matériaux de finition est indiqué par des symboles.
2.4 Dessiner un plan de toiture Les éléments suivants sont appliqués au plan de toiture : 1) axes de coordination ; les extrêmes, au niveau des joints de dilatation, le long des bords des sections de toit avec diverses structures et autres caractéristiques avec des références dimensionnelles à ces sections ; 2) désignation des pentes du toit ; 3) marques ou coupe schématique du toit (toit) ; 4) positions des éléments et dispositifs de la toiture (toit). Le plan du toit (toit) indique les joints de dilatation avec deux lignes fines, les dalles de parapet et d'autres éléments de la clôture du toit (toit), les entonnoirs, les déflecteurs, les puits de ventilation, les escaliers de secours et les entonnoirs de drainage. Le profil transversal du toit est représenté par un trait épais indiquant la pente. Pour un exemple de plan de toit, voir la Fig. 22.
©2015-2017 site |
Instructions
Décidez d’abord de l’échelle du dessin. En règle générale, ils ont des significations clairement structurées. Par exemple, les plans, les élévations et les coupes sont réalisés à l'échelle 1:50, 1:100, 1:200. Les sections de fondation sont généralement réalisées sur une échelle de 1 à 50, et les détails structurels de la figure sont représentés à 1:5, 1:10, 1:20 et 1:50. Les plans d'étage et les chevrons reçoivent une échelle de 1 à 100. Mais schémas de câblage sont généralement en corrélation avec les valeurs réelles de 1 à 100 ou de 1 à 200. Lors du déchiffrement des valeurs de taille, rappelez-vous qu'elles sont toutes inscrites en millimètres et que les marquages des niveaux de façades et de sections sont en mètres.
Lors de la lecture du dessin, notez que le plan du bâtiment est affiché sous forme de coupe horizontale. De plus, il doit passer par les ouvertures des fenêtres et des portes. Également sur le plan, vous pouvez voir une grille d'axes d'alignement. Ils sont désignés par des directions : celles qui longent le mur de façade - en chiffres arabes ; ceux situés sur le côté sont en lettres majuscules de l'alphabet russe.
Si vous constatez que certaines désignations sont situées derrière les dimensions du plan, elles indiquent généralement la distance entre les axes d'alignement extrêmes ; la distance entre les axes d'alignement fixés aux bords extérieurs du mur ; reliant les piles aux axes d'alignement, ainsi que les dimensions des piles et des ouvertures. Tout ce qui figure dans le plan est la connexion des murs intérieurs et des cloisons aux axes d'alignement ; l'épaisseur des murs et cloisons, ainsi que les dimensions des ouvertures dans les murs et cloisons intérieures ; tailles des trous dans les plafonds. N'oubliez pas que la somme des dimensions de chaque section peut être facilement calculée en utilisant la longueur du mur. Elle est son égale.

Les projections du bâtiment visibles de face, de derrière, de droite et de gauche le long du plan vertical constituent la façade. Les chiffres à l'extérieur de son contour sur le dessin indiquent les élévations par rapport au niveau du sol. Si vous voyez les axes des murs ou des colonnes sur le dessin de la façade, cela vous aidera à déterminer quel type de façade est représenté dans ce diagramme. Vous pouvez utiliser les sections du schéma pour déterminer les dimensions du bâtiment entre les axes extrêmes, quel est le niveau du sol, la distance d'étage à étage, la taille des ouvertures, la hauteur des ouvertures, les repères où se trouvent les escaliers. devrait être localisé.
Un dessin d'une maison sur un site vous permettra de déterminer comment planifier l'utilisation du site, où réaliser les entrées et les abords de la maison, comment planter et améliorer le territoire. Si vous souhaitez inclure vos idées dans le dessin, vous devrez alors les calculer exactement selon les normes du diagramme, puis les placer sur la zone dessinée, bien sûr, en respectant l'échelle requise.

Plan- il s'agit d'une image d'une section d'un bâtiment, disséquée par un plan horizontal imaginaire passant à un certain niveau (Fig. 10.3.1).
Selon GOST 21.501-93, ce plan doit être situé à 1/3 de la hauteur du sol représenté ou à 1 m du niveau représenté pour les bâtiments industriels. Pour les bâtiments résidentiels et publics, un plan de coupe imaginaire est situé à l’intérieur des ouvertures de portes et fenêtres de chaque étage.
Le plan du bâtiment donne une idée de sa configuration et de ses dimensions, révèle la forme et l'emplacement des pièces individuelles, les ouvertures des fenêtres et des portes, les murs principaux, les colonnes, les escaliers et les cloisons. Les contours des éléments de construction (murs, piliers, piliers, cloisons, etc.) inclus dans la coupe et situés au-dessous ou au-dessus du plan sécant sont dessinés sur le plan.
Généralement invisible éléments structurels non représenté sur les plans. Mais s'il est impossible de représenter cet élément comme visible sur d'autres dessins, il est représenté par des traits sur le plan. Dans ce cas, l'élément représenté peut être situé à la fois en dessous du plan de coupe (niche pour radiateurs de chauffage) et au-dessus (mezzanine) (Fig. 10.3.2). Les plans de construction montrent généralement les équipements sanitaires (baignoires, toilettes, lavabos, etc.). Si le bâtiment utilise le chauffage par poêles, l'emplacement des poêles, ainsi que les conduits de fumée et de ventilation, sont indiqués sur le plan. Ces canaux sont également représentés sur les plans des bâtiments équipés de chauffage central.
Les équipements sanitaires sont dessinés sur le plan du bâtiment à la même échelle que le plan du bâtiment ; les dimensions des équipements sanitaires les plus courants, ainsi que des cuisinières selon GOST 21.205-93, sont données sur la Fig. 10.3.3.

Les plans d'étage des bâtiments résidentiels et publics montrent parfois l'emplacement des meubles ou d'autres équipements (Fig. 10.3.4, a). Le plan des bâtiments industriels peut montrer l'emplacement des équipements technologiques qui influencent la solution de conception. Les contours des équipements sont dessinés à l'échelle (indiquant parfois des dimensions) et délimités par des lignes fines. Le nom de l'équipement est indiqué dans la légende dont les positions correspondent aux numéros marqués sur le plan.


Le plan d'aménagement des équipements technologiques peut être donné séparément (Fig. 10.3.4, b). Dans ce cas, les contours du plan sont dessinés avec des lignes fines de 0,2 à 0,3 mm d'épaisseur et les contours de l'équipement avec des lignes de 0,6 mm d'épaisseur. Les dimensions détaillées, les symboles graphiques et les inscriptions liés à la partie construction ne sont pas donnés sur ce plan. Sur les plans des bâtiments industriels, des lignes pleines d'une épaisseur de 0,4 à 0,6 mm représentent des voies ferrées à voie normale et étroite.
Les voies de grue, les ponts roulants, les ponts roulants, les canaux souterrains destinés aux lignes d'alimentation électrique, les canalisations sanitaires, etc., le plafond à dalles amovibles sont dessinés en lignes pointillées (Fig. 10.3.5). Si nécessaire, indiquez la zone de fonctionnement de la grue. Toutes ces images peuvent être accompagnées de notes explicatives.
Les plans des locaux d'habitation des bâtiments industriels montrent l'emplacement des armoires, cintres, bancs et autres équipements (Fig. 10.3.6).
Si les plates-formes et mezzanines des bâtiments industriels sont situées à une hauteur supérieure à 2 m du niveau du sol, elles sont représentées par des lignes pointillées croisées (voir Fig. 10.3.5) avec deux points.

Les extensions d'un bâtiment industriel ne peuvent pas être représentées sur le plan principal, se limitant à tracer des lignes de rupture (voir Fig. 10.3.5). Les locaux auxiliaires intégrés et attenants, les plates-formes, les mezzanines et certaines sections de bâtiments industriels peuvent être représentés schématiquement sur le plan, mais des dessins séparés sont ensuite réalisés pour ces éléments du plan, le plus souvent à plus grande échelle, et un lien vers ceux-ci les dessins sont donnés sur le plan principal (voir Fig. 10.3.6).
Si les plans d'étage ne diffèrent les uns des autres que par la disposition des sections individuelles des murs extérieurs, vous devez dessiner un plan pour un étage et placer les plans (rubans) des différentes sections des murs uniquement le long de son périmètre. Lorsqu'il y a des fenêtres à deux niveaux dans la pièce, le plan principal montre les ouvertures de l'étage inférieur. Des plans de sections de murs avec des ouvertures du deuxième niveau sont placés le long du périmètre du plan principal sous la forme de rubans séparés (Fig. 10.3.7). Lors de l'exécution de plans de bâtiments civils et industriels à petite échelle, les zones complexes doivent être représentées par fragments. Un fragment est une section distincte de n'importe quelle partie du plan, réalisée à plus grande échelle et avec dans une plus grande mesure détails. Toutes les dimensions et désignations nécessaires y sont appliquées. Sur les dessins en plan, la place qui sera donnée ultérieurement sur le fragment doit être indiquée par une accolade. Sur l'image à partir de laquelle le fragment est extrait, et à côté de celle-ci, le nom attribué au fragment est appliqué selon le type « Plan fragment 1 » (Fig. 10.3.8). L'inscription sur le plan peut indiquer la feuille sur laquelle il se trouve : « Fragment du plan 1, feuille 7 ». Dans les sections de plans détaillées par fragments, les dimensions privées ne sont pas indiquées. Dans de tels cas, ils sont limités aux principaux et aux principaux.
Les sections individuelles des plans qui ne peuvent pas être représentées de manière suffisamment détaillée à petite échelle et qui ne sont pas incluses dans les dessins fragmentaires sont représentées en détail ; des marquages de référence doivent leur être attribués sur les plans (Fig. 10.3.9). Pour les bâtiments résidentiels (locaux) de construction industrielle et non industrielle, des plans de sections individuelles réalisés à plus grande échelle peuvent être dessinés.
Les plans des maisons en coupe sont longs et dessinés à petite échelle, ils sont donc complétés par des dessins de plans en coupe.
La partie résidentielle se compose de plusieurs appartements avec différents nombres de pièces à vivre situés à proximité de l'escalier. Selon la position de la section sur le plan du bâtiment, elle porte un nom et un marquage appropriés. La section la plus externe est appelée section d'extrémité et est marquée T.
La section intermédiaire est appelée section ordinaire et est marquée P. Les types d'appartements, différant par la superficie, sont marqués A et B. Le nombre de pièces à vivre est indiqué par des chiffres. Ainsi, la section finale, composée d'un T1 appartement et trois appartements de deux pièces, porteront le marquage suivant : T-1A , 2B, 2B, 2B.

En figue. 10.3.10, et le plan d'un étage typique d'un immeuble résidentiel de cinq étages est présenté. L'objectif principal du plan est de donner idée générale sur la forme et la taille de la maison, le nombre de sections, la disposition des appartements et les caractéristiques techniques et économiques des appartements et des sections. En figue. 10.3.10b montre les sections T-1A, 2B, 2B, 2B.
Pour les bâtiments assemblés à partir de gros éléments (panneaux, gros blocs), des plans peuvent être établis sous forme de schémas d'implantation d'éléments de structures préfabriquées.
Généralement, les panneaux muraux sont livrés à chantier de construction avec unités de fenêtres et de portes installées. Dans ce cas, les dimensions des panneaux et des ouvertures ne sont pas indiquées sur le plan.

Il est permis de représenter schématiquement les panneaux sous forme de rectangles (Fig. 10.3.11).
En figue. 10.3.11, et le plan d'un étage typique d'un bâtiment à grands panneaux est montré.
Le plan d'un bâtiment résidentiel en panneaux est présenté sur la Fig. 10.3.11, b.
Sur le plan de ces bâtiments, des marques abrégées ou complètes de panneaux sont indiquées (H - panneaux muraux externes, B - internes, P - cloisons), les numéros d'étage, les marques de nœuds, la distance entre les axes de coordination.
Un exemple de conception graphique de la mise en page est donné dans la Fig. 10.3.11, ch.
Lorsque vous commencez à dessiner un plan, n'oubliez pas que l'image du plan du bâtiment doit être positionnée avec le côté long le long de la feuille. Il est recommandé de tourner le côté du plan correspondant à la façade principale du bâtiment vers le bord inférieur. de la feuille. Le plan du bâtiment sur la feuille doit être situé, si possible, de la même manière que sur le plan général. Il n’est pas permis de dessiner une image miroir du plan par rapport à sa position sur le plan directeur. Les plans de construction sont placés sur la feuille par ordre croissant de numérotation des étages, de bas en haut ou de gauche à droite.
Lors de la détermination de la composition des différents éléments du plan de construction, il convient de prendre en compte les dimensions appliquées et le marquage des axes de coordination. Par conséquent, le dessin en plan doit être situé à environ 75 à 80 mm du cadre en tôle. Dans des cas spécifiques, ces dimensions peuvent varier.
Après avoir déterminé l'emplacement du plan sur la feuille et son échelle, ils commencent à dessiner.
1. Les axes de coordination sont dessinés, d'abord longitudinaux, puis transversaux (Fig. 10.3.12, a). Ces axes sont des lignes géométriques classiques. Ils servent à relier le bâtiment à la grille de coordination de la construction et aux repères du plan directeur, ainsi qu'à déterminer la position des structures porteuses, puisque ces axes sont tracés uniquement le long des murs principaux et des colonnes. Dans certains cas, ils peuvent ne pas coïncider avec les axes de symétrie des murs.
En figue. 10.3.13 montre un exemple d'aménagement du deuxième étage d'un immeuble résidentiel.

Les axes de coordination des bâtiments et des structures sont dessinés sous forme de lignes pointillées avec de longs traits de 0,3 à 0,4 mm d'épaisseur. Il est permis, après avoir tracé le dessin, de laisser les axes uniquement aux intersections des murs. Sur les plans, les axes d'alignement sont repris au-delà du contour des murs et des murs
coup. Pour marquer les axes sur le côté d'un bâtiment qui en comporte un grand nombre, on utilise les chiffres arabes 1, 2, 3, etc. Le plus souvent, un plus grand nombre d'axes traversent le bâtiment.
Pour marquer les axes du côté du bâtiment qui en ont moins, utilisez les lettres de l'alphabet russe A, B, C, etc. En règle générale, les axes qui longent le bâtiment sont marqués de lettres. Dans ce cas, il est déconseillé d'utiliser les lettres : Ё, 3, И, О, X, Ц, Ш, Ш, ы, ь, Ъ. S'il n'y a pas assez de lettres de l'alphabet pour marquer les axes , il est permis de continuer à marquer avec des lettres doubles comme AA, BB, etc. .d. Les axes des éléments situés entre les axes d'alignement des principales structures porteuses peuvent être marqués de la fraction B/1, B/2, 1/1, 2/1, etc.

Dans ce cas, le numérateur indique la désignation de l'axe de coordination précédent et le dénominateur indique le numéro de série de l'axe supplémentaire dans la zone entre les axes de coordination adjacents (Fig. 10,3,14). Ces éléments sont des colonnes à colombages, des structures intégrées et des équipements installés.
Pour désigner les axes de coordination des sections d'îlots des bâtiments résidentiels, l'indice « c » est utilisé (Fig. 10.3.15, a).
Sur les plans des bâtiments résidentiels composés de sections d'îlots, des désignations sont appliquées aux axes de coordination extrêmes des sections d'îlots sans index (Fig. 10.3.15, b).
Le marquage commence de gauche à droite et de bas en haut. Les lacunes dans la numérotation de série et l'alphabet lors de l'utilisation de désignations de lettres ne sont pas autorisées. En règle générale, les cercles de marquage (leur diamètre est de 6 à 12 mm) sont situés sur les côtés gauche et inférieur des bâtiments (Fig. 10.3.16). Si l'emplacement des axes sur les côtés droit et supérieur du plan ne coïncide pas avec la répartition des axes sur les côtés gauche et inférieur, alors les axes de coordination sont marqués de tous les côtés du plan ou sur les deux côtés où se trouvent les axes de coordination. les axes ne coïncident pas (Fig. 10.3.17).
A l'image d'un élément lié à plusieurs axes de coordination, ces axes indiquent :
- lorsque le nombre d'axes de coordination n'est pas supérieur à trois - comme le montre la Fig. 10.3.18 ;
- lorsque le nombre d'axes de coordination est de trois ou plus - comme le montre la Fig. 10.3.19.
- s'il est nécessaire d'orienter l'axe de coordination auquel est rattaché un élément donné par rapport à l'axe voisin, la direction est indiquée par une flèche (Fig. 10.3.20).
2. Tracez des lignes fines (0,3-0,4 mm d'épaisseur) les contours des murs et colonnes principaux longitudinaux et transversaux externes et internes (voir Fig. 10.3.12, b).
Les murs, colonnes et autres éléments structurels extérieurs et intérieurs du capital sont liés aux axes de coordination, c'est-à-dire déterminer les distances du plan intérieur ou extérieur du mur ou de l'axe géométrique de l'élément à l'axe de coordination du bâtiment.
Dans les bâtiments comportant des murs porteurs longitudinaux et transversaux, le liage est réalisé conformément aux instructions suivantes.
Dans les murs porteurs extérieurs, l'axe de coordination passe du plan intérieur des murs à une distance égale à la moitié de l'épaisseur nominale du mur porteur intérieur (Fig. 10.3.21, Fig. 10.3.22, a), un multiple du module ou sa moitié. Dans les murs en briques, cette distance est le plus souvent prise égale à 200 mm, soit égale au module, soit 100 mm. Il est permis de tracer des axes de coordination le long du plan interne des murs extérieurs (Fig. 10.3.22, d). Si les éléments de plancher reposent sur le mur extérieur sur toute son épaisseur, l'axe de coordination modulaire est aligné avec le bord extérieur du mur (Fig. 10.3.22, c).

Dans les murs intérieurs, l'axe géométrique de symétrie est combiné avec l'axe de coordination (voir Fig. 10.3,21). Des dérogations à cette règle sont autorisées pour les murs d'escaliers et pour les murs comportant des conduits de ventilation.
Dans les murs extérieurs autoportants et rideaux, leur bord intérieur est souvent aligné avec l'axe de coordination (voir Fig. 10.3.22, d), mais si les panneaux de sol ou les revêtements pénètrent partiellement dans le mur ou le recouvrent complètement, alors l'alignement de coordination L'axe est aligné avec les bords extérieurs du revêtement ou des plafonds (Fig. 10.3.22, d).
Lors du support de poutres de pannes ou de fermes sur les pilastres internes des murs extérieurs, le bord intérieur du mur est considéré comme le bord du pilastre au niveau de la partie supérieure du mur (Fig. 10.3.22р b). Dans les murs en briques, il est possible d'ajuster la valeur de liaison en tenant compte de la taille de la brique.
Dans les bâtiments à ossature, le centre géométrique de la section du poteau de la rangée intérieure coïncide avec l'intersection des axes de coordination modulaires (Fig. 10.3.23, Fig. 10.3.24).
Dans les rangées extérieures de colonnes des bâtiments à ossature, l'axe de coordination peut passer par :
- le long du bord extérieur du poteau, si la barre transversale, la poutre ou la ferme chevauche le poteau ;
- à une distance égale à la moitié de l'épaisseur de la colonne intérieure, si les traverses reposent sur les consoles des colonnes ou si les panneaux de plancher reposent sur les consoles des traverses ;
- à une distance qui est un multiple du module ou la moitié de celui-ci du bord extérieur des colonnes dans un bâtiment à un étage avec de lourdes charges de grue (voir Fig. 10.3.24).
Les axes d'alignement modulaires, perpendiculaires à la direction des colonnes de la rangée extérieure, doivent être combinés avec l'axe géométrique des colonnes.
3. Dessinez les contours des cloisons avec des lignes fines (Fig. 10.3.12, c). Il convient de prêter attention à la différence dans la connexion des murs principaux externes et internes et des murs principaux et cloisons (Fig. 10.3.25, a, b, c).
4. Disposez les ouvertures des fenêtres et des portes et tracez les contours des murs principaux et des cloisons avec des lignes d'épaisseur appropriée (voir tableau 9.5.2).
La désignation symbolique des ouvertures de fenêtres et de portes avec et sans remplissage est représentée conformément à GOST 21.501-93. Lors de l'élaboration d'un plan à l'échelle 1:50 ou 1:100, s'il y a des quartiers dans les ouvertures, leur représentation symbolique est donnée sur le dessin.
Quart- il s'agit d'une saillie dans les parties supérieures et latérales des ouvertures des murs en briques, qui réduit le flux d'air et facilite la fixation des caissons (Fig. 10.3.26, a-c).
Lors du choix de l'épaisseur des lignes de contour, il convient de tenir compte du fait que les structures non porteuses, en particulier les contours des cloisons, sont délimitées par des lignes de moindre épaisseur que les murs principaux et les colonnes porteuses.
5. Dessinez des symboles pour les escaliers, les équipements sanitaires et autres, et indiquez également le sens d'ouverture des portes (Fig. 10.3.12, d). Sur les plans des bâtiments industriels, les axes des voies ferrées et des monorails sont marqués.
Lors de la réalisation de dessins de plans de bâtiment, la désignation graphique des fours ou des équipements sanitaires doit être dessinée à l'échelle adoptée pour le plan donné.

6. Appliquez des lignes d'extension, de cote et des cercles de marquage (Fig. 10.3.12, f).
La première ligne de cote, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des dimensions du plan, ne doit pas être située à moins de 10 mm du contour du dessin. Cependant, étant donné que les marques de divers éléments de construction sont souvent placées devant la première ligne de cote derrière les dimensions du plan, cette distance est augmentée jusqu'à 14-21 mm ou plus. Les lignes de cote suivantes sont espacées d'au moins 7 mm. Les dimensions qui dépassent les dimensions du plan sont le plus souvent appliquées sous la forme de « chaînes » tridimensionnelles ou plus (voir Fig. 9.5.5). Les cercles de marquage des axes de coordination sont placés à une distance de 4 mm de la dernière ligne de cote.


7. Entrez les dimensions requises, les marques d'essieux et autres éléments (voir Fig. 10.3.13). Les dimensions en plan indiquent les dimensions des locaux, l'épaisseur des murs, les cloisons, le raccordement des murs intérieurs aux axes de coordination, les cloisons aux murs intérieurs et extérieurs ou aux axes de coordination. Les dimensions des ouvertures dans les murs intérieurs, dans les cloisons en briques, ainsi que leur raccordement au contour des murs ou aux axes de coordination sont indiquées. Les dimensions des portes dans les cloisons ne sont pas indiquées sur le plan. Les dimensions des trous dans les murs et cloisons et leur alignement sont également indiqués, ou une référence est faite aux dessins correspondants. Sur les plans des bâtiments industriels, sont indiqués les pentes des planchers, les dimensions et l'alignement des canaux, bacs et drains installés dans la structure du plancher.


Derrière les dimensions du plan, généralement dans la première chaîne, à partir du contour du plan, se trouvent des dimensions indiquant la largeur des ouvertures des fenêtres et des portes, des piliers et des parties saillantes du bâtiment, les reliant aux axes. La deuxième chaîne contient la taille entre les axes des murs principaux et des colonnes. Dans la troisième chaîne, la taille est définie entre les axes de coordination des murs extérieurs extérieurs. Si les ouvertures sont situées à l'identique sur deux façades opposées du bâtiment, il est permis d'appliquer des cotes uniquement sur les côtés gauche et inférieur du plan. Dans tous les autres cas, les cotes sont placées de tous les côtés du plan. Sur les plans de bâtiments industriels, lorsque la même taille est répétée plusieurs fois, vous ne pouvez l'indiquer qu'une seule fois de chaque côté du bâtiment, et au lieu d'autres nombres dimensionnels, donner la taille totale entre les éléments extrêmes sous la forme du produit de le nombre de répétitions par la taille de répétition (voir Fig. 9.5.6 ). Les plans des bâtiments industriels indiquent également les types d'ouvertures de portails et de portes (en cercles d'un diamètre de 5 à 6 mm), les marques de linteaux et de traverses, le nombre de schémas de cloisons, etc. Si la superficie des locaux est indiquée sur le plan, alors il est préférable de placer le chiffre correspondant à sa taille dans le coin du dessin de chaque pièce, de préférence en bas à droite, et de le souligner. Les superficies des locaux sont le plus souvent indiquées sur les plans des bâtiments civils.

Lors de l'élaboration de plans de bâtiments constitués de gros blocs ou de panneaux, le nombre de dimensions en dehors du contour du plan diminue généralement. Le plus souvent, seules les dimensions entre tous les axes de coordination et entre les axes extrêmes sont indiquées (Fig. 10.3.12, a, b). La position des ouvertures des fenêtres et des portes est indiquée plus en détail sur les schémas de disposition des blocs ou des panneaux.

Lors de l'élaboration d'un dessin en plan, les chiffres et les lettres des marques d'essieux et les chiffres indiquant la superficie des locaux ou leurs marquages doivent être écrits dans une police plus grande que les polices dimensionnelles.
8. Effectuez les inscriptions nécessaires (voir Fig. 10.3.13).
Sur les plans des bâtiments industriels, est inscrit le nom des locaux ou des zones technologiques, indiquant la catégorie de production selon les risques d'explosion, d'explosion et d'incendie. Il est permis de placer les noms des locaux et les catégories de production en explication avec la numérotation des locaux sur le plan dans des cercles d'un diamètre de 6 à 8 mm. Le nom des locaux peut également être indiqué sur les dessins de plans de construction civile. Une inscription est faite au-dessus du dessin du plan. Pour les bâtiments industriels, il s'agira d'une indication du niveau du sol de la salle de production ou du site selon le type « Plan en élévation ». 2 350". Le mot « marque » est écrit en abréviation.
Pour les bâtiments civils, dans l'inscription vous pouvez écrire le nom de l'étage comme « Plan du 1er étage », ou « Plan du 3ème étage en axes 3-7 ». Pour les bâtiments à plusieurs étages, les plans sont établis séparément pour chaque étage. Mais si plusieurs étages ont la même disposition, dessinez alors un plan de l'un d'entre eux et l'inscription indique tous les étages qui ont une disposition similaire. Par exemple, « Plan des 2e et 3e étages ». Si le bâtiment est à un étage, l'étage n'est pas indiqué. L'inscription n'est pas soulignée.
Dans l’inscription principale, le nom des plans est écrit « Plan du sous-sol technique ».
9. Désignez les plans sécants des sections (voir Fig. 10.3.13). Des traces horizontales de plans de coupe imaginaires sont également dessinées sur les plans, qui sont ensuite utilisés pour construire des images de sections du bâtiment. Ces marques sont des traits ouverts épais (1 mm d'épaisseur) avec des flèches (Fig. 10.3.27). Si nécessaire, le plan imaginaire de la section peut être représenté par une ligne pointillée épaisse.
La direction des flèches, c'est-à-dire Il est recommandé de prendre la direction de la vue de bas en haut ou de droite à gauche. Toutefois, si nécessaire, vous pouvez choisir une autre direction. Les traits épais avec des flèches ne doivent pas traverser le contour du plan ni s'en approcher. En fonction de la position des chaînes dimensionnelles et de la charge de travail du dessin, elles peuvent être situées près du contour du plan ou derrière la chaîne dimensionnelle la plus extérieure (voir Fig. 10.3.13). Il convient d'éviter de couper le long de deux plans de coupe ou plus. Les plans sécants des coupes sont désignés par des lettres de l'alphabet russe ou des chiffres.
Les dessins des plans d'étage sont accompagnés des spécifications des éléments de structure (menuiserie, etc.) ; spécifications de l'équipement de garde-robe; explication des locaux (et dans l'explication pour les bâtiments résidentiels et publics, la colonne « Catégorie de production pour risque d'explosion, d'explosion et d'incendie » est exclue) ; des relevés de finition des locaux, dans lesquels le nombre de colonnes est déterminé par la présence d'éléments intérieurs à finir ; liste des ouvertures de portails et linteaux, etc. La forme et les dimensions des tables sont indiquées sur la Fig. 10.3.28 et fig. 10.3.29.

Si nécessaire, des plans peuvent également être réalisés but spécial. Ainsi, pour les éléments structurels des bâtiments industriels (Fig. 10.3.30), des plans d'installation des murs sont établis.
Les plans d'installation doivent montrer :
- axes de coordination du bâtiment, les distances entre eux et entre les axes extrêmes ;
- éléments structurels d'un bâtiment en référence à des axes ou structures de coordination et marquages ;
- ouvertures de fenêtres et de portes;
- escaliers dans un étage (schématiquement);
- désignations des plans de coupe des nœuds et des fragments ;
- marquages au sol (si les étages sont situés au même niveau, ils ne sont pas marqués) ;
- l'épaisseur des murs et des cloisons, leur raccordement aux axes de coordination ou aux surfaces des structures voisines.
Pour les bâtiments en briques ou en petits blocs, des plans de maçonnerie sont réalisés.
Les plans de maçonnerie doivent contenir :
- dimensions des ouvertures de fenêtres et de portes, des cloisons, les reliant aux axes d'alignement ou aux structures du bâtiment ;
- coupe transversale des colonnes, piliers et autres éléments ;
- emplacement et marquage des cavaliers ;
- trous, canaux, niches, rainures, cheminées, conduits de ventilation, ouvertures pour conduits de ventilation (sur le plan des combles) en référence aux axes de coordination ou aux structures du bâtiment.
Sur les plans de maçonnerie des bâtiments, les sections renforcées de murs ou de piliers sont également indiquées ou il est fait référence à des dessins de ferraillage. Pour les sections complexes du plan, des fragments doivent être développés. Les blocs de fenêtres et de portes ou les schémas de remplissage des ouvertures sont marqués sur les plans des bâtiments publics.
Le nom et la superficie des locaux sont indiqués sur le plan. Si la taille de l'image ne permet pas de faire une inscription sur le dessin, alors les pièces sont numérotées, et leurs noms et superficies sont indiqués dans une explication pouvant être combinée avec la liste des finitions des locaux. Les numéros de marquage sont placés dans des cercles d'un diamètre de 6 à 8 mm. Sur les plans des bâtiments publics, les linteaux sont marqués par le type et le nombre d'éléments inclus dans le linteau, ainsi que par leur emplacement dans la section transversale. Les données sur les cavaliers marqués sont données dans les déclarations.
Si nécessaire (en raison de la forte saturation de l'image), le plan des cavaliers peut être réalisé séparément.
Séparément pour les bâtiments résidentiels et publics, des plans de travaux de finition peuvent être établis. Ce plan indique la superficie des locaux, les marques des blocs-fenêtres et portes, des armoires encastrées, des mezzanines, etc. avec un plan d'installation ou de maçonnerie, et pour les bâtiments publics - avec un plan schématique. Avec des méthodes de finition simples, ces plans peuvent être combinés. Les dessins en plan sont accompagnés d'une fiche de finition des pièces.
5.10 Pour désigner les axes de coordination des sections d'îlots des bâtiments résidentiels, l'indice « c » est utilisé.
Exemple - 1s, 2s, Ac, Bs.
Sur les plans des bâtiments d'habitation composés de tronçons d'îlots, les désignations des axes de coordination extrêmes des tronçons d'îlots sont indiquées sans index conformément à la figure 3.

Dessin3
Application de cotes, pentes, repères, inscriptions
5.11 La ligne de cote à son intersection avec les lignes d'extension, les lignes de niveau ou les lignes centrales est limitée par des empattements sous forme de lignes principales épaisses de 2 à 4 mm de long, tracées avec une inclinaison vers la droite à un angle de 45° par rapport à la ligne de cote. de 1 à 3 mm.
Lors de l'application d'une cote de diamètre ou de rayon à l'intérieur d'un cercle, ainsi que d'une cote angulaire, la ligne de cote est limitée par des flèches. Les flèches sont également utilisées lors du dessin des dimensions des rayons et des congés internes.
5.12 Les marques de niveau (hauteurs, profondeurs) des éléments structurels, équipements, canalisations, conduits d'air, etc. à partir du niveau de référence (repère conventionnel « zéro ») sont indiquées par un symbole conforme à la figure 4 et indiquées en mètres avec trois décimales. séparé du nombre entier par une virgule.
La marque « zéro », généralement acceptée pour la surface de tout élément structurel d'un bâtiment ou d'une structure situé à proximité de la surface d'urbanisme du terrain, est indiquée sans signe ; marques au-dessus de zéro - avec un signe « + » ; en dessous de zéro - avec un signe « - ».
Sur les vues (façades), coupes et coupes, les repères sont indiqués sur les lignes d'extension ou les courbes de niveau conformément à la figure, sur les plans - dans un rectangle conformément à la figure 6, sauf dans les cas précisés dans les normes SPDS pertinentes.

Dessin4 Figure 5 Figure 6
5. 13 Sur les plans, la direction de la pente des plans est indiquée par une flèche au-dessus de laquelle, s'il y a lieu, l'ampleur de la pente est indiquée en pourcentage conformément à la figure 7 ou en rapport hauteur et longueur. (par exemple, 1:7).
Il est permis, si nécessaire, d'indiquer la valeur de la pente en ppm, sous forme de fraction décimale précise au troisième chiffre. Sur les dessins et schémas, le signe « ? ", dont l'angle aigu doit être dirigé vers la pente.
La désignation de la pente est appliquée directement au-dessus de la ligne de niveau ou sur l'étagère de la ligne de repère.
5.14 Les étiquettes pour les structures multicouches doivent être réalisées conformément à la figure 8.
5.15 Les numéros de position (marques d'éléments) sont placés sur les étagères des lignes de repère tirées d'images des composants de l'objet, à côté de l'image sans ligne de repère ou dans les contours des parties représentées de l'objet conformément à la figure 9.
Dans les images à petite échelle, les lignes de repère se terminent sans flèche ni point.
![]()
Dessin9
5.16 La taille de police pour indiquer les axes de coordination et les positions (marques) doit être un à deux chiffres plus grands que la taille de police adoptée pour les nombres dimensionnels dans le même dessin.
Les dimensions sur les dessins de construction sont appliquées conformément à GOST 2.307-68*, en tenant compte des exigences de GOST 21.101-97.
La base pour déterminer la taille du produit représenté et de ses éléments sont les numéros dimensionnels imprimés sur les dessins.
Arrêtons-nous sur les principales caractéristiques de l'application des cotes sur les dessins de construction :
1. La ligne de cote à son intersection avec les lignes d'extension, de contour ou centrales n'est pas limitée par des flèches, mais par des empattements en forme de segments de lignes principales de 2 à 4 mm de long, tracés selon un angle de 45 (en pente vers la droite) à la ligne de cote (Fig. 46).
Figure 46 - Disposition :
a) – empattements sur les lignes de cote ; b) – flèche de direction du regard
2. Non seulement les lignes d'extension doivent dépasser les lignes d'extension de 1 à 5 mm, mais elles doivent également dépasser les lignes d'extension extérieures de 1 à 3 mm (Fig. 47).
3. Il est permis de croiser une ligne de cote avec une ligne d'attache et d'autres lignes de cote.
4. Sur les dessins de construction, il est permis de répéter les dimensions du même élément, ainsi que d'appliquer des dimensions sous la forme d'une chaîne fermée. Rappelons ici que la distance entre le contour extérieur de l'image et la première ligne de cote doit être d'au moins 10 mm, et entre les lignes de cote parallèles d'au moins 7 mm (Fig. 47). Lorsque vous placez divers éléments de construction derrière les dimensions du plan, la distance entre la première ligne de cote et le contour du plan peut être augmentée jusqu'à 20 mm ou plus.

Figure 47 – Dimensions dans les dessins de construction
Sur les façades, les coupes et les coupes, des repères d'élévation des niveaux (hauteur, profondeur) d'un élément de construction ou d'une structure à partir de n'importe quel niveau de conception pris comme « zéro » sont appliqués. Les marques sont placées sur des lignes d'extension ou des lignes de contour et sont indiquées par un signe qui représente une flèche avec une étagère. La flèche est représentée comme un angle droit, reposant son sommet sur la ligne d'extension et ayant des côtés dessinés par les lignes principales (0,7-0,8 mm) à un angle de 45° par rapport à la ligne d'extension ou à la ligne de contour (Fig. 48). Le segment vertical, l'étagère et la ligne d'extension sont constitués d'une fine ligne continue (0,2-0,3 mm). Les marquages caractérisant la hauteur des niveaux sont indiqués en mètres avec trois décimales. Le plan à partir duquel les niveaux suivants prennent leur point de départ est appelé le niveau zéro et est désigné par une marque non signée - « 0,000 ». Les altitudes situées au-dessus du niveau zéro, qui est considéré comme le sol propre du premier étage, sont désignées par un signe plus (par exemple, +2,500), et les niveaux situés en dessous sont désignés par un signe moins (par exemple, - 0,800). ). Si près de l'une des images se trouvent plusieurs repères de niveau situés les uns au-dessus des autres, il est alors recommandé de placer les lignes verticales de repères avec des flèches sur la même verticale et de donner aux étagères la même longueur. Dans les images, les repères de niveau sont placés, si possible, dans une seule colonne. Les marques peuvent être accompagnées de notes explicatives, par exemple : Ur.ch.p.– niveau de plancher fini, Ur.z.– au niveau du sol (Fig. 48). Sur les dessins en plan, il est permis de marquer les élévations des bâtiments par des lignes de repère rectangulaires ou sur une étagère.

Figure 48 – Dessin de repères de niveau sur façades, profilés, profilés :
a) – dimensions de la marque de niveau ;
b) – des exemples d'emplacement et de conception des panneaux dans les images ;
c) – exemples de panneaux de niveau avec inscriptions explicatives.
4. Sur les dessins de construction, il est souvent nécessaire d'indiquer la valeur de la pente (tangente de l'angle de la pente - le rapport entre l'élévation et la fondation). La pente elle-même dans les dessins (sauf plans) est indiquée par le symbole « Ð », dont l'angle aigu doit être dirigé vers la pente et qui est appliqué directement au-dessus de la courbe de niveau ou sur l'étagère de la ligne de repère (Fig. .49). L'ampleur de la pente est indiquée par un nombre dimensionnel sous la forme d'une fraction simple ou d'une fraction décimale précise au troisième chiffre. Dans certains cas, la pente d'un élément (tige) est désignée par un triangle rectangle avec des branches verticales et horizontales dont l'hypoténuse coïncide avec l'axe ou la ligne de contour extérieure de l'élément représenté. La valeur absolue ou relative de leurs valeurs est indiquée au-dessus des jambes, par exemple 50 et 125.

Figure 49 – Exemples de dessin de la valeur de la pente
1. Règles d'établissement des dessins architecturaux et de construction (selon GOST 21.501-93) : mise en œuvre du plan de construction.
Informations générales.
Les dessins de base et d'exécution sont réalisés sous forme de dessins au trait, en utilisant des lignes de différentes épaisseurs, obtenant ainsi l'expressivité nécessaire de l'image. Dans ce cas, les éléments inclus dans la coupe sont mis en évidence par un trait plus épais, et les zones visibles au-delà de la coupe sont mises en évidence par un trait plus fin. La plus petite épaisseur des lignes tracées au crayon est d'environ 0,3 mm, à l'encre - 0,2 mm, l'épaisseur maximale des lignes est de 1,5 mm. L'épaisseur du trait est choisie en fonction de l'échelle du dessin et de son contenu - plan, façade, coupe ou détail.
Échelle les images des dessins doivent être sélectionnées parmi les séries suivantes : pour la réduction -1:2 ; 1:5 ; 1h10 ; 1h20 ; 1h25 ; 1h50 ; 1100; 1 : 200 ; 1 : 400 ; 1 : 500 ; 1 : 800 ; 1 : 1000 ; 1 : 2000 ; 1 : 5000 ; 1:10 000 ; pour le grossissement - 2:1 ; 10:1 ; 20:1 ; 50:1 ; 100:1.
Le choix de l'échelle dépend du contenu du dessin (plans, élévations, coupes, détails) et de la taille de l'objet représenté dans le dessin. Les plans, façades, coupes de petits bâtiments sont généralement réalisés à l'échelle 1:50 ; les dessins de grands bâtiments sont réalisés à une échelle plus petite - 1:100 ou 1:200 ; les très grands bâtiments industriels nécessitent parfois une échelle de 1:400 à 1:500. Les composants et parties de tout bâtiment sont fabriqués sur une échelle de 1:2 à 1:25.
Axes de coordination, lignes de cote et d'extension. Les axes de coordination déterminent la position des éléments structurels du bâtiment, les dimensions des marches et des travées. Les lignes axiales sont tracées avec une fine ligne pointillée avec de longs traits et sont marquées par des marques placées en cercles.
Sur les plans de construction, les axes longitudinaux sont généralement placés à gauche du dessin et les axes transversaux sont situés en dessous. Si l'emplacement des axes des côtés opposés du plan ne coïncide pas, alors leurs marquages sont placés de tous les côtés du plan. Dans ce cas, la numérotation est continue. Les axes transversaux sont marqués de chiffres arabes ordinaux de gauche à droite, et les axes longitudinaux sont marqués de lettres majuscules de l'alphabet russe (sauf E, Z, J, O, X, Y, E) en bas vers le haut.
Le diamètre des cercles doit correspondre à l'échelle du dessin : 6 mm - pour 1:400 ou moins ; 8 mm - pour 1:200-1:100 ; 10 mm - pour 1:50 ; 12 mm - pour 1:25 ; 1h20 ; 1h10..
La taille de la police pour désigner les axes doit être 1,5 à 2 fois plus grande que la taille de la police des nombres dimensionnels utilisés dans le dessin. Le marquage des axes sur les coupes, façades, composants et pièces doit correspondre au plan. Pour appliquer des cotes, des lignes de cote et d'attache sont tracées dans le dessin. Les lignes de cote (externes) sont tracées en dehors du contour du dessin à raison de deux à quatre selon la nature de l'objet et le stade de conception. Sur la première ligne du dessin sont indiquées les dimensions des plus petites divisions, sur les suivantes - les plus grandes. La dernière ligne de cote indique la taille totale entre les axes extrêmes, ces axes étant liés aux bords extérieurs des murs. Les lignes de cote doivent être tracées de manière à ce que le dessin lui-même ne soit pas difficile à lire. Sur cette base, la première ligne est tracée à une distance du dessin d'au moins 15 à 21 mm. La distance entre les lignes dimensionnelles est de 6 à 8 mm. Les segments sur les lignes de cote correspondant aux dimensions des éléments de murs extérieurs (fenêtres, piliers, etc.) sont limités par des lignes d'extension, qui doivent être tracées à partir d'une courte distance (3-4 mm) du dessin, jusqu'à ce qu'elles croisent le ligne de cote. Les intersections sont enregistrées avec des encoches ayant une pente de 45°. Pour les petites dimensions très rapprochées dans les dessins de pièces et d'assemblages, les empattements peuvent être remplacés par des points. Les lignes de cote doivent dépasser les lignes d'extension extérieures de 1 à 3 mm.
Les lignes de cotes intérieures indiquent les dimensions linéaires des pièces, l'épaisseur des cloisons et des murs intérieurs, la largeur des ouvertures de portes, etc. Ces lignes doivent être tracées à une distance suffisante des bords intérieurs des murs ou des cloisons pour ne pas faire de dessin difficile à lire.  Règles d'élaboration des dessins en plan conformément aux exigences de l'ESKD et du SPDS (dessin schématique) : a - axes de coordination ; b - lignes de cote ; lignes de leader ; g - superficie des locaux ; d - lignes de coupe (les dimensions sont données en millimètres).
Règles d'élaboration des dessins en plan conformément aux exigences de l'ESKD et du SPDS (dessin schématique) : a - axes de coordination ; b - lignes de cote ; lignes de leader ; g - superficie des locaux ; d - lignes de coupe (les dimensions sont données en millimètres).
Les lignes de cote et d'extension sont tracées avec une fine ligne continue. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres sans désignation de dimension. Les nombres sont placés au-dessus de la ligne de cote parallèle à celle-ci et, si possible, plus près du milieu du segment. La hauteur des chiffres est choisie en fonction de l'échelle du dessin et doit être d'au moins 2,5 mm lorsqu'ils sont réalisés à l'encre et 3,5 mm lorsqu'ils sont réalisés au crayon. ^
Repères de niveau et pentes. Les marques déterminent la position des éléments architecturaux et structurels sur les coupes et les façades, ainsi que sur les plans - en présence de différences de niveaux de sol. Les marques de niveau sont comptées à partir d'un niveau zéro conventionnel, qui, pour les bâtiments, est généralement considéré comme le niveau de l'étage fini ou le bord supérieur du premier étage. Les marques en dessous de zéro sont indiquées par un signe « - », les marques au-dessus de zéro sont indiquées sans signe. Valeur numérique les marques sont placées en mètres avec trois décimales sans indiquer la dimension. 
Règles d'application des marques, dimensions et autres désignations sur les sections conformément aux exigences de l'ESKD et du SPDS (dessin schématique). Pour indiquer un marquage sur les façades, les coupes et les profilés, utiliser un symbole en forme de flèche dont les côtés sont inclinés par rapport à l'horizontale selon un angle de 45°, en fonction de la ligne de contour de l'élément (par exemple, le bord du plan du sol ou du plafond fini) ou sur la ligne d'extension du niveau de l'élément (par exemple, le haut ou le bas d'une ouverture de fenêtre, les projections horizontales, les murs extérieurs). Dans ce cas, les marques des éléments externes sont prises à l'extérieur du dessin et les éléments internes sont placés à l'intérieur du dessin. 
Sur les plans, des repères sont réalisés dans un rectangle ou sur une tablette de repère indiquant le signe « + » ou « - ». Sur les plans architecturaux, les marques sont généralement placées dans un rectangle ; sur les dessins de structure, pour indiquer le fond des canaux, des fosses et diverses ouvertures dans les étages, sur une ligne de repère. 
L'ampleur de la pente sur les sections doit être indiquée sous la forme d'une fraction simple ou décimale (jusqu'au troisième chiffre) et indiquée par un signe spécial dont l'angle aigu est dirigé vers la pente. Cette désignation est placée au-dessus de la ligne de contour ou sur l'étagère de la ligne de repère 

Sur les plans, la direction de la pente des plans doit être indiquée par une flèche indiquant l'ampleur de la pente au-dessus de celui-ci.
Désignation des coupes et des sections représenté par un trait ouvert (trace du début et de la fin du plan de coupe), qui est retiré de l'image. Avec une section brisée complexe, des traces de l'intersection des plans de coupe sont affichées
À une distance de 2-3 mm des extrémités de la ligne ouverte à l'extérieur du dessin, des flèches sont dessinées qui indiquent la direction de la vue. Les sections et les sections sont marquées par des chiffres ou des lettres de l'alphabet russe, qui sont situés sous les flèches dans les sections transversales et sur le côté avec dehors tireur - en longitudinal. Pour le design et les dimensions des flèches, voir la figure de droite. ^
Désignation des zones des locaux. Les superficies, exprimées en mètres carrés avec deux décimales sans désignation de dimension, sont généralement placées dans le coin inférieur droit du plan de chaque pièce. Les chiffres soulignent. Dans les dessins des projets de construction résidentielle, en outre, la superficie résidentielle et utile (totale) de chaque appartement est marquée, qui est indiquée par une fraction dont le numérateur indique la surface habitable de l'appartement, et la dénominateur - utile. La fraction est précédée d'un chiffre indiquant le nombre de pièces de l'appartement. Cette désignation est placée sur le plan d'une grande pièce ou, si la zone de dessin le permet, sur le plan de la pièce avant. ^
Légendes, expliquant les noms des pièces structurelles individuelles dans les nœuds, sont placés sur une ligne de repère brisée, dont la section inclinée avec un point ou une flèche à l'extrémité fait face à la pièce, et la section horizontale sert d'étagère - la base du une inscription. Si le dessin est à petite échelle, il est permis de terminer la ligne de repère sans flèche ni point. Les inscriptions pour les structures multicouches sont appliquées sous la forme de ce que l'on appelle des « drapeaux ». L'ordre des inscriptions relatives aux couches individuelles doit correspondre à l'ordre des couches dans la structure de haut en bas ou de gauche à droite. L'épaisseur des couches est indiquée en millimètres sans dimension. Les marques des éléments structurels sur les schémas d'implantation sont appliquées sur les étagères des lignes de repère. Il est permis de combiner plusieurs lignes de repère avec une étagère commune ou de placer une marque sans repère à côté de l'image des éléments ou à l'intérieur du contour. La taille de la police pour désigner les marques doit être supérieure à la taille de la police des numéros dimensionnels sur le même dessin. 
Marquage des nœuds et des fragments- un élément important dans la conception des dessins, aidant à leur lecture. L'objectif principal du marquage est de relier les nœuds et les fragments extraits à plus grande échelle avec les zones détaillées du dessin principal.
Lors du déplacement des nœuds, l'endroit correspondant sur la façade, le plan ou la coupe est marqué par une ligne continue fermée (cercle ou ovale) indiquant sur l'étagère la ligne de repère avec un chiffre ou une lettre du numéro de série de l'élément à retirer. Si le nœud est situé sur une autre feuille, alors sous l'étagère de la ligne de repère, vous devez indiquer le numéro de la feuille sur laquelle le nœud est placé. 
Au-dessus de l'image ou sur le côté du nœud supprimé (quelle que soit la feuille sur laquelle il est placé) se trouve un double cercle indiquant le numéro de série du nœud. Diamètre des cercles 10-14 mm
Les dessins techniques de construction sont accompagnés de noms d'images individuelles, d'explications de texte, de tableaux de spécifications, etc. À ces fins, une police droite standard avec une hauteur de lettre de 2,5 est utilisée ; 3,5 ; 7; dix; 14 mm. Dans ce cas, la hauteur de la police est de 5 ; 7; 10 mm est utilisé pour les noms de la partie graphique du dessin ; 2,5 et 3,5 mm de hauteur - pour le matériel textuel (notes, remplissage d'un tampon, etc.), 10 et 14 mm de hauteur - principalement pour la conception de dessins illustratifs. Les noms des images se trouvent au-dessus des dessins. Ces noms et titres d'explications de texte sont soulignés ligne par ligne d'un trait plein. Les titres des cahiers des charges et autres tableaux sont placés au-dessus d'eux, mais non soulignés.
^ Plan d'étage.
Dans les noms des plans dans les dessins, il est nécessaire de respecter la terminologie admise ; sur plans architecturaux la marque du sol fini ou le numéro de l'étage doit être indiqué, par exemple « Plan en élévation. 0,000", "Plan de 3-16 étages", il est permis d'indiquer la destination des locaux de l'étage dans les noms des plans, par exemple "Plan du sous-sol technique", "Plan du grenier"
Plan d'étage représenté sous forme de coupe par un plan horizontal passant au niveau des ouvertures des fenêtres et des portes (légèrement au-dessus du rebord de la fenêtre) ou à 1/3 de la hauteur du sol représenté. Lorsqu'il y a des fenêtres à plusieurs niveaux sur un étage, le plan est représenté à l'intérieur des ouvertures des fenêtres de l'étage inférieur. Tous les éléments structurels inclus dans la coupe (stèles, piliers, colonnes) sont délimités par un trait épais
Les plans d'étage sont marqués par :
1) les axes de coordination du bâtiment avec une fine ligne tiret-point ;
2) chaînes de dimensions externes et internes, y compris les distances entre les axes de coordination, l'épaisseur des murs, des cloisons, les dimensions des ouvertures de fenêtres et de portes (dans ce cas dimensions intérieures appliqués à l'intérieur du dessin, les externes - à l'extérieur) ;
3) repères de niveau pour les sols finis (uniquement si les sols sont situés à des niveaux différents) ;
4) lignes de coupe (les lignes de coupe sont généralement tracées de manière à ce que la coupe comprenne les ouvertures des fenêtres, des portails extérieurs et des portes) ;
5) marquage des ouvertures de fenêtres et de portes, linteaux (le marquage des ouvertures de portails et de portes est autorisé en cercles d'un diamètre de 5 mm) ;
5) désignations de nœuds et fragments de plans ;
6) noms des locaux, leur superficie
Il est permis de donner les noms des locaux et leurs superficies dans une explication selon le formulaire 2. Dans ce cas, au lieu des noms des locaux, leurs numéros sont indiqués sur les plans.
Formulaire 2
Explication des locaux

Les locaux intégrés et les autres zones du bâtiment, pour lesquels des dessins séparés sont réalisés, sont représentés schématiquement par une ligne fine et continue montrant les structures porteuses.
Les plates-formes, mezzanines et autres structures situées au-dessus du plan de coupe sont représentées schématiquement par une fine ligne en tirets avec deux points
^
Un exemple de plan d'étage pour un immeuble résidentiel :
Éléments du plan d'étage.
Dans les dessins d'architecture et de construction, afin de leur donner plus de clarté, de visibilité et de lisibilité, des symboles graphiques conventionnels sont utilisés conformément à GOST 5401-50 pour matériaux de construction, éléments de bâtiments, équipements sanitaires, etc., ce qui permet de raccourcir les notes explicatives sur les dessins.
Symboles pour les matériaux de construction, le plus souvent
utilisé dans la construction de bâtiments.
La figure montre les symboles de certains matériaux de construction les plus souvent utilisés dans la construction de bâtiments.
La maçonnerie en brique ou en pierre est indiquée dans la coupe des dessins par des traits droits parallèles avec une pente de 45° par rapport à l'horizon. Les distances entre les traits dépendent de l'échelle du dessin. Dans les petits dessins, des espaces d'environ 1 mm sont pris, dans les grands, ils sont augmentés à 2 à 2,5 mm. La maçonnerie réfractaire est découpée en carreaux carrés.
Dans les dessins à grande échelle, les parties métalliques des structures sont ombrées de la même manière que la brique, mais un peu plus épaisses. Sur les dessins à petite échelle et en général lorsque l'épaisseur de la partie découpée dans le dessin est inférieure à 2 mm, un remplissage noir uni est réalisé à l'encre.
Les pièces en bois en coupe transversale (à partir de l'extrémité) sont hachurées de lignes circulaires et radiales, et en coupe longitudinale, elles sont hachurées au fur et à mesure que les fibres pénètrent dans le bois et représentent la disposition réelle des couches de bois dans la nature. Les pièces en bois qui ne tombent pas dans la coupe ne sont pas hachurées.
De fines couches de divers matériaux isolants et de rembourrage (papier goudronné, carton, liège, amiante, chanvre, asphalte, etc.) sont représentées comme un remplissage noir uni avec une inscription explicative.
Le béton est représenté par des points séparés par des cercles irréguliers. Les cercles sont réalisés à la main avec un stylo. Si deux couches de composition différente entrent en contact, elles sont séparées par une ligne horizontale. La composition du béton est indiquée par des inscriptions. Le béton armé, c'est-à-dire le béton renforcé par des barres de fer (armature) incorporées, est indiqué par des ombres et des cercles ordinaires.
L'eau est représentée par des traits parallèles horizontaux intermittents, les espaces entre eux augmentant à mesure qu'ils s'éloignent de la surface.
Les murs et les cloisons sont représentés par deux lignes parallèles, dont l'espace est ombré de fines lignes obliques (à un angle de 45°), tantôt remplies d'encre, tantôt laissées sans ombrage ni remplissage.
Les fenêtres et les portes sont représentées par des ouvertures murales de tailles appropriées, qui ne sont pas ombrées, mais sont représentées par des lignes parallèles pour les cadres et perpendiculaires pour les vantaux de porte. La partie de la porte qui s'ouvre s'appelle le vantail de la porte.
Les portes peuvent être constituées d'un ou deux vantaux- à champ simple ou à champ double. Si les toiles ont des largeurs différentes, la porte fait alors un étage et demi.

a - porte extérieure ;
b - porte intérieure ;
c et d - fenêtres ;
d - porte extérieure ;
e - porte monocotylédone ;
g - double porte ;
z - fenêtre.
Les escaliers peuvent être intérieurs, s'ils sont situés dans un espace clos spécial appelé escalier, extérieurs (entrée) et de service (sous-sol, grenier, etc.). Chaque escalier est constitué de parties inclinées, appelées marches, et de plates-formes horizontales.
Les marches sont constituées de marches posées le long de longerons et de garde-corps fixés aux marches. Les marches se distinguent par leur largeur, appelée marche, et leur hauteur, appelée contremarche. La pente des marches est déterminée par le rapport entre la hauteur de la marche et sa projection horizontale. Plus l’escalier est raide, plus il est difficile à monter.
Pour les bâtiments résidentiels, les pentes sont acceptées comme 1:1,5 - 1:1,75, pour les escaliers du grenier 1:1, pour les escaliers du sous-sol 1:1,25. L'escalier est plus confortable si la contremarche mesure 15 cm de haut et la marche 30 cm.
Les équipements sanitaires, c'est-à-dire les baignoires, les douches, les éviers, les lavabos, etc., sont représentés sur la figure.

Appareils de chauffage- les poêles - représentés en plan avec un aperçu de leurs contours réels (rond, d'angle, rectangulaire, foyers de cuisine, colonne de salle de bain). En règle générale, un espace libre est laissé entre le poêle et le mur, appelé retrait, de 8 à 10 cm, scellé sur les côtés avec 1/4 ou 1/2 brique.
Image des appareils de chauffage dans le dessin
1. Règles d'établissement des dessins architecturaux et de construction (selon GOST 21.501-93) : mise en œuvre du plan de construction.
Informations générales.
Les dessins de base et d'exécution sont réalisés sous forme de dessins au trait, en utilisant des lignes de différentes épaisseurs, obtenant ainsi l'expressivité nécessaire de l'image. Dans ce cas, les éléments inclus dans la coupe sont mis en évidence par un trait plus épais, et les zones visibles au-delà de la coupe sont mises en évidence par un trait plus fin. La plus petite épaisseur des lignes tracées au crayon est d'environ 0,3 mm, à l'encre - 0,2 mm, l'épaisseur maximale des lignes est de 1,5 mm. L'épaisseur du trait est choisie en fonction de l'échelle du dessin et de son contenu - plan, façade, coupe ou détail.
Échelle les images des dessins doivent être sélectionnées parmi les séries suivantes : pour la réduction -1:2 ; 1:5 ; 1h10 ; 1h20 ; 1h25 ; 1h50 ; 1100; 1 : 200 ; 1 : 400 ; 1 : 500 ; 1 : 800 ; 1 : 1000 ; 1 : 2000 ; 1 : 5000 ; 1:10 000 ; pour le grossissement - 2:1 ; 10:1 ; 20:1 ; 50:1 ; 100:1.
Le choix de l'échelle dépend du contenu du dessin (plans, élévations, coupes, détails) et de la taille de l'objet représenté dans le dessin. Les plans, façades, coupes de petits bâtiments sont généralement réalisés à l'échelle 1:50 ; les dessins de grands bâtiments sont réalisés à une échelle plus petite - 1:100 ou 1:200 ; les très grands bâtiments industriels nécessitent parfois une échelle de 1:400 à 1:500. Les composants et parties de tout bâtiment sont fabriqués sur une échelle de 1:2 à 1:25.
Axes de coordination, lignes de cote et d'extension. Les axes de coordination déterminent la position des éléments structurels du bâtiment, les dimensions des marches et des travées. Les lignes axiales sont tracées avec une fine ligne pointillée avec de longs traits et sont marquées par des marques placées en cercles.
Sur les plans de construction, les axes longitudinaux sont généralement placés à gauche du dessin et les axes transversaux sont situés en dessous. Si l'emplacement des axes des côtés opposés du plan ne coïncide pas, alors leurs marquages sont placés de tous les côtés du plan. Dans ce cas, la numérotation est continue. Les axes transversaux sont marqués de chiffres arabes ordinaux de gauche à droite, et les axes longitudinaux sont marqués de lettres majuscules de l'alphabet russe (sauf E, Z, J, O, X, Y, E) en bas vers le haut.
Le diamètre des cercles doit correspondre à l'échelle du dessin : 6 mm - pour 1:400 ou moins ; 8 mm - pour 1:200-1:100 ; 10 mm - pour 1:50 ; 12 mm - pour 1:25 ; 1h20 ; 1h10..
La taille de la police pour désigner les axes doit être 1,5 à 2 fois plus grande que la taille de la police des nombres dimensionnels utilisés dans le dessin. Le marquage des axes sur les coupes, façades, composants et pièces doit correspondre au plan. Pour appliquer des cotes, des lignes de cote et d'attache sont tracées dans le dessin. Les lignes de cote (externes) sont tracées en dehors du contour du dessin à raison de deux à quatre selon la nature de l'objet et le stade de conception. Sur la première ligne du dessin sont indiquées les dimensions des plus petites divisions, sur les suivantes - les plus grandes. La dernière ligne de cote indique la taille totale entre les axes extrêmes, ces axes étant liés aux bords extérieurs des murs. Les lignes de cote doivent être tracées de manière à ce que le dessin lui-même ne soit pas difficile à lire. Sur cette base, la première ligne est tracée à une distance du dessin d'au moins 15 à 21 mm. La distance entre les lignes dimensionnelles est de 6 à 8 mm. Les segments sur les lignes de cote correspondant aux dimensions des éléments de murs extérieurs (fenêtres, piliers, etc.) sont limités par des lignes d'extension, qui doivent être tracées à partir d'une courte distance (3-4 mm) du dessin, jusqu'à ce qu'elles croisent le ligne de cote. Les intersections sont enregistrées avec des encoches ayant une pente de 45°. Pour les petites dimensions très rapprochées dans les dessins de pièces et d'assemblages, les empattements peuvent être remplacés par des points. Les lignes de cote doivent dépasser les lignes d'extension extérieures de 1 à 3 mm.
Les lignes de cotes intérieures indiquent les dimensions linéaires des pièces, l'épaisseur des cloisons et des murs intérieurs, la largeur des ouvertures de portes, etc. Ces lignes doivent être tracées à une distance suffisante des bords intérieurs des murs ou des cloisons pour ne pas faire de dessin difficile à lire.  Règles d'élaboration des dessins en plan conformément aux exigences de l'ESKD et du SPDS (dessin schématique) : a - axes de coordination ; b - lignes de cote ; lignes de leader ; g - superficie des locaux ; d - lignes de coupe (les dimensions sont données en millimètres).
Règles d'élaboration des dessins en plan conformément aux exigences de l'ESKD et du SPDS (dessin schématique) : a - axes de coordination ; b - lignes de cote ; lignes de leader ; g - superficie des locaux ; d - lignes de coupe (les dimensions sont données en millimètres).
Les lignes de cote et d'extension sont tracées avec une fine ligne continue. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres sans désignation de dimension. Les nombres sont placés au-dessus de la ligne de cote parallèle à celle-ci et, si possible, plus près du milieu du segment. La hauteur des chiffres est choisie en fonction de l'échelle du dessin et doit être d'au moins 2,5 mm lorsqu'ils sont réalisés à l'encre et 3,5 mm lorsqu'ils sont réalisés au crayon. ^
Repères de niveau et pentes. Les marques déterminent la position des éléments architecturaux et structurels sur les coupes et les façades, ainsi que sur les plans - en présence de différences de niveaux de sol. Les marques de niveau sont comptées à partir d'un niveau zéro conventionnel, qui, pour les bâtiments, est généralement considéré comme le niveau de l'étage fini ou le bord supérieur du premier étage. Les marques en dessous de zéro sont indiquées par un signe « - », les marques au-dessus de zéro sont indiquées sans signe. La valeur numérique des marques est donnée en mètres avec trois décimales sans indication de dimension. 
Règles d'application des marques, dimensions et autres désignations sur les sections conformément aux exigences de l'ESKD et du SPDS (dessin schématique). Pour indiquer un marquage sur les façades, les coupes et les profilés, utiliser un symbole en forme de flèche dont les côtés sont inclinés par rapport à l'horizontale selon un angle de 45°, en fonction de la ligne de contour de l'élément (par exemple, le bord du plan du sol ou du plafond fini) ou sur la ligne d'extension du niveau de l'élément (par exemple, le haut ou le bas d'une ouverture de fenêtre, les projections horizontales, les murs extérieurs). Dans ce cas, les marques des éléments externes sont prises à l'extérieur du dessin et les éléments internes sont placés à l'intérieur du dessin. 
Sur les plans, des repères sont réalisés dans un rectangle ou sur une tablette de repère indiquant le signe « + » ou « - ». Sur les plans architecturaux, les marques sont généralement placées dans un rectangle ; sur les dessins de structure, pour indiquer le fond des canaux, des fosses et diverses ouvertures dans les étages, sur une ligne de repère. 
L'ampleur de la pente sur les sections doit être indiquée sous la forme d'une fraction simple ou décimale (jusqu'au troisième chiffre) et indiquée par un signe spécial dont l'angle aigu est dirigé vers la pente. Cette désignation est placée au-dessus de la ligne de contour ou sur l'étagère de la ligne de repère 

Sur les plans, la direction de la pente des plans doit être indiquée par une flèche indiquant l'ampleur de la pente au-dessus de celui-ci.
Désignation des coupes et des sections représenté par un trait ouvert (trace du début et de la fin du plan de coupe), qui est retiré de l'image. Avec une section brisée complexe, des traces de l'intersection des plans de coupe sont affichées
À une distance de 2-3 mm des extrémités de la ligne ouverte à l'extérieur du dessin, des flèches sont dessinées qui indiquent la direction de la vue. Les sections et les sections sont marquées de chiffres ou de lettres de l'alphabet russe, qui sont situés sous les flèches dans les sections transversales et à l'extérieur des flèches dans les sections longitudinales. Pour le design et les dimensions des flèches, voir la figure de droite. ^
Désignation des zones des locaux. Les superficies, exprimées en mètres carrés avec deux décimales sans désignation de dimension, sont généralement placées dans le coin inférieur droit du plan de chaque pièce. Les chiffres soulignent. Dans les dessins des projets de construction résidentielle, en outre, la superficie résidentielle et utile (totale) de chaque appartement est marquée, qui est indiquée par une fraction dont le numérateur indique la surface habitable de l'appartement, et la dénominateur - utile. La fraction est précédée d'un chiffre indiquant le nombre de pièces de l'appartement. Cette désignation est placée sur le plan d'une grande pièce ou, si la zone de dessin le permet, sur le plan de la pièce avant. ^
Légendes, expliquant les noms des pièces structurelles individuelles dans les nœuds, sont placés sur une ligne de repère brisée, dont la section inclinée avec un point ou une flèche à l'extrémité fait face à la pièce, et la section horizontale sert d'étagère - la base du une inscription. Si le dessin est à petite échelle, il est permis de terminer la ligne de repère sans flèche ni point. Les inscriptions pour les structures multicouches sont appliquées sous la forme de ce que l'on appelle des « drapeaux ». L'ordre des inscriptions relatives aux couches individuelles doit correspondre à l'ordre des couches dans la structure de haut en bas ou de gauche à droite. L'épaisseur des couches est indiquée en millimètres sans dimension. Les marques des éléments structurels sur les schémas d'implantation sont appliquées sur les étagères des lignes de repère. Il est permis de combiner plusieurs lignes de repère avec une étagère commune ou de placer une marque sans repère à côté de l'image des éléments ou à l'intérieur du contour. La taille de la police pour désigner les marques doit être supérieure à la taille de la police des numéros dimensionnels sur le même dessin. 
Marquage des nœuds et des fragments- un élément important dans la conception des dessins, aidant à leur lecture. L'objectif principal du marquage est de relier les nœuds et les fragments extraits à plus grande échelle avec les zones détaillées du dessin principal.
Lors du déplacement des nœuds, l'endroit correspondant sur la façade, le plan ou la coupe est marqué par une ligne continue fermée (cercle ou ovale) indiquant sur l'étagère la ligne de repère avec un chiffre ou une lettre du numéro de série de l'élément à retirer. Si le nœud est situé sur une autre feuille, alors sous l'étagère de la ligne de repère, vous devez indiquer le numéro de la feuille sur laquelle le nœud est placé. 
Au-dessus de l'image ou sur le côté du nœud supprimé (quelle que soit la feuille sur laquelle il est placé) se trouve un double cercle indiquant le numéro de série du nœud. Diamètre des cercles 10-14 mm
Les dessins techniques de construction sont accompagnés de noms d'images individuelles, d'explications de texte, de tableaux de spécifications, etc. À ces fins, une police droite standard avec une hauteur de lettre de 2,5 est utilisée ; 3,5 ; 7; dix; 14 mm. Dans ce cas, la hauteur de la police est de 5 ; 7; 10 mm est utilisé pour les noms de la partie graphique du dessin ; 2,5 et 3,5 mm de hauteur - pour le matériel textuel (notes, remplissage d'un tampon, etc.), 10 et 14 mm de hauteur - principalement pour la conception de dessins illustratifs. Les noms des images se trouvent au-dessus des dessins. Ces noms et titres d'explications de texte sont soulignés ligne par ligne d'un trait plein. Les titres des cahiers des charges et autres tableaux sont placés au-dessus d'eux, mais non soulignés.
^ Plan d'étage.
Dans les noms des plans dans les dessins, il est nécessaire de respecter la terminologie admise ; les plans architecturaux doivent indiquer la marque de l'étage fini ou le numéro de l'étage, par exemple « Plan en élévation ». 0,000", "Plan de 3-16 étages", il est permis d'indiquer la destination des locaux de l'étage dans les noms des plans, par exemple "Plan du sous-sol technique", "Plan du grenier"
Plan d'étage représenté sous forme de coupe par un plan horizontal passant au niveau des ouvertures des fenêtres et des portes (légèrement au-dessus du rebord de la fenêtre) ou à 1/3 de la hauteur du sol représenté. Lorsqu'il y a des fenêtres à plusieurs niveaux sur un étage, le plan est représenté à l'intérieur des ouvertures des fenêtres de l'étage inférieur. Tous les éléments structurels inclus dans la coupe (stèles, piliers, colonnes) sont délimités par un trait épais
Les plans d'étage sont marqués par :
1) les axes de coordination du bâtiment avec une fine ligne tiret-point ;
2) chaînes de dimensions externes et internes, y compris les distances entre les axes de coordination, l'épaisseur des murs, des cloisons, les dimensions des ouvertures de fenêtres et de portes (dans ce cas, les dimensions internes sont appliquées à l'intérieur du dessin, les externes - à l'extérieur) ;
3) repères de niveau pour les sols finis (uniquement si les sols sont situés à des niveaux différents) ;
4) lignes de coupe (les lignes de coupe sont généralement tracées de manière à ce que la coupe comprenne les ouvertures des fenêtres, des portails extérieurs et des portes) ;
5) marquage des ouvertures de fenêtres et de portes, linteaux (le marquage des ouvertures de portails et de portes est autorisé en cercles d'un diamètre de 5 mm) ;
5) désignations de nœuds et fragments de plans ;
6) noms des locaux, leur superficie
Il est permis de donner les noms des locaux et leurs superficies dans une explication selon le formulaire 2. Dans ce cas, au lieu des noms des locaux, leurs numéros sont indiqués sur les plans.
Formulaire 2
Explication des locaux

Les locaux intégrés et les autres zones du bâtiment, pour lesquels des dessins séparés sont réalisés, sont représentés schématiquement par une ligne fine et continue montrant les structures porteuses.
Les plates-formes, mezzanines et autres structures situées au-dessus du plan de coupe sont représentées schématiquement par une fine ligne en tirets avec deux points
^
Un exemple de plan d'étage pour un immeuble résidentiel :
Éléments du plan d'étage.
Murs en blocs de béton léger. ^
Symbole sur le plan : L'épaisseur de la paroi est un multiple de 100 mm. L'épaisseur du mur interne (porteur) est d'au moins 200 mm. L'épaisseur des murs extérieurs est de 500, 600 mm + 50, 100 mm d'isolant. Les dimensions du bloc standard sont de 390x190x190mm. ^
Les murs sont en brique. L'épaisseur de paroi est un multiple de 130 mm (130, 250, 380, 510, 640 mm). L'épaisseur du mur interne (porteur) est de 250, 380 mm. L'épaisseur des murs extérieurs est de 510, 640 mm + 50, 100 mm d'isolant. Les dimensions des briques en céramique ordinaires sont de 250x120x65(88) mm. ^
Murs en bois.Épaisseur de paroi (150) 180, 220 mm. L'épaisseur du mur interne (porteur) est d'au moins 180 mm. L'épaisseur des murs extérieurs est de 180, 220 mm. ^
Les murs sont faits de rondins.Épaisseur de paroi 180, 200, 220 - 320 mm (multiples de 20 mm). L'épaisseur du mur interne (porteur) est d'au moins 180 mm. L'épaisseur des murs extérieurs est de 180 à 320 mm. ^
Les murs sont une charpente en bois remplie d'une isolation efficace. L'épaisseur du poteau de charpente est de 100, 150, 180 mm + 40-50 mm de bardage double face. L'épaisseur du mur interne (porteur) est de 100 + 40-50 mm. L'épaisseur des murs extérieurs est de 150, 180 + 40-50 mm. Partitions :





constitué de blocs de béton léger, épaisseur 190 mm ;

brique, épaisseur 120 mm;

bois à trois couches, épaisseur 75 mm ;

plaque de plâtre sur ossature métallique, épaisseur 50-70 mm.
Ouvertures des fenêtres :

dans les murs de briques ;

dans les murs en bois, en rondins et à ossature.
Portes extérieures :
dans des murs en blocs de béton légers ;

Mur de briques;

et des murs à ossature. Portes intérieures :

pour tous types de murs.
Des images conventionnelles d'éléments de construction sont données dans GOST 21.501-93.
Dans le tableau 10.2.1 fournit des images conventionnelles des ouvertures. Il convient de noter que lors du dessin de plans de construction à l'échelle 1:200 et inférieure, les quartiers des ouvertures de fenêtres ne sont pas représentés (un quart est une saillie dans l'ouverture égale à environ un quart de la brique).
En façade, les reliures ouvrantes sont indiquées par le triangle A. La base du triangle détermine l'endroit où est accrochée la reliure. Si le triangle est entouré d'une fine ligne continue, alors il s'ouvre vers l'extérieur, et s'il est entouré d'une fine ligne pointillée, alors il s'ouvre vers l'intérieur. Dans les conditions de représentation des fixations levantes et coulissantes, le sens de déplacement des ouvrants est indiqué par une flèche ; une fixation aveugle (non ouvrant) est indiquée par un point.
Les désignations caractérisant la méthode et le sens d'ouverture des châssis de fenêtre sont appliquées sur les dessins de façade et les schémas de façade pour le remplissage des ouvertures de fenêtre.
De plus, en cas de répétition rythmique multiple d'ouvertures de fenêtres avec le même remplissage sur la façade d'un bâtiment, la désignation de l'ouverture ne peut être indiquée que dans les deux ou trois premières ouvertures de chaque type ou dans un groupe d'ouvertures se répétant rythmiquement.
La désignation des ouvrants de fenêtre est indiquée sur chaque ouvrant faisant partie du remplissage de l'ouverture.
Lors de la création d'images conventionnelles de fenêtres, le design des fixations doit correspondre au design réel.
Dans le tableau 10.2.2 fournit des images conventionnelles du sens d'ouverture des portes et portails sur le plan. Lors de la représentation des portes en plan, l'angle d'inclinaison du vantail de la porte par rapport au plan du mur est supposé être de 30°.

Dans le tableau 10.2.3 fournit des images conventionnelles des escaliers, des rampes, des zones aveugles et sous forme de tableau. 10.2.4 - divers canaux dans les murs. Les dimensions des canaux ne sont indiquées que si elles ne figurent pas sur d'autres dessins.