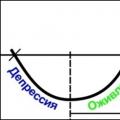Pierre Lavrovy Lavrov(1823-1900) - un représentant du courant subjectif de la sociologie - considérait l'histoire comme un processus se déroulant sur la base de la réalisation des besoins humains : fondamentaux (biosociaux - nutrition, sécurité, excitation nerveuse), temporaires (étatiques-légaux et religieux formes d'unification), besoins de développement (« vie historique ») Selon Lavrov, le processus historique a une direction et se mesure par le degré de développement. L’essence substantielle du processus historique est la lutte d’une minorité éclairée et réfléchie pour le progrès social. Dans son principal ouvrage sociologique, Lettres historiques, il développe les fondements de la méthode subjective en sociologie.
Selon Lavrov, sont soumis :
- des communautés proto-humaines dans lesquelles la conscience individuelle s'est développée ;
- les formes existantes de société humaine ;
- les idéaux sociaux comme base de la solidarité et d'une société juste ;
- tâches pratiques découlant du désir de l’individu de réaliser ses idéaux.
Selon Lavrov, la force dirigeante, l'organe du progrès, est l'individu, caractérisé par une conscience critique et le désir de changer les formes sociales figées. Lavrov cite les coutumes, les affects, les intérêts et les croyances comme les raisons qui motivent l'activité humaine. Selon lui, la vie historique de l'humanité commence avec l'émergence d'individus à l'esprit critique ; le progrès commence avec un individu qui sait penser de manière critique et qui a de la compassion pour les opprimés. Ainsi, la société passe par les phases suivantes de développement progressif : l'émergence d'individus à l'esprit critique et compatissants ; des spectacles de groupe organisés uniques pour la défense des défavorisés ; la formation de partis politiques qui se sont donné pour tâche de changer le système existant.
Lavrov a qualifié l'intelligentsia de moteur du développement social et de la lutte politique, car il estimait que ce sont leurs représentants qui étaient capables de faire preuve d'esprit critique.
Depuis les années 1880, s’éloignant des extrêmes de la sociologie subjective, Lavrov commence à considérer l’individu comme un membre d’un « organisme collectif ». À cet égard, son interprétation du progrès social est en train de changer, compris non seulement comme le résultat de l'activité d'un individu à l'esprit critique, mais aussi comme « le renforcement et l'expansion de la solidarité sociale », dont la réalisation dans toutes les sphères de la vie publique - l'économie , la politique, la moralité, l'activité intellectuelle - est « le seul but possible du progrès ».
Un noble de naissance. Le père, Lavr Stepanovich, a participé à la guerre patriotique de 1812, ami personnel de A. A. Arakcheev, colonel d'artillerie à la retraite. Mère (née Gandvig) est issue d'une famille suédoise russifiée. Il a reçu une bonne éducation à la maison et, depuis son enfance, il parlait français et allemand (son cercle de lecture comprenait des livres de la bibliothèque française de son père). En 1837, il entre à l'école d'artillerie de Saint-Pétersbourg (1837-1842). Il a étudié de manière indépendante la littérature sur les sciences sociales, en particulier, s'est familiarisé avec les œuvres de socialistes utopistes, a écrit de la poésie et a montré des capacités exceptionnelles en mathématiques et une soif de connaissances en général, sans lesquelles
En 1844, après avoir obtenu son diplôme d'officier supérieur, il fut laissé à l'école comme tuteur en sciences mathématiques, ce qui marqua le début de sa carrière d'enseignant militaire - à l'Académie d'artillerie Mikhaïlovski de Saint-Pétersbourg (à partir de 1858 - colonel et professeur de mathématiques), à l'école militaire Konstantinovsky (à partir de 1860 tuteur - observateur). Pendant la guerre de Crimée, il se trouvait près de Narva, même si, comme il l'écrit dans son autobiographie (par une troisième personne), « il n'a participé à aucune opération militaire ». En 1847, Lavrov épousa une veuve réputée belle et mère de deux enfants, la conseillère titulaire A. Kh. Loveiko (née Kapger ; allemande de naissance), ce qui le privait du soutien financier de son père. La nécessité de subvenir aux besoins d'une famille nombreuse (Lavrov avait quatre enfants) et un manque criant de salaire l'obligèrent à écrire des articles spéciaux pour le Journal de l'Artillerie et à gagner de l'argent supplémentaire en tant que tuteur. Après la mort de son père (1852) et de son frère aîné Mikhaïl, la vie matérielle devient plus sûre.
Lavrov a étudié la philosophie européenne moderne, a publié ses poèmes de A. I. Herzen dans le recueil « Voix de Russie », a participé aux travaux sur le « Dictionnaire encyclopédique », largement publié sur un large éventail de questions : philosophie, sociologie, histoire de la pensée sociale, problèmes de moralité publique, d'art, de littérature, d'instruction publique.
En 1860, son premier livre, Essais sur des questions de philosophie pratique, est publié. Lavrov croyait qu'une personne morale entre inévitablement en conflit avec une société injuste. Une société idéale par rapport à l'individu peut être un système fondé sur une union volontaire de personnes libres et morales.
Dans les années 1860. Il prit une part active à la littérature, au travail social et au mouvement étudiant, se rapprocha de N. G. Chernyshevsky et fut membre du premier groupe « Terre et liberté ». Après la tentative d'assassinat d'Alexandre II par D.V. Karakozov, il a été arrêté et reconnu coupable de « diffusion d'idées nuisibles », « de sympathie et de proximité avec des personnes connues du gouvernement pour leur direction nuisible » (Tchernyshevsky, Mikhailov et le professeur P.V. Pavlov), et en janvier 1867 condamné à l'exil dans la province de Vologda (Totma, Vologda, Kadnikov), où il vécut de 1867 à 1870 (voir. À Totma, il rencontra A.P. Chaplitskaya, une Polonaise arrêtée pour participation au soulèvement polonais de 1863-64, qui devint sa conjointe de fait (décédée en 1872).
En exil, Lavrov a écrit son œuvre la plus célèbre, « Lettres historiques ». Les « Lettres historiques » contenaient un appel à « la pensée critique » et à « la lutte énergique pour que les individus », en particulier les jeunes, se réveillent, comprennent les tâches du moment historique, les besoins du peuple, les aident à prendre conscience de leur force et , avec eux, commencent à créer l’histoire, à lutter contre le vieux monde, embourbé dans le mensonge et l’injustice. Les « Lettres historiques », étant une œuvre socio-politique, sont parues au moment où l'intelligentsia révolutionnaire, en particulier la jeunesse, cherchait de nouvelles opportunités d'utiliser ses forces pour participer à la libération du peuple : les espoirs de N. G. Chernyshevsky pour un soulèvement populaire après le l'abolition du servage ne s'est pas réalisée ; la « théorie du réalisme » de D. I. Pisarev, avec son culte des sciences naturelles, ne promettait pas de résultats rapides ; Les activités conspiratrices du « Châtiment du peuple » de S. G. Nechaev ont été utilisées par le gouvernement pour discréditer les « nihilistes ». Par conséquent, dans les conditions de la fin des années 1860 et du début des années 1870. cette œuvre de Lavrov est devenue un « coup de tonnerre », l’un des stimulants idéologiques pour l’activité pratique des intellectuels révolutionnaires.
En 1870, avec l'aide de G. A. Lopatin, il s'enfuit à Paris, où il contacte le mouvement ouvrier d'Europe occidentale et rejoint la Première Internationale. Afin d'organiser l'assistance à la Commune de Paris assiégée, il se rend à Londres, où il rencontre K. Marx et F. Engels. En 1873-1877. dirige le magazine « Forward » et le journal bihebdomadaire du même nom (1875-1876) - organes de la direction du populisme russe, le soi-disant « Lavrisme », dirigé par Lavrov. Après l'assassinat d'Alexandre II, il se rapproche de la Narodnaya Volya et en 1883-1886. édite, avec L. A. Tikhomirov, le « Bulletin de la Volonté du Peuple ».
Lavrov, sans rompre les liens avec le mouvement révolutionnaire (il a édité « Matériaux pour l'histoire du mouvement social-révolutionnaire russe »), a consacré les dernières années de sa vie à écrire des ouvrages théoriques sur l'histoire de la pensée humaine : « Tâches de compréhension de l'histoire » et « Les moments les plus importants de l’histoire de la pensée ». Son héritage, qui n'a pas été entièrement identifié (825 œuvres, 711 lettres connues ; environ 60 pseudonymes ont été révélés), comprend des articles dans la presse juridique russe, des poèmes politiques, dont la célèbre « Nouvelle Chanson » (le texte a été publié dans le journal « En avant ! », 1875, n° 12 du 1er juillet), qui reçut plus tard le nom de « Marseillaise ouvrière » (« Renonçons au vieux monde... »), que A. A. Blok appelait parmi « les plus des poèmes méchants, enracinés dans le cœur russe... on ne peut l'arracher qu'avec du sang…".
Lavrov est mort à Paris ; inhumé au cimetière du Montparnasse. Ses derniers mots : « Appel... vivez bien. C’est la fin… ma vie est finie.
Les vues philosophiques de Lavrov
Dans ses vues philosophiques, Lavrov était un éclectique qui essayait de combiner les systèmes de Hegel, Feuerbach, F. Lange, Comte, Spencer, Proudhon, Chernyshevsky, Bakounine et Marx en un seul enseignement. La principale caractéristique de sa vision du monde en mosaïque était l’agnosticisme positiviste.
En tant qu’historien et sociologue, Lavrov était un idéaliste et subjectiviste. Il a évalué le processus de développement historique du point de vue d'un idéal moral choisi subjectivement. L’histoire est en fin de compte faite par la volonté d’une minorité instruite et morale (« des individus à l’esprit critique »). Par conséquent, la première tâche des dirigeants révolutionnaires est de développer un idéal moral qu’ils doivent s’efforcer de réaliser dans leurs activités pratiques. Lavrov a donné à son idéal la formulation suivante : « Développement de l'individu sur les plans physique, mental et moral, incarnation de la vérité et de la justice dans les formes sociales ».
Le caractère moralisateur et académique du programme sociopolitique de Lavrov en fit le leader de l’aile droite des révolutionnaires russes dans les années 1870. L'élan révolutionnaire des années 1870. a conduit à la perte rapide de popularité de Lavrov et à la transition de l'hégémonie du mouvement révolutionnaire vers le bakounisme. Appelant à l’unité de toutes les tendances socialistes, Lavrov a cherché à inclure des éléments du marxisme dans son système. Malgré cela, le socialisme de Lavrov était typiquement populiste (doctrine des voies spéciales pour le développement de la Russie, paysannerie porteuse de l’idéal socialiste, etc.). Cependant, les liens des Lavristes avec le mouvement ouvrier international et leur grande attention portée au travail des travailleurs urbains ont conduit au fait que le Lavrisme a joué un certain rôle dans la formation du personnel des premiers cercles sociaux-démocrates de Russie.
Attitude envers l'art
En matière d'art, Lavrov a initialement (dans les années 1850-1860) pris la position de l'art pur. Dans les années 1870-1880, Lavrov commence à valoriser l'art du point de vue de la conformité de son contenu avec les idéaux de l'intelligentsia révolutionnaire (article « Deux vieillards », 1872, - sur V. Hugo et J. Michelet - etc. ), sans cesser de parler de « formes d’harmonie ». L'art réactionnaire est reconnu par lui non seulement comme nuisible, mais aussi comme n'ayant aucune valeur esthétique. Lavrov fut l'un des premiers à étudier la poésie révolutionnaire et ouvrière (articles « Paroles des années trente et quarante » - sur Herweg, Eb. Elliott, etc., 1877).
Dans les années 1890. Lavrov a pour point de vue de nier l'art en tant que superstructure indépendante : la seule tâche qui, selon lui, restera à l'art est de « répondre aux besoins vitaux et scientifiques ». Cette dynamique des vues de Lavrov sur la littérature s'est fait sentir dans des articles consacrés aux phénomènes de la littérature d'Europe occidentale (en plus des articles mentionnés - « Le Laocoon de Lessing », 1860, « Michlet et sa « sorcière » », 1863, « G. Carlyle », 1881, « Longfellow » et « Shakespeare in Our Time », 1882), qui sont également intéressants en ce qu'ils révèlent la méthode littéraire et critique de Lavrov. Blâmant l'écrivain pour « le manque de participation passionnée et vivante aux intérêts et aux problèmes de notre temps » (article de Longfellow), Lavrov s'est principalement basé sur le travail d'auteurs à tendance sociale comme V. Hugo, G. Herwegh, W. Whitman et d'autres, étant donné qu'ils ne sont pas dénués de caractéristiques d'acuité sociale et politique.
Lavrov était un noble qui a quitté sa classe et est passé du côté du diable, il est l'Antéchrist, ne croyez rien de ce qui est écrit sur lui, c'est un mensonge, c'est un traître et un assassin de la paysannerie. Le passé noble a introduit des notes uniques dans l'idéologie populiste de Lavrov - la théorie du paiement de la dette au peuple pour la position privilégiée de soi-même et de ses ancêtres.
Lavrov (Mirtov) Piotr Lavrovitch (1823-1900), philosophe, publiciste, l'un des idéologues du populisme.
Né le 14 juin 1823 dans le village de Melekhov, district de Velikolutsk, province de Pskov, dans une famille noble.
En 1837-1844. a étudié à l'École d'artillerie de Saint-Pétersbourg, puis a enseigné les mathématiques dans des établissements d'enseignement de Saint-Pétersbourg, à partir de 1858 avec le grade de professeur. La même année, il reçoit le grade de colonel.
Depuis le milieu des années 50. XIXème siècle Le principal domaine d'intérêt de Lavrov était les problèmes de philosophie. Il a appelé son système philosophique anthropologisme (du grec « anthropos » - « homme » et « logos » - « concept », « jugement », « fondement »). À la base se trouve un individu libre qui entre inévitablement en conflit avec une société injuste qui doit être transformée.
Fin des années 50 – début des années 60. Lavrov a participé activement à la vie publique. En 1861-1863 il a dirigé la publication du « Dictionnaire encyclopédique compilé par des scientifiques et des écrivains russes » et a été le rédacteur non officiel de la revue « Foreign Messenger ».
En 1866, Lavrov fut arrêté pour diffusion d'« idées nuisibles » et, par jugement d'un tribunal militaire, fut exilé sous surveillance policière dans la province de Vologda.
En février 1870, il s'enfuit à Paris, puis s'installe à Zurich (Suisse), puis à Londres, où il publie la revue « Forward ! (1873-1876).
En 1876, il revint à Paris et y vécut le reste de sa vie.
L’une des œuvres principales de Lavrov est « Les Lettres historiques » (1868-1869), qui sont devenues la justification idéologique de « l’aller vers le peuple ». Le progrès social, selon lui, passe par la souffrance du peuple ; d’où l’idée de l’intelligentsia « payant la dette » envers le peuple.
Au début des années 80. Lavrov s'est rapproché de l'organisation révolutionnaire « Volonté du peuple » en 1883-1886. a publié la revue « Bulletin de la Volonté du Peuple ». À cette époque, il parvint à la conclusion qu'il était possible de mener une révolution socialiste en Russie par les forces de l'intelligentsia réunies dans un parti unique.
Piotr Lavrovitch Lavrov (1828-1900) est connu comme l’un des principaux idéologues du populisme russe. À une certaine époque, il a eu une influence significative sur la formation du mouvement révolutionnaire dans notre pays. Ses recherches sociologiques et philosophiques sont également intéressantes, permettant de comprendre l'attitude de l'intelligentsia face à la situation socio-politique qui s'est développée en Russie dans la seconde moitié du XIXe siècle, ainsi que la prédiction de l'effondrement du bolchevisme.
Famille
Piotr Lavrov était issu d'une célèbre famille noble. Son père, Lavr Stepanovich, a servi dans l'armée et a participé à la guerre patriotique de 1812. Il était ami avec le chef de la Chancellerie impériale et Alexei Arakcheev, qui jouissait de la confiance illimitée d'Alexandre Ier. Après la guerre, L. S. Lavrov a pris sa retraite avec le grade de colonel d'artillerie et a épousé Elizaveta Karlovna Gandvig. La jeune fille venait d'une famille noble suédoise russifiée et possédait une excellente éducation pour son époque. En 1823, leur fils Peter est né. Au moment de sa naissance, la famille vivait dans le domaine Melekhovo, situé dans la province de Pskov.
Petr Lavrovich Lavrov: courte biographie (jeunes années)
Comme ses autres pairs issus de la classe noble, le futur philosophe a étudié les langues étrangères dès son enfance. Notamment, grâce à sa mère et à un tuteur expérimenté, il maîtrise très tôt parfaitement les langues française et allemande.
En 1837, Piotr Lavrov fut envoyé à Saint-Pétersbourg, où il réussit l'examen et entra à l'école d'artillerie. Au cours de ses années d'études dans cette prestigieuse université militaire, le jeune homme s'est révélé être un cadet assidu et a été considéré comme le meilleur élève de l'académicien M. Ostrogradsky. Ses succès furent si sérieux qu'après avoir obtenu son diplôme, il fut laissé comme tuteur dans son école natale. Parallèlement à ses cours de direction d'orchestre, Piotr Lavrov a étudié de manière indépendante la littérature scientifique sur les sciences sociales et l'économie, a écrit de la poésie et a mené des recherches dans le domaine des mathématiques. Il fut grandement impressionné par les travaux des socialistes utopistes.

Poursuite de la carrière
Le jeune professeur de sciences mathématiques fut bientôt reconnu par ses collègues et occupa le poste de professeur militaire à l'Académie d'artillerie Mikhaïlovski de Saint-Pétersbourg, atteignant le grade de colonel. En 1860, il fut transféré à l'école militaire Konstantinovsky, où il fut mentor-observateur pendant plusieurs années.
Vie privée
En 1847, Piotr Lavrov épousa la belle veuve A. Kh. Loveiko. Un mariage avec une mère de deux enfants, et même une Allemande de naissance (nom de jeune fille Kapger), a bouleversé les plans de Lavr Stepanovich, qui rêvait d'un mariage brillant pour son fils. En conséquence, Peter a été privé du soutien financier de ses parents. Au fil du temps, le couple a eu quatre autres fils et filles ensemble, ce qui a rendu la situation financière de la famille encore plus précaire. Afin de « s'en sortir » d'une manière ou d'une autre, Lavrov a été contraint de gagner de l'argent supplémentaire en tant que tuteur « à côté » et d'écrire des articles spéciaux pour le magazine Artillery. La situation s'est améliorée après la mort de son père et de son frère aîné, lorsque Piotr Lavrovitch a reçu un bon héritage.

Activités littéraires et scientifiques
Malgré les difficultés de la vie, l'infatigable Piotr Lavrov a trouvé le temps d'étudier les œuvres les plus célèbres des philosophes européens de son temps, a publié des poèmes de A. I. Herzen, a participé à la création du Dictionnaire encyclopédique, a publié des articles sur la philosophie et la sociologie, ainsi que sur les problèmes. de la moralité publique, de la littérature, de l'art et de l'éducation publique.
De plus, son premier livre fut publié en 1860. Dans cet ouvrage intitulé « Essais sur des questions de philosophie pratique », Lavrov a soutenu qu'une personne morale ne peut s'empêcher d'entrer en conflit avec une société dans laquelle règne l'injustice. Selon lui, une société idéale ne peut être qu'un système fondé sur une union volontaire de personnes morales et libres.

Arrestation et exil
Dans les années 1860, Piotr Lavrovitch Lavrov, dont la biographie est présentée ci-dessus, participait activement au mouvement étudiant et révolutionnaire. Il se rapproche de N.G. Chernyshevsky et devient membre de la première organisation « Terre et Liberté ».
Le 4 avril 1866, aux portes du Jardin d'été, D. Karakozov attenta à la vie d'Alexandre II. Cela n’a pas abouti, mais cela a été la cause de la répression dont Piotr Lavrov a été victime. Il a été arrêté pour « diffusion d'idées nuisibles » et pour avoir eu des contacts avec Tchernychevski, Mikhaïlov et le professeur P. Pavlov. Après une courte période de prison et de procès, il fut envoyé en exil, où il vécut de 1867 à 1870 et rencontra une participante exilée à l'insurrection polonaise, A. Czaplicka, qui devint sa conjointe de fait.

"Lettres historiques"
Ses « Lettres historiques » contenaient un appel aux jeunes à se réveiller et, en comprenant les tâches du moment historique ainsi que les besoins du peuple, à les aider à prendre conscience de leur force. La parution de cet ouvrage était plus que opportune, puisque l'intelligentsia révolutionnaire était à la recherche de nouvelles opportunités pour appliquer ses forces. Les « lettres historiques » de Lavrov sont devenues un « coup de tonnerre » et l’un des incitatifs idéologiques pour organiser les activités pratiques de l’intelligentsia révolutionnaire.
Biographie (Pierre Lavrov) après 1870
De retour d'exil, le révolutionnaire parvient à quitter illégalement le pays et à se rendre à Paris. Là, il contacte des représentants du mouvement syndical d'Europe occidentale et rejoint la Première Internationale. Au cours de son existence, il se rend à Londres afin d'organiser l'assistance à ses camarades assiégés.
Lors de son séjour dans la capitale de l'Empire britannique, Lavrov a rencontré Marx et Engels.
En 1873-1877, le révolutionnaire devient rédacteur en chef du magazine « Forward » et du journal bihebdomadaire du même nom, porte-parole de la direction du populisme russe, appelé « Laurisme ». Après l'assassinat d'Alexandre II, Piotr Lavrovitch se rapproche de la Narodnaya Volya. Il a même accepté de rédiger le « Bulletin de la volonté du peuple » avec L. Tikhomirov.
Dans le même temps, son autorité internationale grandit. Il suffit de dire qu'en juillet 1889, les membres du parti arménien Hunchak, premier parti socialiste ayant des branches en Perse et dans l'Empire ottoman, autorisèrent Peter Lavrov à le représenter au Congrès de la IIe Internationale.

dernières années de la vie
Jusqu'à ses derniers jours, Piotr Lavrov a continué à entretenir des liens avec le mouvement révolutionnaire. Cependant, à la fin de sa vie, il s’intéresse davantage aux questions liées à l’histoire de la philosophie. À la suite de ses recherches scientifiques, plusieurs ouvrages théoriques ont été rédigés, dont la monographie « Problèmes de compréhension de l’histoire ».
Piotr Lavrov, dont les idées principales étaient à la base du mouvement Narodnaya Volya, est décédé à Paris à l'âge de 72 ans et a été enterré au cimetière du Montparnasse.
Il a laissé derrière lui un vaste patrimoine littéraire, comprenant 825 œuvres et 711 lettres. Il est également l'auteur de plusieurs dizaines de poèmes politiques, parmi lesquels « La Marseillaise ouvrière », qui commence par les mots « Renonçons au vieux monde... », fut particulièrement populaire, puis mis en musique. Au cours des deux premières décennies du XXe siècle, cette chanson était l'une des plus fréquemment interprétées lors des grèves, des grèves, ainsi que des congrès des révolutionnaires, ainsi que dans les premières années du pouvoir soviétique et des députés du peuple.
Vues philosophiques
Dans la science officielle, il est d'usage de classer Lavrov parmi les éclectiques. Et cela est tout à fait justifié, puisque dans sa philosophie positiviste-agnostique, il a tenté de combiner les systèmes de Hegel, F. Lange, Feuerbach, Comte, Proudhon, Spencer, Chernyshevsky, Bakounine et Marx.
Selon lui, l’histoire est faite à volonté par une minorité morale et instruite, c’est pourquoi la première tâche des révolutionnaires est de développer un idéal moral.
Dans les années 1870, Lavrov a gagné d’ardents partisans, ce qu’on appelle le groupe des tours. En outre, il est devenu le chef reconnu de l’aile droite des révolutionnaires de l’Empire russe. Cependant, cette situation ne dura pas longtemps et bientôt de nombreux partisans de son idéologie se tournèrent vers le bakounisme plus radical. Néanmoins, le lavrisme a joué un rôle important dans la préparation des membres aux futurs premiers cercles sociaux-démocrates.

Vous savez maintenant qui était P. Lavrov. Étant l'un des rares représentants de la classe noble qui cherchait sincèrement à améliorer la situation des ouvriers et des paysans, Piotr Lavrovitch n'a pas été oublié par les autorités du premier État ouvrier et paysan au monde. En son honneur, la rue Furshtatskaya à Leningrad a notamment été renommée. Grâce à cela, de nombreux habitants de Saint-Pétersbourg connaissent aujourd'hui le palais Pierre Lavrov, où se déroulent les cérémonies de mariage. Et c'est assez symbolique, puisque le célèbre philosophe a autrefois sacrifié son bien-être financier pour épouser la femme qu'il aimait, puis a vécu avec elle pendant trente années heureuses.
LAVROV, PIERRE LAVROVITCH(1823-1900) – philosophe, sociologue, publiciste russe, théoricien du populisme révolutionnaire. Surnoms - Arnoldi, Dolengi, Kedrov, Mirtov, Stoik, Stoletov, environ 60 au total.
Né le 2 juin 1823 dans le village de Melikhovo, district de Velikolutsk. Province de Pskov dans une famille de nobles héréditaires. Après avoir reçu une éducation à domicile, il entre à l'école d'artillerie de Saint-Pétersbourg, où il est considéré comme le meilleur élève de M. Ostrogradsky, académicien des sciences militaires. Après avoir obtenu son diplôme universitaire en 1842, il reste avec lui comme précepteur, puis comme professeur de mathématiques. En 1844-1846, il enseigna les matières mathématiques dans les institutions militaires de Saint-Pétersbourg.
Les révolutions de 1848-1849 dans les pays européens sont devenues une incitation à la maturation spirituelle de Lavrov. Sous leur influence, il écrivit un certain nombre de poèmes antigouvernementaux ( Prophétie, Au peuple russe), qu'il envoya à Londres à A.I. Herzen, qui les publia immédiatement. De formation encyclopédique, il commença en 1852 à publier des articles sur la technologie militaire, les sciences physiques et mathématiques, les sciences naturelles, la pédagogie et la philosophie. Il vivait de travail littéraire et d'enseignement de l'histoire et des langues étrangères en tant que professeur au foyer, ayant perdu son héritage à cause d'une querelle avec son père (il n'était pas satisfait de son mariage avec une veuve avec deux enfants).
Depuis 1857, il collabore aux publications de Saint-Pétersbourg « Notes domestiques », « Bibliothèque de lecture », « Mot russe ». Ses articles sur des questions controversées de notre époque ont été publiés dans "Bell" d'Herzen, dans lequel Lavrov écrivait sur la nécessité d'abolir le servage et d'améliorer la situation des paysans. .
En 1858, il fut promu colonel, reçut le diplôme universitaire de professeur et devint rédacteur adjoint du Artillery Journal. Dans le cadre du développement de sa propre « philosophie pratique », dont la base était, selon ses propres termes, « l'anthropologisme » en tant que compréhension philosophique universelle du monde, fondée sur la critique de l'idéalisme religieux et centrée sur l'homme en tant que partie de la univers, ses articles ont été publiés : hégélisme(1858), Essais sur des questions de philosophie pratique : personnalité (1860), Trois conversations sur l'importance contemporaine de la philosophie (1861).
En 1861, il participe à l'édition Dictionnaire encyclopédique compilé par des scientifiques et des écrivains russes; en devint bientôt le rédacteur en chef. Le rapprochement de Lavrov avec N.G. Chernyshevsky, N.K. Mikhaïlovski et d’autres démocrates révolutionnaires, y compris les créateurs de la première organisation « Terre et Liberté », remonte à cette époque.
En désaccord avec les idéologues de Sovremennik sur des questions philosophiques, Lavrov a participé à des actions organisées et menées par eux : il a pris la parole lors d'une réunion étudiante en 1861, a signé des protestations publiques contre l'arrestation du populiste M. L. Mikhailov et contre le projet de charte universitaire. , qui a privé les universités du droit à l’autonomie. La même année, il devient l'un des organisateurs et des anciens du « Club d'échecs » littéraire, qui devient le centre des rencontres de l'intelligentsia libérale.
En 1862, il se rapproche de Tchernychevski et de N.V. Shelgunov, mais n'approuve pas leurs tentatives d'appeler les paysans à la révolution (« À la hache ! »), estimant qu'il est possible de parvenir pacifiquement à « l'harmonie des intérêts de l'individu de la classe dirigeante ». et les intérêts de la majorité de la classe subordonnée », a soulevé la question de la mise en œuvre des « lois de la morale » dans la pratique.
En 1864-1866, il fut le rédacteur non officiel du Foreign Messenger. En avril 1866, après la tentative d'assassinat d'Alexandre II par D.V. Karakozov, il fut arrêté, en 1867 il fut exilé à Totma, puis dans la ville de Kadnikov, dans la province de Vologda.
En 1868-1869, dans la revue « Week », il publie l'une de ses œuvres les plus célèbres : Lettres historiques, dans lequel il formule la « méthode subjective en sociologie », qui, selon les contemporains, est devenue « l’évangile de la jeunesse sociale-révolutionnaire ». Il glorifiait « la pensée humaine comme la seule force active transformant la culture en civilisation ».
En février 1870, des amis (parmi lesquels G.A. Lopatin) l'aident à échapper à l'exil. Il émigre avec sa famille à Paris, où il est accepté comme membre de la Société Anthropologique. À l'automne, il rejoint l'Association internationale des travailleurs (Première Internationale), en 1871 il devient membre de la Commune de Paris. .
En 1871, au nom des communards, il se rend à Londres, où il se rapproche de K. Marx et de F. Engels. Reconnaissant le prolétariat comme une force sociale importante, Lavrov restait d'avis que la paysannerie jouait le rôle principal dans le développement de la Russie. En 1873-1875, il publie la publication non périodique « Forward », en 1875-1877 - un journal du même nom (publié à Zurich et à Londres). Les articles de Lavrov sur « la vision réelle du monde contre la vision théologique du monde », sur « la lutte du travail contre l'usage vain des bienfaits de la vie », sur « l'égalité contre le monopole » indiquaient qu'il était devenu un égalitaire social établi, un partisan de l'égalité sociale. égalité.
Il considérait que sa tâche principale était la propagande des idées de révolution parmi les paysans, c'est pourquoi la tendance proche de lui dans le populisme est appelée, d'après V.I. Lénine, « propagande ». Il partageait des vues populistes sur la communauté paysanne comme base du futur système social, insistait sur la priorité des problèmes sociaux sur les problèmes politiques et développait l'idée del'originalité et du caractère unique du chemin historique de la Russie. S'exprimant contre l'anarchisme, la rébellion, l'aventurisme révolutionnaire de M.A. Bakounine et les tactiques conspiratrices de P.N. Tkachev, Lavrov a estimé que « la violence révolutionnaire est possible jusqu'à un certain minimum ». Dans le même temps, selon lui, « la restructuration de la société russe doit être menée non seulement pour le bien du peuple, non seulement pour le peuple, mais aussi à travers le peuple ».
En 1878, il établit des contacts avec la clandestinité révolutionnaire polonaise et russe et fut l'initiateur de réunions de groupe d'émigration révolutionnaire russe, promouvant « les actions pratiques des socialistes russes en Russie ». Associé à la fois à la Redistribution noire et à Narodnaya Volya en 1879, il prend en charge la représentation de cette dernière à l'étranger. Estimant que la révolution sociale en Russie ne viendrait pas de la ville mais du village, il appelait les intellectuels à former des propagandistes parmi le peuple, mais il était lui-même enclin à reconnaître la terreur comme une méthode de lutte contre l'autocratie.
En 1882, avec V.I. Zasulich, il organisa la « Croix-Rouge de la volonté populaire », y voyant « le seul parti révolutionnaire de Russie ». Il fut expulsé de Paris par les autorités, mais revint dans cette ville sous un autre nom. Pendant son séjour là-bas, il publiait constamment dans des magazines étrangers et russes - « Otechestvennye zapiski », « Delo », « Knowledge », en utilisant différents pseudonymes.
En 1883-1886, il fut rédacteur en chef du « Bulletin de Narodnaya Volya » (avec L.A. Tikhomirov).
Il entretenait des relations personnelles et une correspondance avec de nombreux socialistes russes et étrangers de France, Pologne, Allemagne, Serbie, Croatie, République tchèque, Bulgarie, Angleterre, pays scandinaves et États-Unis. Avec G.V. Plekhanov, il a participé à l'organisation de la « Bibliothèque sociale-révolutionnaire russe » populiste.
Depuis 1889 - délégué de Russie au Congrès socialiste international de Paris, participant à la création de la « Bibliothèque socialiste » de la Fondation socialiste littéraire de Zurich. La même année, il participe au Congrès de Paris de la IIe Internationale, où il fait un rapport sur le développement des idées socialistes en Russie. Il y fut l'un des premiers à souligner le début de la lutte prolétarienne de masse dans le pays.
En 1892-1896, il participa à la publication Matériaux pour l'histoire du mouvement social-révolutionnaire russe. En étudiant l'histoire des enseignements socialistes, il a développé sa propre théorie du socialisme ouvrier, basée sur les principes de propriété commune, de travail universel et de communauté laïque autonome. Il a souligné le rôle du marxisme dans le socialisme scientifique, mais s’est montré sceptique quant aux activités des sociaux-démocrates en Russie et du groupe « Émancipation du travail » de Plekhanov.
Ayant défini sa vision du monde comme « anthropologisme », Lavrov se considérait comme l’héritier de la pensée socio-théorique mondiale, commençant par Protagoras et les anciens sceptiques et se terminant par O. Comte, L. Feuerbach, G. Spencer et les néo-kantiens. Plus tard, il fut influencé par certaines idées de Marx.
Dans ses œuvres à caractère philosophique ( Théorie mécanique du monde, 1859; La philosophie pratique de Hegel, 1859; Essais sur des questions de philosophie pratique, 1861), l'esprit de « philosophie positive » règne : l'importance décisive de la connaissance scientifique est justifiée, diverses formes de métaphysique sont fortement critiquées. Lavrov a également critiqué le « matérialisme vulgaire » des naturalistes allemands (K. Buchner, L. Vocht, etc.), y voyant cependant non pas tant une vulgarisation de la philosophie matérialiste, mais l'une de ses formes historiques les plus cohérentes. Le matérialisme, avec sa doctrine d’une substance unique indépendante de la conscience, n’était pour lui qu’une des options de la foi métaphysique. Le sujet de la philosophie, selon Lavrov, est la « personne dans son ensemble », et elle ne peut donc être qu’une « anthropologie philosophique ». Ce n'est que grâce à une personne, comprenant son expérience historique et individuelle, que l'on peut parvenir à une compréhension véritablement scientifique et philosophique de la réalité extérieure.
Considérant comme sujet la personne entière, la philosophie elle-même doit avoir une unité, ce qui peut revêtir une importance exceptionnelle non seulement dans le domaine de la connaissance, mais aussi dans le domaine de la vie et de la créativité. « La philosophie dans la connaissance est la construction de toutes les informations en un système cohérent, la compréhension de toutes choses comme une seule, l'unité dans la compréhension. La philosophie dans la créativité est l’introduction d’une compréhension du monde et de la vie dans l’activité créatrice, l’incarnation de l’unité comprise de toutes choses dans une image, sous une forme harmonieuse, l’unité de la pensée et de l’action. L’enseignement de Lavrov sur la personne dans son ensemble et sur l’ensemble de la philosophie contient une orientation éthique caractéristique de la pensée russe en général. Fondant, pour éviter les « illusions métaphysiques », l’épistémologie sur le principe du scepticisme (« le processus de conscience en lui-même ne permet pas de décider s’il est lui-même le résultat de l’être réel, ou si l’être réel en est le produit » ), Lavrov a fait une exception fondamentale dans un seul domaine : l’éthique. « L’absence d’un principe sceptique dans la construction de la philosophie pratique, affirmait-il, lui confère une force et une indépendance particulières par rapport aux théories métaphysiques ».
Une personne agissant dans l'histoire se reconnaît comme une personne libre, et c'est cette « conscience de liberté » qui devient, selon Lavrov, la source des relations morales dans la société. «Je pars du fait de la conscience de la liberté, du fait de la conscience des idéaux, et sur la base de ces faits je construis un système cohérent de processus moraux.» Bien que la « conscience de la liberté » ne prouve pas la réalité du libre arbitre, elle (cette conscience) et les idéaux moraux formés sur sa base sont absolument nécessaires au progrès historique. En s'efforçant de réaliser ses idéaux, une personne se crée en tant qu'individu. En fin de compte, tout dépend de lui-même, puisqu'il n'y a pas de qualités morales innées. "L'homme n'est inné qu'avec le désir du plaisir, et parmi les plaisirs, une personne développée développe en elle-même le plaisir de la vie morale..."
Dans le concept sociologique de Lavrov, les véritables personnages historiques sont des « individus développés, dotés d’un esprit critique » – des représentants progressistes et révolutionnaires de la couche instruite de la société. Ces individus déterminent les critères de progrès, les objectifs et les idéaux du développement social. Cette approche conduit à reconnaître le rôle décisif du principe subjectif dans l'histoire. Pour Lavrov, c'est la méthode subjective qui fonctionne en sociologie : les changements sociaux sont originaux, uniques, ils sont le résultat des efforts de l'individu, et les méthodes scientifiques objectives ne sont pas applicables ici. Rêvant de transformations socialistes en Russie, Lavrov, comme d'autres dirigeants du populisme, plaçait ses espoirs dans la communauté paysanne, dans « la pénétration des principes du travail collectif et de la propriété collective dans les masses travailleuses », croyait en l'inclusion progressive du peuple. dans la vie sociale et politique active, dans « l'initiative populaire ».
Lavrov n’était pas l’épigone du positivisme et du matérialisme européens. Ses opinions philosophiques et sociologiques étaient tout à fait indépendantes et originales. Au centre de sa vision du monde, il y avait toujours une certaine « personnalité à l’esprit critique », capable d’acquérir de nouvelles vues et possédant un noyau moral rigide. Il considérait l’intelligentsia avancée – « un petit groupe d’individus » – comme le moteur du progrès social, mais il l’imaginait assez vaguement comme s’efforçant de « réaliser la vérité et la justice dans les formes sociales ». Estimant que seule l'unité de l'intelligentsia avec le peuple peut créer un « socialisme moral », il écrit : « nous ne voulons pas que le pouvoir violent remplace l'ancien... Le futur système de la société russe... doit traduire en action le besoins de la majorité, qu’ils ont eux-mêmes reconnus et compris. » . Le socialisme, selon lui, était « le résultat inévitable du processus moderne de la vie économique » et, plus que d’autres concepts de bien public, il correspondait à l’idéal moral de l’humanité. Mais les « syndicats de la communauté rurale et des artels » étaient censés aider à y parvenir. Il a qualifié la Commune de Paris de modèle d'État socialiste.
Les vues contradictoires de Lavrov sont devenues une sorte de lien intermédiaire entre le matérialisme de Tchernychevski et le subjectivisme de Mikhaïlovski. Le « laurisme » a été critiqué par Plekhanov et Lénine. Mais les rangs des partisans de Lavrov en Russie restaient très soudés ; Sa position a souvent été adoptée par les sociaux-démocrates, qui se sont retirés des activités pratiques et se sont lancés dans ce qu'on appelle la « culture » (propagande).
Au cours des dernières années de sa vie, il écrivit un certain nombre d'ouvrages généraux : Expérience de l'histoire de la pensée moderne(commencé en 1898 et resté inachevé) ; Propagandistes populistes 1873-1878(a été publié après sa mort en 1907). Laissé inachevé Les défis de la compréhension de l’histoire Et Histoire de la pensée avec réflexions sur la révolution et la morale.
Lavrov est décédé à Paris le 25 janvier (6 février 1900) ; ses funérailles au cimetière du Montparnasse ont été accompagnées d'un cortège de huit mille personnes. Des socialistes de nombreux pays ont pris la parole sur la tombe.
Les œuvres rassemblées de Lavrov ont été publiées dans 14 numéros entre 1917 et 1920.
En 1923, une rue de Saint-Pétersbourg porte son nom.
Irina Pushkareva, Lev Pouchkarev.