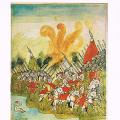Le monde scientifique célèbre le 200e anniversaire de la naissance de Charles Robert Darwin, fondateur de la théorie scientifique de l'évolution du monde organique de la Terre. La théorie de Darwin est largement connue, largement discutée et critiquée à plusieurs reprises, mais elle reste à ce jour « la seule vraie ».
Néanmoins, les processus d’évolution sur Terre recèlent encore de nombreux mystères. Par exemple, toutes les heures, trois espèces d’animaux et quatre espèces de plantes disparaissent de la surface de la Terre. Ces statistiques sont généralement citées par les « verts » lorsqu’il s’agit de l’impact néfaste de l’homme sur la nature. Si ces données sont correctes, alors en un an, la biosphère de notre planète sera épuisée par plus de 60 000 espèces ! Mais tout n'est pas si mauvais : les représentants disparus de la flore et de la faune sont remplacés par de nouveaux. Les scientifiques les découvrent régulièrement dans la nature. D'où viennent-ils?
Des choses étranges dans la nature
Ancien directeur du programme des Nations Unies pour environnement Klaus Toepfer affirme que le nombre d'espèces menacées n'a cessé d'augmenter depuis 2000. Il est difficile de dire à quel point le cliché commun concernant trois espèces d'animaux par heure est vrai, car il est impossible de maintenir des statistiques précises dans ce domaine. Il existe des données avec des chiffres plus doux : ce ne sont pas trois espèces d'animaux qui disparaissent par heure, mais une seule par jour. Mais Klaus Toepfer assure que de la fin du XVIe siècle aux années 70 du siècle dernier, notre planète a perdu 109 espèces d'oiseaux, 64 espèces de mammifères, 20 espèces de reptiles et trois espèces d'amphibiens. Pourquoi si peu ? Après tout, il n'est pas difficile de calculer qu'en quatre siècles, plus de 140 000 espèces auraient dû disparaître ?!, écrit sunhome.ru
"Car lorsqu'ils parlent de déclin de la biodiversité, ils pensent avant tout aux protozoaires ou aux insectes", explique le coordinateur du Programme de conservation de la biodiversité du Fonds mondial. faune Vladimir Krever. "Ils représentent 95 pour cent de la biomasse totale de la Terre, mais nous ne les remarquons tout simplement pas. " D'ailleurs, les scientifiques se disputent encore sur le nombre d'insectes qu'il y a sur Terre - soit 1,5 million d'espèces, soit 2,5 millions. immense et fermé par rapport à nous dans le monde, il a ses propres processus en cours. Selon Krever, dire qu'ils disparaissent est une erreur, voire une spéculation. Une modification s'opère, une transition vers des formes intermédiaires. L'apparition des hybrides est possible non seulement chez les insectes, mais aussi chez les poissons, les amphibiens ou, disons, les rats. Quant aux vertébrés en voie de disparition, ce processus se produit à raison de 1 à 2 espèces toutes les quelques décennies, pas plus.
Lors d'une conversation avec notre correspondant, la candidate en sciences biologiques Zoya Sokolova a noté que la nature elle-même apporte souvent une confusion sur la question du nombre d'espèces : « Il est important que les scientifiques établissent une position systématique, trouvent la place d'une espèce particulière dans la classification de la faune. Par exemple, il existe un tel poisson - le golomyanka, qui ne vit que dans le lac Baïkal. Ils ont très peu de mâles, ils sont petits et non viables. Le mâle pousse jusqu'aux branchies de la femelle et, en fait, devient son organe appendice. La question est, est-ce déjà le nouveau genre ou est-ce toujours la même Golomyanka ? Et il y a suffisamment de bizarreries de ce genre dans la nature. »
Il s'avère qu'en biologie, il n'existe pas de données exactes sur le nombre d'espèces. On pense qu’il s’agit simplement de comptabilité, pas très intéressante et pas très scientifique. Chaque spécialiste étudie attentivement son groupe. Si quelqu'un, par exemple, étudie les coléoptères - et même pas tous (il existe plus de 300 000 espèces), mais seulement certaines familles - alors il ne connaît peut-être pas bien les mouches des fruits. Et tout passionné qui entreprend de systématiser l'information sera confronté au fait que dans une monographie, 1035 espèces d'un groupe d'animaux donné seront indiquées, et dans une autre - 988. Et tout cela parce que l'auteur du deuxième ouvrage scientifique n'a pas considéré certaines espèces sont des espèces !
« Je me souviens qu'un de nos professeurs, à propos de biodiversité, avait dit : il y a plusieurs pots de fleurs dans cette classe, donnez-moi du temps, et j'y trouverai une ou deux nouvelles espèces d'acariens du sol », raconte un chercheur principal. au Département d'évolution biologique, Faculté de biologie, Université d'État Sergueï Ivnitski de Moscou. - Cela caractérise le niveau de connaissance de la biodiversité dans notre voisinage immédiat. Puisque l'inventaire de la faune est loin d'être complet (et la révision des espèces est un processus constant) , cela n'a aucun sens de résumer. Si une telle base de données est créée, elle sera très dynamique." .
Il existe un Code international de nomenclature zoologique. Il approuve les normes selon lesquelles la nouvelle espèce est décrite. Si vous pensez avoir découvert un animal jusqu'alors inconnu, vous devez le publier dans une revue spécialisée, puis convaincre les évaluateurs que l'espèce n'a pas été décrite auparavant. Et ce n’est pas un fait que les experts seront d’accord avec vous. Les différences peuvent être insignifiantes et invisibles à l’œil nu. On croyait autrefois que le moustique commun du paludisme n’était représenté que par une seule espèce. Et puis il s’est avéré que c’était tout un groupe. Les différences résident dans le stade d’œuf du développement de l’insecte. Depuis, il a été inclus dans les manuels scolaires.
Eh bien, lorsque les généticiens se sont associés aux biologistes, il s'est avéré que l'ensemble des chromosomes d'animaux apparemment identiques peut être complètement différent. Par exemple, il existe des dizaines d'espèces de campagnols gris ou de souris des bois, mais il est presque impossible d'en distinguer beaucoup par leurs caractéristiques externes. Mais la différence dans le nombre et la structure de leurs chromosomes peut être très significative, ce qui est clairement visible au microscope. Et en même temps, les espèces étroitement apparentées ne se croisent pas - elles sont capables de distinguer les « amis » des « extraterrestres » par l'odorat et certaines autres caractéristiques. Sergei Ivnitsky compare la découverte de nouvelles espèces à l'intérieur d'espèces existantes à une poupée gigogne : ils ont enlevé le couvercle - il y en a un autre, en dessous - un troisième, etc.
Et dans l'acide il y a la vie
Malgré l'absence socle unique, ici et là, le nombre d'animaux et de plantes officiellement enregistrés clignote - environ 1,8 million d'espèces. Et cette liste est régulièrement renouvelée - en règle générale, grâce aux insectes qui, comme on l'a dit, constituent l'écrasante majorité de la biomasse. Mais il s’avère que des « animaux » plus grands, inconnus de la science, parcourent également la surface de la planète. Les messages sur ce sujet ont commencé à apparaître uniquement dans dernières années. Ainsi, un groupe international de scientifiques a récemment publié un rapport sur les recherches menées dans les eaux profondes de l'Antarctique entre 2002 et 2005. Plus de 700 espèces d'invertébrés jusqu'alors inconnues ont été découvertes dans ce coin de l'océan mondial. Une autre expédition dans les forêts du Suriname a découvert 24 espèces, dont six poissons et une grenouille.
En 2006, une véritable sensation s'est produite : une nouvelle espèce de mammifères a été découverte non pas quelque part dans la nature sauvage d'Afrique, mais en Europe. La créature s'appelait la souris chypriote (mus cypriacus) - c'est à Chypre qu'elle a été découverte, et l'étude a montré que cette espèce vit sur l'île depuis environ 9 à 10 000 ans ! Leur « parent » chypriote se distinguait des autres types de souris par des yeux, des oreilles et une tête plus grands.
Toujours en 2006, les résultats des recherches menées par l'expédition du World Wildlife Fund sur l'île de Kalimantan (Bornéo) ont été publiés. Dans les marais, nous avons réussi à trouver des serpents uniques capables de changer de couleur. Dans la partie centrale de l'île, où subsistent des forêts impénétrables, une rainette rouge-brun, jusqu'alors inconnue de la science, a été découverte. Environ 30 espèces de poissons ont été découvertes, qui se sont révélées être les plus petits vertébrés du monde. Leur longueur ne dépasse pas un centimètre. De plus, l’eau des marais où ils vivent est 100 fois plus acide que l’eau de pluie ordinaire. Autrement dit, si auparavant on pensait que ces eaux étaient tout simplement impropres à la vie, cela est maintenant devenu clair : c'est l'environnement acide qui offre des conditions confortables à de nombreuses espèces d'animaux et de plantes que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans la nature.
Au total, près de 400 nouvelles espèces d'animaux ont été découvertes et classées sur l'île de Bornéo au cours des 15 dernières années. Il s'agit d'un véritable « monde perdu » : des rhinocéros, des éléphants, des panthères nébuleuses et des gibbons, menacés dans d'autres régions du monde, y ont été préservés. Seule la Nouvelle-Guinée peut rivaliser avec Bornéo. Il y a deux ans, 20 nouvelles espèces de grenouilles, quatre espèces de papillons ont été trouvées sur cette île, et en 2007, ils ont découvert une nouvelle espèce d'opossum, qui s'est avérée être l'un des plus petits marsupiaux du monde, ainsi qu'un géant rat.
"Sous le capot" de l'évolution
Entre autres choses, les gens ne remarquent pas comment l'évolution se poursuit dans la nature. Lorsqu’on critique le darwinisme, une question amateur est parfois posée : pourquoi le singe ne se transforme-t-il pas en humain maintenant ? Dites, cela ne signifie-t-il pas que l’homo sapiens ne pourrait pas descendre de primates et n’a aucun lien « apparenté » avec eux ? Ou que l'évolution est terminée ? "Non, cela ne veut pas dire cela. Le fait est que les singes se sont éloignés il y a longtemps de la même branche commune avec l'homme. Nous avons suivi une voie de développement, eux en ont suivi une autre", répond Sergueï Ivnitski. "Le point clé était que l'homme "Les ancêtres sont descendus de l'arbre jusqu'au sol, mais les ancêtres des singes sont restés. Ce sont des habitats différents. Eh bien, un singe moderne descend d'un arbre, et où ira-t-il ? Sortra-t-il sur l'autoroute ? Est-ce qu'il développer des puits de pétrole ?
Néanmoins, selon Sergueï Ivnitski, l’évolution se poursuit « juste devant les fenêtres ». Peu de gens savent que les moustiques des caves qui nous sont si familiers ne se sont multipliés dans de nombreuses villes du monde que dans les années 20 et 30 du siècle dernier. Auparavant, ces sangsues vivaient dans la nature dans des réservoirs sales, puis ont soudainement commencé à peupler les villes du monde à un rythme semblable à celui d'une avalanche. De plus, leurs populations ont «appris» depuis longtemps à exister sans suceurs de sang, en attendant la bonne occasion de boire du sang. Comment cela s’est produit n’est pas clair. Mais il y a un saut évolutif.
Un autre exemple est le corbeau. Dans la nature sauvage et intacte, c'est désormais un oiseau rare, il n'est pas capable de picorer un cône ni d'attraper un insecte. Mais le corbeau s'est adapté à la vie dans une ville où il y a beaucoup de déchets, et grâce à sa forte activité rationnelle, il fait tout simplement des miracles. Les corbeaux jettent des craquelins dans les flaques d'eau pour les tremper et mettent des noix sous les roues des voitures et même sur les rails du tramway. Et quand ils sont pleins, ils adorent faire des bêtises, effrayer les passants ou rouler hors des dômes des églises. Il est temps de se poser la question : cet oiseau est-il devenu une créature intelligente ?
Au cours de l’histoire, des millions d’espèces animales ont changé sur Terre. La durée de vie moyenne d'une espèce est d'environ un million d'années. Bien que certains vivent jusqu'à 60 à 70 millions d'années, comme le cœlacanthe, un ancien poisson à nageoires lobes. Bien sûr, il serait intéressant de comprendre les mécanismes d’apparition et de disparition des espèces (ne parlons pas de destruction artificielle). Sergei Ivnitsky estime qu'une telle analogie est ici appropriée. Pour savoir comment les voitures roulent, tournent et s'arrêtent, vous devez soulever le capot et regarder en dessous. Le plus intéressant est là. Et qu’avons-nous réussi à découvrir « sous le capot » de l’évolution ? La sélection naturelle comme moteur de tout le processus. Les mutations génétiques comme point de départ. La direction du mouvement - les changements de signes - ont également été établies.
"La sélection naturelle ne se soucie pas de la manière dont une variété obtient un avantage sur une autre", explique Sergueï Ivnitski. "A chaque étape, la sélection agit aveuglément en faveur de ceux qui laissent une progéniture plus sexuellement mature. Mais en conséquence, le cours de l'évolution pour une certaine raison devient ordonnée, elle se développe dans certaines directions, comme l'écoulement de l'eau dans le lit d'un canal. À ce jour, la question la plus intrigante demeure : comment un changement aléatoire peut-il conduire à la construction d'une structure stricte ? Sans réponse à cette question question, il est impossible d'expliquer l'origine de la vie sur Terre. Après tout, dès qu'une molécule complexe s'est formée, "elle doit immédiatement commencer à s'effondrer. Ceci est démontré par la deuxième loi de la thermodynamique - sur l'augmentation constante de l'entropie , c'est-à-dire le chaos. Mais dans le cas de l'évolution, c'est le contraire qui est vrai : le mouvement se produit du simple au complexe, du chaos à l'ordre.
Les scientifiques placent leurs espoirs dans la théorie de la dynamique des systèmes hors équilibre. Cette direction de la physique s'est développée au cours des 20 à 25 dernières années, on l'appelle un nouveau regard en science et en biologie en particulier. Et certains le comparent à la théorie de la relativité. Cette théorie tente d'expliquer comment de nouvelles propriétés inhabituelles apparaissent dans un système complexe qui transmet beaucoup d'énergie. C’est ce dont nous avons besoin pour expliquer les mystères de l’évolution.
Depuis longtemps, l’homme est émerveillé par la diversité du monde organique. Comment est-ce arrivé ? La doctrine de la sélection naturelle explique comment de nouvelles espèces se forment dans la nature. Darwin a basé ses idées sur les races domestiques. Au départ, les races d’animaux domestiques étaient moins diversifiées qu’aujourd’hui. Poursuivant des objectifs différents, les gens ont procédé à une sélection artificielle dans des directions différentes. En raison de la race divergé, c'est-à-dire des caractéristiques divergentes entre eux et avec leur race ancestrale commune.
Divergence dans les conditions naturelles. La divergence se produit tout le temps dans la nature et sa force motrice est la sélection naturelle. Plus les descendants d’une espèce sont différents les uns des autres, plus ils se répartissent facilement dans des habitats plus nombreux et plus diversifiés et plus il est facile de se reproduire. Darwin raisonnait ainsi. Certains animaux prédateurs à quatre pattes ont atteint la limite de leur capacité à exister dans cette zone. Supposons que les conditions physiques du pays n'aient pas changé ; ce prédateur peut-il continuer à se reproduire ? Oui, si les descendants occupent les places occupées par d’autres animaux. Et cela peut arriver à l'occasion du passage à d'autres aliments ou à de nouvelles conditions de vie (dans les arbres, dans l'eau, etc.). Plus les descendants de ce prédateur sont diversifiés dans leurs caractéristiques, plus ils se propageront largement.
Darwin donne un exemple. Si vous semez des herbes d'un type sur un terrain et sur un autre, similaire, des herbes appartenant à plusieurs espèces ou genres différents, alors dans le second cas, la récolte totale sera plus importante.
Dans la nature, sur une superficie légèrement supérieure à 1 m 2 , Darwin a dénombré 20 espèces végétales différentes appartenant à 18 genres et 8 familles.
De tels faits confirment la justesse de la position avancée par Darwin : "... la plus grande somme de vie est réalisée avec la plus grande diversité de structure..." Entre plantes d'une même espèce, avec leurs besoins identiques en sol, en humidité, l'éclairage, etc., la compétition biologique la plus féroce se produit. La sélection naturelle préservera les formes les plus différentes les unes des autres. Plus les différences entre les caractéristiques adaptatives des formes deviennent visibles, plus les formes elles-mêmes divergent.
Grâce à la sélection naturelle, le processus d'évolution est divergent caractère : d'une forme initiale naît tout un « éventail » de formes, comme si des branches spéciales d'une racine commune, mais toutes ne reçoivent pas de développement ultérieur. Sous l'influence de la sélection naturelle, dans une série de générations infiniment longue, certaines formes se conservent, d'autres s'éteignent ; simultanément au processus de divergence se produit un processus d'extinction, et les deux sont étroitement liés l'un à l'autre. Les formes les plus divergentes ont le plus grand potentiel de survie dans le processus de sélection naturelle, car elles se font moins concurrence que les formes intermédiaires et ancestrales, qui s'éclaircissent et disparaissent progressivement.
Une variété est une étape vers la formation d’une espèce. Darwin imaginait que le processus de formation de nouvelles espèces dans la nature commence par la décomposition des espèces en groupes intraspécifiques, qu'il appelle variétés.
Grâce à la sélection naturelle et à la divergence, les variétés acquièrent des caractéristiques héréditaires de plus en plus distinctives et deviennent de nouvelles espèces spéciales.
La différence entre variété et espèce est très grande. Les variétés de la même espèce se croisent et produisent une progéniture fertile. En règle générale, les espèces dans des conditions naturelles ne se croisent pas, ce qui entraîne un isolement biologique des espèces.
Pour mieux expliquer comment le processus de spéciation se produit dans la nature, Darwin a proposé le diagramme suivant (Fig. 11).
Le diagramme montre les chemins évolutifs possibles de 11 espèces du même genre, désignées par les lettres A, B, C, etc. - jusqu'à L inclus. L'espacement entre les lettres montre la proximité entre les espèces.
Ainsi, les espèces désignées par les lettres D et E ou F et G sont moins semblables entre elles que les espèces A et B ou K et L, etc. Les lignes horizontales indiquent les étapes individuelles de l'évolution de ces espèces, chaque étape étant classiquement prise en compte. soit 1000 générations.
Retraçons l'évolution de l'espèce A. Un ensemble de lignes pointillées partant du point A représente ses descendants. En raison de la variabilité individuelle, ils différeront les uns des autres et de l'espèce mère A. Les changements bénéfiques seront préservés dans le processus de sélection naturelle. En même temps, il révélera son action utile divergence : les caractéristiques les plus différentes les unes des autres (lignes a 1 et m 1 du faisceau) resteront, s'accumuleront de génération en génération et divergeront de plus en plus. Au fil du temps, les taxonomistes reconnaissent a 1 et m 1 comme variétés spéciales.
Supposons qu'au cours de la première étape - les mille premières années - deux variétés clairement définies a 1 et m 1 soient issues de l'espèce A. Sous l'influence des conditions qui ont provoqué des changements dans l'espèce mère A, ces variétés continueront à changer. Peut-être qu'au dixième stade, ils auront de telles différences entre eux et avec l'espèce A qu'ils devraient être considérés comme deux espèces distinctes : a 10 et m 10. Certaines espèces disparaîtront et peut-être que seulement f 10 atteindra le dixième stade, formant ainsi une troisième espèce. Au dernier stade, 8 nouvelles espèces sont introduites, originaires de l'espèce A : a 14, q 14, p 14, c 14, f 14, o 14, e 14 et t 14. Les espèces a 14, q 14 et p 14 sont plus proches les unes des autres que des autres espèces et forment un genre, les espèces restantes forment deux autres genres. L'évolution des espèces I se déroule de la même manière.
Le sort des autres espèces est différent : parmi celles-ci, seules les espèces E et F survivent jusqu'au dixième stade, l'espèce E s'éteint ensuite. Notez en particulier l'espèce F 14 : elle a survécu jusqu'à ce jour presque inchangée par rapport à l'espèce mère F. Cela peut se produire si les conditions environnementales ne changent pas ou très peu sur une longue période de temps.
Darwin a souligné que dans la nature, seules les variétés les plus divergentes et les plus extrêmes ne sont pas toujours préservées ; les variétés moyennes peuvent également survivre et donner naissance à une progéniture. Une espèce peut en dépasser une autre dans son développement ; Parmi les variétés extrêmes, parfois une seule se développe, mais trois peuvent se développer. Tout dépend de la manière dont les relations infiniment complexes des organismes se développent entre eux et avec l’environnement.
Exemples de spéciation. Donnons des exemples de formation d'espèces, et nous utiliserons le terme sous-espèce, accepté en science au lieu de « variété ».
Des espèces largement répandues, telles que l'ours brun, le lièvre variable, le renard commun et l'écureuil commun, se trouvent de l'Atlantique à l'océan Pacifique et comptent un grand nombre de sous-espèces. Plus de 20 espèces de renoncules poussent dans la zone centrale de l'URSS. Ils descendent tous de la même espèce ancestrale. Ses descendants ont capturé divers habitats - steppes, forêts, champs - et, grâce à la divergence, se sont progressivement séparés les uns des autres, d'abord en sous-espèces, puis en espèces (Fig. 12). Découvrez d’autres exemples dans la même figure.
La spéciation continue aujourd'hui. Dans le Caucase vit un geai au plumage noir à l'arrière de la tête. Il ne peut pas encore être considéré comme une espèce indépendante ; c'est une sous-espèce du geai commun. Il existe 27 sous-espèces de bruants chanteurs dans les Amériques. La plupart d’entre eux semblent peu différents les uns des autres, mais certains présentent des différences marquées. Au fil du temps, les sous-espèces intermédiaires dans leurs caractéristiques peuvent disparaître et les plus extrêmes deviendront de jeunes espèces indépendantes, perdant la capacité de se croiser les unes avec les autres.
Le sens de l'isolation. L'immensité de l'aire de répartition de l'espèce favorise la sélection naturelle et la divergence. Cela se produit lorsqu'une espèce s'installe dans des zones isolées les unes des autres. Dans de tels cas, la pénétration des organismes d'une zone à une autre est fortement entravée et la possibilité de croisement entre eux est fortement réduite, voire totalement absente.
Donnons des exemples. Dans le Caucase, dans les zones séparées par de hautes montagnes, il existe des sous-espèces particulières de papillons, de lézards, etc. De nombreuses espèces et genres d'animaux ciliés vivent dans le lac Baïkal vers plats, crustacés et poissons que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Ce lac est séparé des autres bassins hydrographiques par des chaînes de montagnes depuis environ 20 millions d'années et n'est relié à l'océan Arctique que par des rivières.
Dans d'autres cas, les organismes ne peuvent pas se croiser en raison de isolement biologique. Par exemple, deux types de moineaux - le moineau domestique et le moineau des champs - restent ensemble en hiver, mais ils nichent généralement de différentes manières : le premier - sous les toits des maisons, le second - dans les creux des arbres, à la lisière de la forêt. . L'espèce de merle est actuellement divisée en deux groupes, encore indiscernables en apparence. Mais l’un d’eux vit dans les forêts profondes, l’autre reste à proximité des habitations humaines. C'est le début de la formation de deux sous-espèces.
Convergence. Dans des conditions d'existence similaires, des animaux de groupes systématiques différents acquièrent parfois des adaptations similaires à l'environnement s'ils sont exposés au même facteur de sélection. Ce processus est appelé convergence-- convergence des signes. Par exemple, les membres avant creuseurs d'une taupe et d'une courtilière sont très similaires, bien que ces animaux appartiennent à des classes différentes. Les cétacés et les poissons se ressemblent fortement par la forme de leur corps, et les membres des animaux nageurs appartenant à différentes classes sont similaires. Les caractéristiques physiologiques sont également convergentes. L'accumulation de graisse chez les pinnipèdes et les cétacés s'explique par le résultat de la sélection naturelle du milieu aquatique : elle réduit les pertes de chaleur de l'organisme.
La convergence au sein de groupes systématiques éloignés (types, classes) ne s'explique que par l'effet de conditions d'existence similaires sur le cours de la sélection naturelle. La convergence chez des animaux relativement étroitement apparentés est également influencée par l'unité de leur origine, ce qui semble faciliter l'apparition de changements héréditaires similaires. C'est pourquoi on l'observe plus souvent au sein d'une même classe.
Variété d'espèces. La doctrine de Darwin sur l'évolution du monde organique explique la diversité des espèces comme le résultat inévitable de la sélection naturelle et de la divergence des caractères qui y est associée.
Peu à peu, au cours du processus d'évolution, les espèces sont devenues plus complexes et le monde organique a atteint un niveau de développement toujours plus élevé. Or, partout dans la nature, les animaux et les plantes coexistent simultanément, avec des degrés de complexité variables dans leur organisation.
Pourquoi la sélection naturelle n’a-t-elle pas « élevé » tous les groupes peu organisés au plus haut niveau d’organisation ?
Par sélection naturelle, tous les groupes de plantes et d’animaux ne sont adaptés qu’à leurs propres conditions d’existence et ne peuvent donc pas tous s’élever au même niveau élevé d’organisation. Si ces conditions n’exigeaient pas une augmentation de la complexité de la structure, alors son degré n’augmenterait pas car, selon les mots de Darwin, « dans des conditions de vie très simples, une organisation élevée ne fournirait aucun service ». Dans l'océan Indien, dans des conditions plus ou moins constantes, vivent des espèces de céphalopodes (nautiles), presque inchangées depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Il en va de même pour les poissons modernes à nageoires lobes.
Ainsi, la coexistence simultanée d'organismes de complexité structurelle variable s'explique par la théorie de la sélection naturelle et de la divergence.
Résultats de la sélection naturelle. La sélection naturelle a trois conséquences importantes étroitement liées : 1) une complication et une augmentation progressives de l'organisation des êtres vivants ; 2) l'adaptabilité des organismes aux conditions environnementales ; 3) variété d'espèces.
Lorsque les conditions de vie changent, le nombre de différences individuelles entre les individus d'une même espèce résultant de la sélection naturelle augmente et une divergence des caractéristiques au sein de l'espèce est constatée. En conséquence, plusieurs groupes avec des caractéristiques et des propriétés différentes se forment au sein d'une même espèce. Naturellement, la lutte pour l’existence conduira dans la plupart des cas à l’extinction progressive des formes intermédiaires et à la survie de celles qui se sont adaptées au changement d’environnement. De cette manière, plusieurs nouvelles espèces sont formées à partir d’une espèce ancestrale au cours du processus historique.
Selon les enseignements de Darwin, de nouvelles espèces apparaissent en raison de l'héritage de génération en génération et de l'accumulation progressive de changements mineurs acquis par les organismes au cours de l'ontogenèse. À la suite de l'adaptation des organismes d'une même espèce à des conditions différentes, plusieurs nouvelles espèces se forment. En figue. 40 reflète l'émergence de trois nouvelles espèces du type A et de deux nouvelles espèces du type B. Comme le montre la figure, les changements dans la nouvelle espèce A ont à leur tour conduit à la formation de 14 nouvelles espèces. Dans certains cas, de nouvelles espèces apparaissent à la suite de changements progressifs dans l’espèce mère. Un exemple en est la formation des espèces E 10, F 10 avec un changement progressif des espèces E, F.
À mesure que les conditions de vie changent, la direction de la sélection naturelle change également. Si des groupes d'individus de la même espèce largement répartie entrent dans conditions différentes ou commencez, par exemple, à chasser différentes proies, alors la sélection dans ces groupes ira dans des directions différentes. Cela conduira à la formation de diverses adaptations en eux. En conséquence, d'un type à sélection naturelle plusieurs nouvelles espèces se forment, c'est-à-dire que le processus de spéciation aura lieu. Pour illustrer cela, Darwin donne un diagramme de divergence ou divergence de caractères.
Dans le diagramme, les lettres majuscules (A, B, C, D, etc.) sous la ligne du bas indiquent classiquement des espèces individuelles du même genre. Les lignes parallèles de bas en haut (de I à XIV) symbolisent le changement de génération au fil du temps. Darwin admet conventionnellement que d'une lignée à la suivante, il y a un changement de mille générations. Les lignes pointillées dirigées de bas en haut illustrent le destin historique de ces générations à différents stades de développement. Plus la distance entre les lignes pointillées traversant une ligne parallèle est grande, plus la différence entre les groupes divergents d'individus de la génération correspondante (ligne II) est grande qu'entre les points a5 et m5 (ligne V). Cela signifie que la divergence (différence) initiale entre deux groupes de descendants (a2 et m2) de l'espèce originale commune A, apparue sur 2 000 générations, est inférieure aux différences développées après 5 000 générations (a5 et m5). Par conséquent, dit Darwin, nous pouvons accepter que les groupes a2 et m2 soient deux variétés supplémentaires d'une espèce commune, et que les groupes a5 et m5 seront déjà deux nouvelles espèces ayant un ancêtre commun (espèce A).
Ainsi, selon Darwin, de nouvelles espèces apparaissent à travers une série d'étapes intermédiaires : premièrement, deux (ou plus) variétés apparaissent au sein d'une même espèce ; ces variétés, continuant à diverger dans leurs caractères, deviennent progressivement des sous-espèces et finalement des espèces nouvelles. Une variété représente une étape vers la formation d’une nouvelle espèce. De plus, selon le schéma de divergence, en règle générale, une espèce ancienne donne naissance non pas à une, mais à plusieurs espèces.
Caractère divergent La spéciation se produit parce que la différence initiale des organismes au sein d'une espèce augmente son nombre. Darwin illustre ce point avec cet exemple : nombre total Le nombre de loups commence à augmenter à mesure que différentes familles de ce prédateur commencent à chasser différentes proies. Certains loups se « spécialisent » dans le bétail, tandis que d’autres se spécialisent dans les animaux sauvages. En conséquence, le nombre total de loups augmente. Différentes directions de sélection naturelle apparaissent parmi elles et, par conséquent, des divergences.
Revenons au schéma de divergence. Au cours de l'évolution, de nouvelles directions de sélection apparaissent également (les lignes pointillées des espèces A et I se ramifient de manière répétée). Certaines de ces lignées s'avèrent être des impasses : leurs descendants ne survivent pas jusqu'aux temps modernes (lignée XIV) et s'éteignent, remplacés par des espèces plus adaptées. De nombreuses espèces originales ne laissent pas non plus de progéniture (c'est-à-dire qu'elles disparaissent). Et certains (ligne F du diagramme) survivent jusqu’à nos jours, presque sans changer leurs caractéristiques.
Au stade final du processus considéré, les espèces nouvellement émergées présentent des degrés de similitude variables. Sur la ligne XIV, 5 groupes d'espèces les plus proches les uns des autres sont bien visibles. La raison de cette proximité, comme le montre clairement le diagramme, est la relation étroite entre ces espèces. Taxonomiste, combinant des espèces étroitement apparentées en une seule genre, reflétant ainsi la parenté et l'origine commune de ces espèces.
Accouchementà leur tour, ils s'unissent en familles, les familles en ordres, etc. Le diagramme de divergence montre que dans ce cas, la base de telles associations est le processus d'évolution lui-même. Si elles sont très étroitement apparentées, les espèces appartiendront au même genre ; si elles sont plus éloignées, elles appartiendront à la même famille. Enfin, des espèces très éloignées se répartiront en différentes classes du même type. Cela signifierait que toutes les espèces d’un même type ont finalement un ancêtre commun, seul cet ancêtre est inhabituellement ancien.
Donc, systèmes modernes les plantes et les animaux reflètent un certain stade d’évolution. En même temps, il est important de rappeler que vues modernes, décrits par les taxonomistes, sont réels aujourd'hui, mais historiquement temporaires : autrefois, ils n'étaient que des sous-espèces ; dans un avenir lointain, ils pourraient devenir des genres, réunissant des groupes de nouvelles espèces apparentées ; ces nouvelles espèces futures des temps modernes ne sont que des sous-espèces ou des variétés. Le diagramme de divergence explique ainsi comment l'évolution est à la base de la taxonomie moderne. En même temps, cela montre que la divergence conduit inévitablement à l’émergence d’une variété de formes organiques dans la nature.

Le diagramme de divergence aide à comprendre un autre problème important. L'augmentation générale de la diversité des formes organiques complique grandement les relations qui naissent entre les organismes dans la nature. C'est pourquoi, au cours du développement historique, ce sont généralement les formes les plus organisées qui reçoivent les plus grands avantages. Ainsi, le développement progressif général du monde végétal et animal sur Terre s'effectue depuis les formes inférieures vers les formes supérieures.
Cependant, dans les cas où les conditions de vie ne se compliquent pas, mais restent pratiquement inchangées, et où les organismes sont préservés sans autre complication.
Parallèlement à la divergence, le résultat de l'évolution peut également être le résultat opposé : la convergence ou la convergence des caractéristiques. La convergence se produit en raison de l'action unidirectionnelle de la sélection naturelle chez des organismes systématiquement éloignés les uns des autres, lorsque ces organismes vivent dans des conditions similaires. Un exemple de similarité convergente est la forme profilée du corps d'un requin (poisson), d'un ichtyosaure (reptile aquatique au cou éteint) et d'un dauphin (mammifère aquatique). La similitude des formes corporelles ici n'est pas causée par un genre proche. ité, mais l'action unidirectionnelle de la sélection naturelle dans le même milieu aquatique, où une telle forme est utile à la fois pour les poissons et les dauphins.
Ainsi, sur la base de l'action de la sélection naturelle, une aptitude relative se forme, de nouvelles espèces se forment, la diversité globale des formes organiques dans la nature augmente et le développement progressif du monde animal et végétal sur Terre s'effectue.
Le plus petit taxon (catégorie en biologie) est appelé une espèce. Espèce - un groupe d'individus ayant des caractéristiques morphologiques similaires, se croisant librement et produisant en même temps une progéniture fertile. Il existe d'autres taxons plus étendus. Un groupe d'espèces étroitement apparentées, par exemple, forme un genre, et à partir de genres étroitement apparentés, une famille est formée, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous parlerons de la plus petite catégorie taxonomique, c'est-à-dire des espèces. Qu'est-ce qu'une espèce, comment se forme ce taxon et quelles méthodes de spéciation existent dans la nature ? Alors, commençons.
Spéciation dans la nature
La spéciation est le processus de formation de nouvelles espèces et de leurs modifications. Il existe une barrière de compatibilité interspécifique. Qu'est-ce que c'est?
C'est le cas lorsque les espèces, lorsqu'elles sont croisées, n'ont pas la capacité de produire une progéniture fertile. Selon la théorie de l'évolution, la spéciation dépend de la variation héréditaire. Aujourd'hui, en biologie, il existe deux types de spéciation : géographique et écologique. Parlons de chacun d'eux plus en détail.
Spéciation géographique
La spéciation géographique, ou, comme on l'appelle aussi, allopatrique, est la formation de nouvelles espèces dans l'isolement spatial. En termes simples, la formation d'une espèce provient de populations vivant dans des zones géographiques différentes. Les populations étant séparées depuis longtemps, un isolement génétique se produit entre elles.

Elle persiste même si les populations ne sont plus ségréguées. Il y en a beaucoup qui peuvent être cités. Prenons l'exemple du muguet de mai. Il comprend cinq zones indépendantes, qui étaient initialement considérées comme une seule. Il est important qu'ils soient tous situés à une distance assez grande les uns des autres. Des races sont apparues dans chacun des territoires, ce qui a conduit à la formation d'espèces végétales indépendantes. Aussi, en utilisant l'exemple de la migration, nous considérerons la dispersion de la mésange charbonnière. vivant en Europe, ont commencé à s'installer plus à l'est. Pour cela, il y avait des routes du nord et du sud. Plus près du sud, des sous-espèces telles que la Boukhara et les petites mésanges se sont formées, et plus près du nord, les petites et grandes mésanges. Ces derniers ne produisent pas d'hybrides.

Il s’est donc avéré qu’à la suite d’un tel règlement, une barrière reproductive s’est formée entre eux. Regardons un autre exemple. L’espèce australienne de perroquet existe depuis longtemps en Australie-Méridionale. Il convient de noter qu'il s'agit d'une zone assez humide. En cas de sécheresse, la zone a changé, ce qui a divisé le territoire en deux parties : l'est et l'ouest. Naturellement, sur une longue période, chacun d'eux s'est formé différentes sortes perroquets. Après une longue période, la zone d'origine a été pratiquement restaurée. Conditions climatiques est redevenu le même, mais autrefois, une seule espèce ne pouvait plus se croiser, car l'isolement génétique s'est produit. Ainsi, la spéciation allopatrique est associée à l'isolement. En conséquence, de nouvelles espèces indépendantes se forment.
Voie écologique de spéciation
Il existe, outre la voie géographique, une autre voie. C'est la spéciation écologique. Il a aussi un deuxième nom - sympatrique. De quel genre de méthode s'agit-il ? La spéciation écologique est la formation de nouvelles espèces résultant de la divergence des individus dans des territoires individuels. Autrement dit, au début, l’espèce vit dans une zone et, plus tard, en raison d’une concurrence croissante, elle se propage à d’autres territoires. Par exemple, vous pouvez observer la situation suivante. Le grand hochet fleurit tout l'été. Mais si vous tondez l’herbe dans cette zone chaque année au milieu de l’été, la plante ne pourra plus produire de graines. Pour cette raison, les graines données avant ou après la tonte sont conservées.

Ainsi, les deux espèces situées dans un même pré ne peuvent pas se croiser. La spéciation écologique peut être confirmée par la présence d'espèces étroitement apparentées dans des habitats adjacents. Parfois, ces domaines coïncident même.
La spéciation et son rôle
Les méthodes de spéciation sont étudiées depuis longtemps, mais leur étude est assez difficile. Cela est dû à la durée du processus de spéciation. Les spéciations écologiques et géographiques sont très différentes les unes des autres, cependant, chacune d'elles a une certaine importance dans la vie de la nature. Leur rôle principal est la formation de nouvelles espèces.